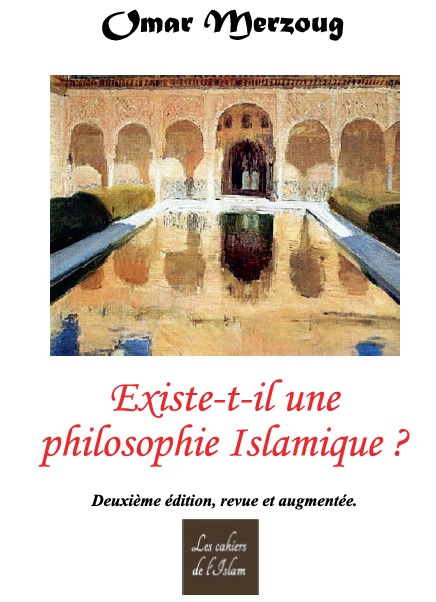Vous retrouverez son blog ici
Les Cahiers de l'Islam : L’Égypte et la Tunisie, deux pays symboles du « printemps arabe », sont traversés de nos jours par des crises politiques profondes, avec d’une part, en Égypte des manifestations quotidiennes contre le pouvoir des Frères musulmans et, d’autre part, en Tunisie l’assassinat de Chokri Belaïd et des divisions politiques apparues au sein du parti Ennahada à la suite de ce meurtre ; sans même parler des divergences sur le plan religieux que connaissent ces pays. Etait-ce prévisible ?
Clément Steuer : Je ne dirais pas que ces événements étaient prévisibles, car rien ne l'est jamais dans le domaine des sciences sociales. Cependant, la situation actuelle dans ces deux pays ne doit rien au hasard et il est possible de l'expliquer relativement aisément. Dans une période de changement de régime, passant par l'organisation d'élections libres et non-truquées, il n'est pas surprenant de voir s'exacerber les oppositions présentes au sein de la société, que le régime autoritaire parvenait à tenir sous le boisseau. Le principal outil utilisé par ce dernier pour se perpétuer était en effet le contrôle qu'il exerçait sur l'offre politique : si les partis d'opposition étaient autorisés, leur fonctionnement, leur financement, leur activité, et jusqu'au contenu idéologique de leurs programmes étaient étroitement contrôlés par la loi. Notamment, il est significatif que, dans ces deux pays, il était explicitement interdit de créer un parti sur une base religieuse, linguistique, régionale ou sociale. Cette interdiction visait précisément à empêcher la traduction politique des clivages sociaux, l'idée sous-jacente étant que la politisation de ces clivages aurait pour effet de les exacerber, et donc de mettre en danger l'unité de la société.
L'angoisse de la division constituait d'ailleurs la principale source de légitimité de ces régimes autoritaires, perçus comme les garants de l'unité nationale. Avec les progrès de l'alphabétisation et de l'éducation, l'arrivée massive sur le marché de l'emploi d'une génération de jeunes diplômés mieux formés et bien plus nombreux que leurs parents, et le développement d'une société civile en quête d'autonomie, le pacte liant les régimes autoritaires à leurs populations est devenu obsolète. Désormais, les oppositions structurant la société peuvent s'exprimer librement, ce qui est une expérience dangereuse et traumatisante, mais constitue une étape nécessaire à l'établissement d'une démocratie.
Pour comprendre la violence des affrontements en cours en Égypte et en Tunisie, il faut bien garder à l'esprit que ce qui est en jeu dépasse de loin l'orientation générale des politiques publiques au cours de la prochaine législature. Il ne s'agit de rien de moins que de décider de la forme que prendra l'État au cours des prochaines décennies, d'où la cristallisation des débats autour de l'écriture de la Constitution. Or, la principale opposition structurant les sociétés arabes est – au moins depuis les années 1970 – celle qui oppose les partisans de l'islamisation de l'État à ceux de sa sécularisation. De ce point de vue, la situation présente dans ces deux pays rappelle la violence des affrontements religieux qui ont dominé la vie politique française depuis la constitution civile du clergé en 1790 jusqu'à l'adoption de la loi de 1905. Mais à la différence de ce qui s'est passé en France, la question n'est pas ici celle du rapport entre deux entités – l'Église et l'État – mais celle de la source principale du droit positif : la loi religieuse ( sharî`a
) ou la citoyenneté (muwâtana). La principale pierre d'achoppement entre ces deux visions du monde est celle du droit des femmes et des minorités religieuses. Si la sharî`a reconnaît des droits à ces deux catégories de la population, ceux-ci n'en demeurent pas moins différents de ceux reconnus aux hommes musulmans. La vision se réclamant de la citoyenneté pose au contraire que l'égalité absolue des droits de tous les citoyens sans distinction de sexe ni de confession doit demeurer première dans l'élaboration de la législation.
Si les élections organisées en 2011-2012 dans ces deux pays ont donné aux islamistes une majorité, celle-ci s'avère finalement relativement précaire. En Tunisie, ils ne disposent que d'une majorité relative à l'Assemblée, et ont dû passer une alliance avec des formations séculières pour pouvoir gouverner. En Égypte, leur domination sur l'Assemblée du peuple s'est révélée beaucoup plus nette (70 % des sièges avec 62 % des voix), mais le candidat des Frères musulmans à la présidence de la République ne l'a en revanche remporté au second tour qu'avec une faible avance sur son rival séculier (52 % des voix). Il faut en effet garder à l'esprit le fait que les voix en faveur des organisations islamistes égyptiennes au cours des élections législatives ne traduisent pas forcément une adhésion idéologique à leur projet politique, mais s'expliquent également en grande partie par les services rendus à la population par les organisations caritatives contrôlées par les Frères musulmans.
La notion de citoyenneté dispose donc d'un soutien populaire bien plus important qu'il n'y paraît. D'abord, elle paraît bien plus à même de garantir l'unité nationale, surtout en Égypte où il existe une importante minorité chrétienne. Les coptes et leurs Églises soutiennent bien évidemment la vision d'une législation basée sur la citoyenneté, tout comme une partie des Égyptiens musulmans dont les pratiques sont condamnées par les islamistes, tels que les membres des nombreuses confréries soufies que connaît le pays. Par ailleurs, comme je l'ai mentionné précédemment, les anciens régimes puisaient leur légitimité dans leur rôle de garants de l'unité nationale, principalement menacée par les islamistes. Il n'est donc pas surprenant de voir une partie des catégories sociales favorisées sous Moubarak et Ben Ali s'opposer aujourd'hui au gouvernement islamiste : police, armée, bourgeoisie issue de l'infitâh, élites locales. La justice se montre également hostile à tout projet d'islamisation du droit, qui viendrait réduire de manière significative son autonomie, au profit des oulémas et autres spécialistes du droit musulman. Enfin, la jeunesse révolutionnaire et le mouvement ouvrier se soulèvent aujourd'hui contre un mouvement islamiste désormais largement embourgeoisé, et perçu comme le nouveau visage de l'ancien régime, ne remettant en cause ni les rapports de production, ni le paternalisme, ni le système d'alliances régional et international.
Cette situation explique l'alliance apparemment paradoxale des révolutionnaires et des partisans de l'ancien régime. En Égypte, cette alliance est consécutive à l'arrivée au pouvoir des islamistes, et coïncide avec la rédaction par ces derniers d'un projet de Constitution. Les questions qui opposent révolution et contre-révolution ont de ce fait été mises provisoirement en suspens mais, selon toute probabilité, elles ne manqueront pas de se poser à nouveau dans un avenir proche : place de l'armée dans les institutions, réforme de la justice et des appareils de sécurité, fin de l'impunité pour les brutalités policières, etc. Les islamistes au pouvoir essaient périodiquement de remettre ces questions sur le devant de la scène, dans l'espoir de diviser l'opposition, car ils pensent que les révolutionnaires devraient naturellement soutenir leurs réformes en ce sens. Mais cette stratégie s'avère au final peu payante, car les révolutionnaires se méfient désormais des Frères musulmans, et s'opposent eux aussi à ces réformes qu'ils perçoivent comme des tentatives de « frérisation » de l'État.
Clément Steuer : Je pense, a contrario des analyses en termes d'« automne islamiste », qu'au-delà de la victoire électorale des Frères musulmans, la situation actuelle consacre leur perte d'influence – notamment auprès de la jeunesse et des classes populaires – et leur déconnexion par rapport aux aspirations majoritaires au sein de la société. Olivier Roy avait montré dès 1992 que la « ré-islamisation » des sociétés arabes constituait paradoxalement une étape de leur sécularisation. Le phénomène islamiste a été causé – entre autres facteurs – par les progrès de l'alphabétisation et de l'instruction publique. Ces progrès ont permis à des profanes d'avoir un accès direct aux textes religieux, et de contester l'interprétation qui était faite de ces textes par les oulémas et autres dignitaires religieux. Ces derniers connaissaient en outre une baisse de leur légitimité, liée à leur compromission avec les régimes autoritaires. Dans ce contexte, l'idiome islamiste est devenu dès les années 1970 le langage de la contestation. Les Frères musulmans et les autres organisations islamistes ont en effet profité de cette perte de légitimité des religieux et de la possibilité d'interpréter librement les textes pour imposer leur vision de l'islam comme une lecture à la fois contestataire et légitime des textes sacrés, sa légitimité étant justement garantie par son opposition à un pouvoir dénoncé comme despotique et corrompu. À cette époque, les organisations islamistes sont rapidement devenues hégémoniques dans les université, et ont alors su se rallier une large clientèle de jeunes diplômés.
Désormais, les islamistes sont devenus minoritaires en milieu étudiant, au profit des idées dites libérales, qui sont censées traduire les aspirations de la révolution. Le pouvoir, tenu par les islamistes, est désormais confronté à une jeunesse qui refuse que quiconque vienne lui expliquer ce qu'est un bon musulman et quelle est l'interprétation la plus juste des textes sacrés. L'individuation des pratiques religieuses et l'universalisation de l'accès aux textes sacrés, qui avaient dans un premier temps favorisé les mouvements islamistes, se retournent aujourd'hui contre eux. Tous comme celle des oulémas liés au pouvoir hier, leur lecture de l'islam est aujourd'hui rejetée par des jeunes diplômés qui s'estiment eux aussi parfaitement compétents pour légitimer par les textes leurs propres pratiques.
La situation est peut-être moins claire en Tunisie, car le régime de Ben Ali réprimait l'exhibition trop ostensible de signes religieux dans l'espace public. La révolution a donné aux islamistes une liberté vestimentaire qui leur faisait jusqu'alors défaut, et qui a pu donner l'impression qu'ils envahissaient brusquement une société jusqu'alors entièrement sécularisée. En Égypte, les signes extérieurs de religiosité s'étaient progressivement répandus l'espace public dès les années 1970, et n'avaient cessé de gagner du terrain depuis lors. Avec l'arrivée au pouvoir des islamistes, il semblerait que l'exhibition de ces signes soient aujourd’hui en recul, même s'il est encore trop tôt pour affirmer avec certitude que ce phénomène a entamé son déclin.
En prenant en compte ce qui suit, on comprend qu'il est difficile de souscrire à l'idée selon laquelle les islamistes auraient détourné les révolutions. Ils semblerait plutôt qu'ils soient aujourd'hui en première ligne pour subir de plein fouet un phénomène de grande ampleur qu'ils n'avaient ni suscité, ni même appréhendé, et qu'ils semblent encore aujourd'hui incapables de comprendre dans toute son ampleur. Ce phénomène est le fruit de tendances lourdes, démographiques, culturelles, économiques et sociales, qu'ils ne sont pas en position de combattre. D'autant que leur emprise sur les institutions étatiques demeurent encore très faible malgré leur victoire électorale et leurs tentatives de « frériser » les administrations. L'armée, la police et la justice – entre autres – leurs résistent encore, alors même qu'ils sont confrontés à des protestations populaires de grande ampleur.
De leur côté, les partis libéraux, même s'ils surfent sur cette vague de mécontentement, ne sont pas plus que les islamistes en mesure de contrôler le mouvement. Ainsi, affirmer que les partis politiques ont usurpé et trahi les aspirations populaires me semble pour le moins précipité. Dans le contexte d'une ouverture du système politique, ils ont effectivement été les premiers à profiter du changement. Néanmoins, la question des libertés associatives et syndicales se pose à l'ensemble de la classe politique et ne pourra pas continuer à être éludée très longtemps, tant la pression des mouvements sociaux et étudiants est incessante. Évidemment, et pour conclure cette interview comme nous l'avons commencée, rien ne peut jamais être acquis avec certitude dans la marche des sociétés, et les pays du printemps arabes ne sont pas à l'abri de régressions autoritaires ou de dérapages violents, comme le démontre la situation syrienne. Néanmoins, s'arrêter sur la victoire électorale des islamistes pour l'interpréter comme l'inévitable conclusion des révolutions arabes me semble constituer une erreur de jugement qui fait l'impasse sur l'essentiel. La véritable nouveauté de l'année écoulée est que les islamistes ont désormais perdu le monopole du sens. À cet égard, je voudrais rappeler pour finir que les manifestants tués en s'opposant à un pouvoir islamiste sont désormais qualifiés de « martyrs ». Ce simple fait est à mon avis significatif de l'ampleur de l'échec du mouvement islamiste confronté à une situation révolutionnaire qu'il n'a ni voulue ni comprise.