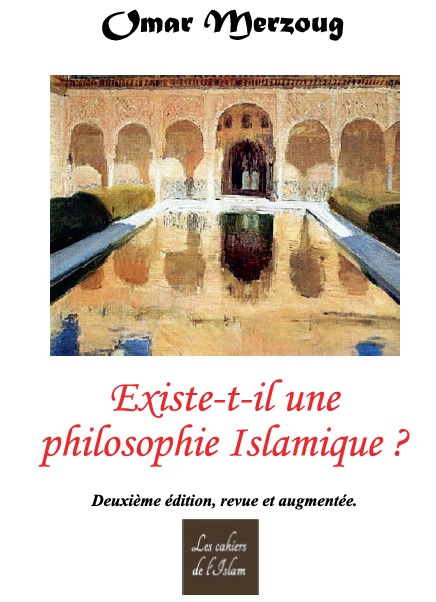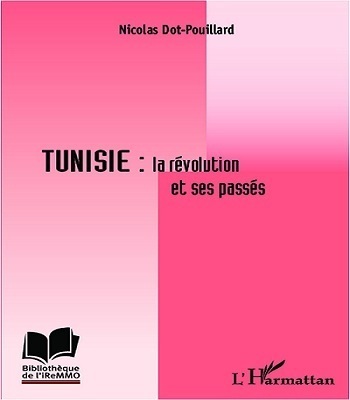
"Deux ans après le départ du président Ben Ali, la fissure entre l’idéal révolutionnaire et le désenchantement démocratique semble croissante. La révolution tunisienne a mis au jour trois césures fondamentales. La première est en un sens la fracture bourguibiste : tous les comptes ne sont pas soldés avec le passé. La seconde touche à la question religieuse et identitaire. L’arrivée d’Ennahda au pouvoir a réveillé des spectres enfouis. La dernière est enfin régionale et sociale. La différenciation entre les côtes et les provinces intérieures apparaît d’abord comme une structure sociale discriminante bien antérieure aux années Ben Ali."
Nous proposons ici avec l'accord de l'auteur , l'avant-propos de son dernier ouvrage : Tunisie : la révolution et ses passés (Paris, L'Harmattan, Bibliothèque de liReMMO)
Nous proposons ici avec l'accord de l'auteur , l'avant-propos de son dernier ouvrage : Tunisie : la révolution et ses passés (Paris, L'Harmattan, Bibliothèque de liReMMO)
Avant-propos
Le 16 juillet 2012, Rached Ghannoushi est reconduit à la présidence du mouvement Ennahda [1] . Le neuvième congrès de l’organisation islamiste est une démonstration de force politique : pendant quatre jours, ce sont 1103 délégués qui sont réunis au Palais du Kram, dans le nord de Tunis. Plusieurs milliers de sympathisants et de militants du parti ont assisté à la cérémonie d’ouverture ; les représentants des principales chancelleries occidentales sont présents, pour ne quitter la salle qu’une fois le représentant du Hamas palestinien, Khaled Meshaal, arrivé à la tribune. Le vice-président de la République du Soudan, Nafaa Ali Nafaa, a également fait le déplacement. La vieille garde des fondateurs du mouvement est au premier rang. Certains d’entre eux n’en sont pourtant plus les dirigeants: c’est le cas d’un Salah Karker, affaibli et invalide, dont l’assignation à résidence, en France, n’a pu être levée qu’à la suite de la révolution du 14 janvier 2011[2]. En signe de réconciliation interne, c’est aussi le « rebelle » d’Ennahda qui est aux premières loges : Abdelfattah Mourou s’était pourtant présenté sur une liste indépendante lors des élections pour une Assemblée nationale constituante d’octobre 2011, concurrençant ainsi Souad Abderahim, la candidate officielle d’Ennahda, sur la circonscription de Tunis 2. Ce n’est pas seulement un congrès national qui se tient : c’est une célébration politique engageant tout à la fois le passé et le présent.
Car l’événement tient lieu de symbole, 16 mois après la chute du président Ben Ali. Les précédents congrès d’Ennahda se sont tenus dans la clandestinité ou dans l’exil. En juillet 1981, ce qui s’appelle encore le Mouvement de la tendance islamique (MTI) [3] se voit refuser son visa de légalisation par le ministre de l’Intérieur de l’époque, Driss Guiga. Près de 500 de ses membres sont alors immédiatement arrêtés. En novembre 1987, le coup d’Etat de Zin al-Abidine Ben Ali et la mise à l’écart du « Combattant suprême » [4], le président Habib Bourguiba, participent d’une illusion démocratique de courte durée : plusieurs centaines d’activistes islamistes sont alors libérés de prison, les activités de l’Union générale tunisienne des étudiants (UGTE) [5] sont légalisées. Le Mouvement de la tendance islamique, renommé Ennahda, s’apprête à participer aux premières élections « démocratiques » de l’histoire tunisienne, le 2 avril 1989, tandis que sa revue, al-Fajr (l’Aube), est autorisée. Le parti du président Ben Ali, le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), descendant direct du Néo-Destour [6], cumule près de 80 % des suffrages exprimés, contre seulement 14 % aux islamistes. La majorité du corps politique échappant au palais présidentiel crie immédiatement à la fraude. Opposition de gauche et islamistes : tous appellent à boycotter les élections municipales de 1990. Un an après, la parenthèse est définitivement refermée, et l’heure est de nouveau à la polarisation : en février 1991, des activistes du mouvement Ennahda brûlent un local du RCD dans le quartier de Bab Souiqa, au centre de la capitale, faisant un mort. De 1991 à 1992, les grands procès des leaders du mouvement islamique reprennent, tandis qu’une partie de la direction du mouvement, à l’instar de son principal dirigeant, Rached Ghannoushi, s’exile.
Quelque vingt ans plus tard, la scène a changé. Certains membres de l’ancien régime sont encore dans les coulisses ; mais les opposants d’hier sont devenus pour certains les gouvernants d’aujourd’hui. Le cas d’Ennahda est emblématique. D’abord de manière purement formelle : à l’Assemblée nationale constituante élue en octobre 2011, le mouvement islamiste possède le plus important groupe parlementaire, avec 89 sièges sur 217. Son secrétaire général, Hamadi Jebeli, est devenu chef du gouvernement le 16 décembre, tandis que sa formation détient la majorité des ministères de souveraineté, dans le cadre d’un gouvernement d’union formé avec le Congrès pour la République (CPR) et le Front démocratique pour le travail et les libertés (Ettakatol), deux partis situés à la gauche du spectre politique [7] .
La place tenue par Ennahda au sein de l’actuelle transition démocratique a valeur de symbole historique : rétrospectivement parlant, elle fait figure de revanche de l’histoire. D’anciens prisonniers politiques, à l’instar du chef du gouvernement, ou encore du nouveau ministre de l’Intérieur, Ali Laraidh [8] , sont désormais dans les allées du pouvoir. La victoire du mouvement Ennahda s’inscrit par ailleurs dans une dynamique globale : les partis islamistes sont de moins en moins, dans la foulée des soulèvements arabes, des organisations oppositionnelles que des gestionnaires du quotidien. Ils se sentent obligés de contracter des alliances politiques avec d’autres anciens opposants, si ce n’est même parfois, avec leurs ennemis d’hier. Ils sont devenus des partis de gouvernement, nouvellement enserrés dans les sphères d’un réalisme politique qu’ils semblent encore gérer difficilement. Leur discours est loin de la révolution islamique prônée dans les années 1980, même s’ils n’ont pas renoncé à toute idée d’islamisation de leur société. Conservateurs et religieux, prompts à mobiliser le référent islamique et identitaire, ils semblent être les principaux bénéficiaires politiques des révolutions arabes, sans pour autant prôner une idéologie réellement révolutionnaire. La seule référence à l’espace du sacré dont ils pensent être les garants ne suffira peut-être pas, à l’avenir, à les prémunir de nouvelles colères populaires.
De nouvelles conflictualités ?
Car l’unanimisme révolutionnaire des premiers temps de la révolution n’est plus de mise. Le mouvement Ennahda bénéficie certes d’une indéniable légitimité démocratique. Mais il ne fait pas face à un pays pacifié. La Tunisie se retrouve aujourd’hui déchirée et fragmentée : c’est aussi le temps de la désillusion. La seule tenue d’élections démocratiques au mois d’octobre 2011, la promesse d’une nouvelle constitution et d’une seconde République tunisienne, ne suffisent plus à faire croire dans des lendemains qui chantent. En juin 2012, un manifeste rédigé par de jeunes activistes tunisiens, souvent indépendants des partis politiques constitués, résumait ce sentiment diffus d’espoirs vite enterrés : « Aujourd’hui, un an et demi après la fuite de Ben Ali, notre colère ne cesse de gronder. Et pour cause : les alliés réels et virtuels (...) ceux qui mendiaient sa bénédiction au temps de la dictature, ont non seulement réussi à confisquer les slogans de la révolution, mais plus encore à la dénigrer, à l’exclure des défis actuels voire de l’éradiquer purement et simplement de la mémoire collective (...) Ces alliés réels et virtuels ont même tenté de pervertir la Révolution de la Dignité en un théâtre des identités meurtrières, dans lequel rétrogrades des Lumières et rétrogrades de l’obscurantisme rivalisent deux à deux » (Manifeste, 2012).
La chute de Ben Ali, le 14 janvier 2011, a semblé réconcilier plusieurs Tunisie, autour d’un unanimisme révolutionnaire rappelant peut-être les premiers moments de la lutte pour l’indépendance. Islamistes, mouvement syndical, formations de gauche et d’extrême gauche, libéraux : l’heure fut un moment à la communion. Les grands slogans ne font cependant pas les grandes révolutions, et le simple accord autour de valeurs fondatrices – la liberté, la démocratie, une nouvelle constitution, le dépassement du système autoritaire – ne suffit naturellement pas à unifier, sur un temps historique long, les acteurs politiques autour d’une vision homogène des grands défis de la transition démocratique, ce dernier concept ne définissant au passage pas grand-chose, si ce n’est l’idée d’un moment traversant un avant et un après. La révolution a ainsi fait œuvre – en toute logique – de division. Le mythe d’un peuple mobilisé contre sa dictature, quelques jours après le départ du président Ben Ali pour l’Arabie saoudite, a rapidement pris fin : de la plèbe aux élites, on eut tôt fait de s’apercevoir ce que le concept de peuple pouvait aussi avoir d’illusoire. De nouvelles polarisations sont apparues. D’anciennes ne cessent encore de faire surface. Ces oppositions sont loin d’être le signe d’un échec ou d’un essoufflement de la dynamique née en décembre 2010 à Sidi Bouzid, bien au contraire. Mais il s’agit de les sérier, pour rendre intelligible le processus actuel. Ce sont, en apparence, pour l’observateur non averti, de nouvelles frontières politiques, sociales, culturelles, qui se dessinent. Mais elles recoupent souvent, pour tout ou partie, celles du passé, les recomposant et leur donnant un nouveau visage.
La révolution s’est, jusqu’à maintenant, découpée en quatre temps distincts. Ils témoignent, dans leur chronologie précipitée, de ce processus de scission progressive du corps social institutionnellement contenue, après les premiers moments de l’unanimisme révolutionnaire. Il y a d’abord le temps de l’insurrection, de décembre 2010 à janvier 2011 : c’est un moment de conquête de l’unité nationale, envers et contre le régime. En une montée vers la capitale aussi rapide qu’inattendue, la contestation d’abord isolée des provinces paupérisées du centre de la Tunisie, relayée par les réseaux sociaux, s’adjoint peu à peu le soutien d’une partie des classes moyennes et de l’ensemble du mouvement syndical, et semble un moment réunir un pays face à un régime qui ne peut, dans son dernier souffle, mobiliser son propre appareil partisan.
La chute de Ben Ali ouvre alors une série de césures tout à la fois identitaires, culturelles, politiques, et économico-sociales. Le second moment de la révolution tunisienne, qui court du 17 janvier à la fin février 2011, est celui d’un affaissement continu de la souveraineté étatique. Les deux premiers gouvernements de Muhammed Ghannoushi, ancien Premier ministre de Ben Ali, font face à une contestation populaire d’ampleur en réclamant la démission. Paradoxalement, la radicalité des revendications affirmées à l’époque ne débouche pas sur une extension des « passions révolutionnaires » (Meyer, 2002), mais bien plutôt, à partir de mars 2011, sur un singulier compromis entre une logique réformiste de redressement de l’autorité étatique, sous l’autorité d’un ancien ministre de l’Intérieur de Bourguiba, Béji Caïd Essebsi, et une persistance des revendications révolutionnaires, cependant institutionnellement contenues. La quatrième période de la révolution tunisienne s’est ouverte en octobre 2011, avec l’élection d’une Assemblée nationale constituante. Ce qui fait office de rupture – le chemin d’une seconde République tunisienne est désormais ouvert – a également en tout point l’allure de la continuité : l’actuel gouvernement de Hamadi Jebeli semble s’inscrire dans une culture du compromis, à l’instar de celui de Béji Caïd Essebsi : compromis ne tenant pas forcément aux questions religieuses et identitaires, mais bien plutôt aux orientations économiques et politiques de ses prédécesseurs. Ces quatre séquences de la révolution tunisienne dessinent un schéma d’une simplicité frappante : de nouvelles élites politiques, issues des anciennes oppositions au bourguibisme et au benalisme, privilégiant une logique de négociation prudente avec les anciennes, préfèrent la logique de la stabilité politique et institutionnelle à celle de la rupture trop brusque avec l’ancien système. Réaliser les objectifs de la révolution signifie, ipso facto, devoir y mettre progressivement fin. En Tunisie, le sens caché de la révolution tient parfois dans sa volonté de ne pas vouloir être.
L’assassinat par balles, devant son domicile, de Choukri Belaïd, leader du Parti des patriotes démocrates unifiés (Watad) et figure de proue de la gauche révolutionnaire, le 6 février 2013, marque un changement d’époque, et, peut-être, le commencement du cinquième acte de la révolution tunisienne. Ce meurtre a provoqué un vif émoi dans le pays. Les assassinats politiques ne relèvent pas d’une pratique courante en Tunisie, même du temps de la dictature : un seuil symbolique a donc été franchi. Il a réunifié un moment les différents acteurs de la gauche et des « laïcs » tunisiens, unanimes à condamner tout à la fois les groupes salafistes et ce qu’ils considèrent comme un laisser-faire sécuritaire d’Ennahda et du gouvernement. Il a renforcé une tendance prégnante à la polarisation de plus en plus accrue entre islamistes et non-islamistes, tout en ouvrant une période d’incertitude institutionnelle caractérisée par le recours de plus en plus courant à la violence politique. Il a montré que la gauche radicale tunisienne, unifiée dans le Front populaire, qu’on disait morte quelques mois auparavant, est désormais aussi un acteur politique de poids, disputant à une mouvance salafiste implantée dans les couches les plus précarisées de la société tunisienne, le monopole d’une « troisième voie » aux destouriens et à Ennahda. Il a enfin confirmé qu’Ennahda est désormais divisé entre deux lignes : celle, pragmatique, incarnée par l’ancien chef du gouvernement, Hamadi Jebeli, mais cependant minoritaire, et celle, maximaliste, d’une autre partie de sa direction. Il augure donc, dans toute sa tragédie, d’une probable recomposition globale du paysage politique tunisien, tout en étant le signe d’une crise identitaire qui se prolongera sans doute dans le temps.
La politique d’accommodement progressif avec les élites politiques et économiques de l’ancien système, souvent dépeinte sous le jour d’une nécessaire « réconciliation nationale », provoque en retour réactions et oppositions aux différents gouvernements transitoires, au-delà même de leurs différences politiques et idéologiques. S’il y a bien eu chute du régime, il n’en reste pas moins que la structure administrative et politique du benalisme est encore debout. Le fonctionnement actuel de certains ministères, en premier lieu celui de l’Intérieur, tout comme de certains médias, montre une forte capacité de résilience du système passé. Dans le même temps, l’ancien parti au pouvoir, le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), n’est pas mort : il se recompose politiquement, en éliminant la référence à Ben Ali, mais en réactivant l’image mythique d’un bourguibisme traité parfois sur un mode nostalgique. Certains de ses anciens membres préfèrent quant à eux négocier directement avec le mouvement Ennahda, dont ils saisissent sans peine qu’il est bien un acteur incontournable, si ce n’est déterminant, du système politique à venir.
Or, depuis le début de la révolution, la question de comment traiter et en finir avec l’ancien régime ne cesse de tarauder tant les gouvernements de transition que la société civile : il y a bien une frontière progressive qui se crée entre ceux qui mettent en avant la lutte contre l’impunité et la demande de justice d’une part, qui s’inscrivent donc dans une logique de rupture radicale, et ceux qui prônent une réconciliation nationale progressive avec de larges factions de l’ancien parti au pouvoir. Que faire de l’ancien système est devenu une question qui divise.
La seconde césure progressive qui est en train de se créer est celle entre le mouvement islamiste Ennahda et ses opposants, des libéraux à l’extrême gauche, en passant par la mouvance syndicale de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) [9]. Elle reste fondée sur un registre des peurs et des passions, entre deux Tunisie, l’une séculière, se réclamant d’un « modernisme » (al-Hadâtha) à la tunisienne, l’autre sans doute plus attachée au référent islamique. Cependant, rien n’est tout à fait manichéen, et il y a, dans cette dichotomie créée entre une Tunisie « moderniste » et une Tunisie « conservatrice », quelque chose d’arbitraire : les mouvements de gauche et de centre gauche se retrouvent aujourd’hui divisés entre partisans d’un dialogue avec le mouvement Ennahda, dans le cadre d’un gouvernement d’union nationale – c’est le cas du Congrès pour la République et d’Ettakatol – et ceux favorables à la constitution d’un nouveau bloc centriste, pouvant éventuellement s’allier aux formations politiques issues du RCD, afin de contrer l’hégémonie progressive du mouvement islamiste. De même, les islamistes sont soumis à deux tentations : une partie d’entre eux s’inscrit apparemment bien dans une logique de construction patiente d’un cadre démocratique, et privilégie pour cela le dialogue avec des acteurs politiques issus du centre gauche ou des libéraux, tandis qu’une autre partie de leur direction semble de plus en plus tentée par une radicalisation fondamentaliste, si ce n’est par une volonté hégémonique et autoritaire. En forme de troisième voie, la gauche radicale, unifiée depuis l’été 2012 dans le Front populaire, refuse la bipolarité du système politique, entre conservateurs islamistes et libéraux néo-bourguibistes, et tente de surfer sur la vague croissante de contestation sociale dans le pays. Dans tous les cas, la polarisation progressive entre islamistes et non-islamistes a une conséquence fondamentale : elle tend à limiter les débats de la conjoncture politique actuelle à la problématique sécularisme/religion, alors même que la révolution du 14 janvier avait mis en valeur la question sociale, au travers notamment de la révolte des régions centrales, précarisés et marginalisées, de la Tunisie, et la cause, devenue peu à peu mobilisatrice, des diplômés-chômeurs.
Tout ceci conduit à la dernière frontière fondatrice de la révolution tunisienne : celle qui semble aujourd’hui opposer, géographiquement et socialement, deux Tunisie. Berceaux de la révolution du 14 janvier, les régions centrales n’ont pas cessé leur révolte depuis. Si islamistes et non-islamistes semblent s’opposer autour des valeurs et des questions identitaires, ils s’accordent au moins sur un point : l’oubli et la négligence des régions périphériques. Cela se traduit notamment par des orientations économiques assez similaires entre les différentes formations présentes à l’Assemblée nationale constituante, au-delà de leurs références idéologiques propres. Encore en ébullition, marquées par des grèves à répétition et des manifestations parfois violentes, ces régions centrales pourraient bien, appuyées sur une partie du mouvement syndical, faire montre d’une radicalité mettant en péril la stabilité – déjà pourtant toute relative – des gouvernements présents et futurs.
L’ensemble de ces nouvelles questions et frontières politiques – entre les partisans d’un compromis relatif avec l’appareil de l’ancien régime et ceux d’une lutte plus radicale contre ses derniers restes, entre les tenants d’une Tunisie plus fortement orientée sur des valeurs islamiques et ceux d’une Tunisie plus « moderniste », avec tout ce que ce dernier terme peut avoir de flou, enfin entre les régions paupérisées du centre et de l’ouest de la Tunisie, bastions de l’insurrection de décembre 2010, et une capitale et des provinces côtières plus favorisées – caractérisent la conjoncture présente. Ces trois césures vont s’installer, sans doute, dans un temps long. Clivant tout à la fois les partis politiques, la société civile, les régions, les classes sociales, elles nous obligent à préférer encore le terme de révolution à celui de postrévolution. La seconde est synonyme d’une certaine stabilité économique, politique et institutionnelle, qui n’est actuellement pas encore à l’œuvre. La première, au contraire, exige de penser l’ensemble des rapports de force et des clivages présents, moins marqués du sceau du consensus que de celui d’une série continue de polarisations s’exprimant de manière diverse.
La chute de Ben Ali, le 14 janvier 2011, a semblé réconcilier plusieurs Tunisie, autour d’un unanimisme révolutionnaire rappelant peut-être les premiers moments de la lutte pour l’indépendance. Islamistes, mouvement syndical, formations de gauche et d’extrême gauche, libéraux : l’heure fut un moment à la communion. Les grands slogans ne font cependant pas les grandes révolutions, et le simple accord autour de valeurs fondatrices – la liberté, la démocratie, une nouvelle constitution, le dépassement du système autoritaire – ne suffit naturellement pas à unifier, sur un temps historique long, les acteurs politiques autour d’une vision homogène des grands défis de la transition démocratique, ce dernier concept ne définissant au passage pas grand-chose, si ce n’est l’idée d’un moment traversant un avant et un après. La révolution a ainsi fait œuvre – en toute logique – de division. Le mythe d’un peuple mobilisé contre sa dictature, quelques jours après le départ du président Ben Ali pour l’Arabie saoudite, a rapidement pris fin : de la plèbe aux élites, on eut tôt fait de s’apercevoir ce que le concept de peuple pouvait aussi avoir d’illusoire. De nouvelles polarisations sont apparues. D’anciennes ne cessent encore de faire surface. Ces oppositions sont loin d’être le signe d’un échec ou d’un essoufflement de la dynamique née en décembre 2010 à Sidi Bouzid, bien au contraire. Mais il s’agit de les sérier, pour rendre intelligible le processus actuel. Ce sont, en apparence, pour l’observateur non averti, de nouvelles frontières politiques, sociales, culturelles, qui se dessinent. Mais elles recoupent souvent, pour tout ou partie, celles du passé, les recomposant et leur donnant un nouveau visage.
La révolution s’est, jusqu’à maintenant, découpée en quatre temps distincts. Ils témoignent, dans leur chronologie précipitée, de ce processus de scission progressive du corps social institutionnellement contenue, après les premiers moments de l’unanimisme révolutionnaire. Il y a d’abord le temps de l’insurrection, de décembre 2010 à janvier 2011 : c’est un moment de conquête de l’unité nationale, envers et contre le régime. En une montée vers la capitale aussi rapide qu’inattendue, la contestation d’abord isolée des provinces paupérisées du centre de la Tunisie, relayée par les réseaux sociaux, s’adjoint peu à peu le soutien d’une partie des classes moyennes et de l’ensemble du mouvement syndical, et semble un moment réunir un pays face à un régime qui ne peut, dans son dernier souffle, mobiliser son propre appareil partisan.
La chute de Ben Ali ouvre alors une série de césures tout à la fois identitaires, culturelles, politiques, et économico-sociales. Le second moment de la révolution tunisienne, qui court du 17 janvier à la fin février 2011, est celui d’un affaissement continu de la souveraineté étatique. Les deux premiers gouvernements de Muhammed Ghannoushi, ancien Premier ministre de Ben Ali, font face à une contestation populaire d’ampleur en réclamant la démission. Paradoxalement, la radicalité des revendications affirmées à l’époque ne débouche pas sur une extension des « passions révolutionnaires » (Meyer, 2002), mais bien plutôt, à partir de mars 2011, sur un singulier compromis entre une logique réformiste de redressement de l’autorité étatique, sous l’autorité d’un ancien ministre de l’Intérieur de Bourguiba, Béji Caïd Essebsi, et une persistance des revendications révolutionnaires, cependant institutionnellement contenues. La quatrième période de la révolution tunisienne s’est ouverte en octobre 2011, avec l’élection d’une Assemblée nationale constituante. Ce qui fait office de rupture – le chemin d’une seconde République tunisienne est désormais ouvert – a également en tout point l’allure de la continuité : l’actuel gouvernement de Hamadi Jebeli semble s’inscrire dans une culture du compromis, à l’instar de celui de Béji Caïd Essebsi : compromis ne tenant pas forcément aux questions religieuses et identitaires, mais bien plutôt aux orientations économiques et politiques de ses prédécesseurs. Ces quatre séquences de la révolution tunisienne dessinent un schéma d’une simplicité frappante : de nouvelles élites politiques, issues des anciennes oppositions au bourguibisme et au benalisme, privilégiant une logique de négociation prudente avec les anciennes, préfèrent la logique de la stabilité politique et institutionnelle à celle de la rupture trop brusque avec l’ancien système. Réaliser les objectifs de la révolution signifie, ipso facto, devoir y mettre progressivement fin. En Tunisie, le sens caché de la révolution tient parfois dans sa volonté de ne pas vouloir être.
L’assassinat par balles, devant son domicile, de Choukri Belaïd, leader du Parti des patriotes démocrates unifiés (Watad) et figure de proue de la gauche révolutionnaire, le 6 février 2013, marque un changement d’époque, et, peut-être, le commencement du cinquième acte de la révolution tunisienne. Ce meurtre a provoqué un vif émoi dans le pays. Les assassinats politiques ne relèvent pas d’une pratique courante en Tunisie, même du temps de la dictature : un seuil symbolique a donc été franchi. Il a réunifié un moment les différents acteurs de la gauche et des « laïcs » tunisiens, unanimes à condamner tout à la fois les groupes salafistes et ce qu’ils considèrent comme un laisser-faire sécuritaire d’Ennahda et du gouvernement. Il a renforcé une tendance prégnante à la polarisation de plus en plus accrue entre islamistes et non-islamistes, tout en ouvrant une période d’incertitude institutionnelle caractérisée par le recours de plus en plus courant à la violence politique. Il a montré que la gauche radicale tunisienne, unifiée dans le Front populaire, qu’on disait morte quelques mois auparavant, est désormais aussi un acteur politique de poids, disputant à une mouvance salafiste implantée dans les couches les plus précarisées de la société tunisienne, le monopole d’une « troisième voie » aux destouriens et à Ennahda. Il a enfin confirmé qu’Ennahda est désormais divisé entre deux lignes : celle, pragmatique, incarnée par l’ancien chef du gouvernement, Hamadi Jebeli, mais cependant minoritaire, et celle, maximaliste, d’une autre partie de sa direction. Il augure donc, dans toute sa tragédie, d’une probable recomposition globale du paysage politique tunisien, tout en étant le signe d’une crise identitaire qui se prolongera sans doute dans le temps.
La politique d’accommodement progressif avec les élites politiques et économiques de l’ancien système, souvent dépeinte sous le jour d’une nécessaire « réconciliation nationale », provoque en retour réactions et oppositions aux différents gouvernements transitoires, au-delà même de leurs différences politiques et idéologiques. S’il y a bien eu chute du régime, il n’en reste pas moins que la structure administrative et politique du benalisme est encore debout. Le fonctionnement actuel de certains ministères, en premier lieu celui de l’Intérieur, tout comme de certains médias, montre une forte capacité de résilience du système passé. Dans le même temps, l’ancien parti au pouvoir, le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), n’est pas mort : il se recompose politiquement, en éliminant la référence à Ben Ali, mais en réactivant l’image mythique d’un bourguibisme traité parfois sur un mode nostalgique. Certains de ses anciens membres préfèrent quant à eux négocier directement avec le mouvement Ennahda, dont ils saisissent sans peine qu’il est bien un acteur incontournable, si ce n’est déterminant, du système politique à venir.
Or, depuis le début de la révolution, la question de comment traiter et en finir avec l’ancien régime ne cesse de tarauder tant les gouvernements de transition que la société civile : il y a bien une frontière progressive qui se crée entre ceux qui mettent en avant la lutte contre l’impunité et la demande de justice d’une part, qui s’inscrivent donc dans une logique de rupture radicale, et ceux qui prônent une réconciliation nationale progressive avec de larges factions de l’ancien parti au pouvoir. Que faire de l’ancien système est devenu une question qui divise.
La seconde césure progressive qui est en train de se créer est celle entre le mouvement islamiste Ennahda et ses opposants, des libéraux à l’extrême gauche, en passant par la mouvance syndicale de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) [9]. Elle reste fondée sur un registre des peurs et des passions, entre deux Tunisie, l’une séculière, se réclamant d’un « modernisme » (al-Hadâtha) à la tunisienne, l’autre sans doute plus attachée au référent islamique. Cependant, rien n’est tout à fait manichéen, et il y a, dans cette dichotomie créée entre une Tunisie « moderniste » et une Tunisie « conservatrice », quelque chose d’arbitraire : les mouvements de gauche et de centre gauche se retrouvent aujourd’hui divisés entre partisans d’un dialogue avec le mouvement Ennahda, dans le cadre d’un gouvernement d’union nationale – c’est le cas du Congrès pour la République et d’Ettakatol – et ceux favorables à la constitution d’un nouveau bloc centriste, pouvant éventuellement s’allier aux formations politiques issues du RCD, afin de contrer l’hégémonie progressive du mouvement islamiste. De même, les islamistes sont soumis à deux tentations : une partie d’entre eux s’inscrit apparemment bien dans une logique de construction patiente d’un cadre démocratique, et privilégie pour cela le dialogue avec des acteurs politiques issus du centre gauche ou des libéraux, tandis qu’une autre partie de leur direction semble de plus en plus tentée par une radicalisation fondamentaliste, si ce n’est par une volonté hégémonique et autoritaire. En forme de troisième voie, la gauche radicale, unifiée depuis l’été 2012 dans le Front populaire, refuse la bipolarité du système politique, entre conservateurs islamistes et libéraux néo-bourguibistes, et tente de surfer sur la vague croissante de contestation sociale dans le pays. Dans tous les cas, la polarisation progressive entre islamistes et non-islamistes a une conséquence fondamentale : elle tend à limiter les débats de la conjoncture politique actuelle à la problématique sécularisme/religion, alors même que la révolution du 14 janvier avait mis en valeur la question sociale, au travers notamment de la révolte des régions centrales, précarisés et marginalisées, de la Tunisie, et la cause, devenue peu à peu mobilisatrice, des diplômés-chômeurs.
Tout ceci conduit à la dernière frontière fondatrice de la révolution tunisienne : celle qui semble aujourd’hui opposer, géographiquement et socialement, deux Tunisie. Berceaux de la révolution du 14 janvier, les régions centrales n’ont pas cessé leur révolte depuis. Si islamistes et non-islamistes semblent s’opposer autour des valeurs et des questions identitaires, ils s’accordent au moins sur un point : l’oubli et la négligence des régions périphériques. Cela se traduit notamment par des orientations économiques assez similaires entre les différentes formations présentes à l’Assemblée nationale constituante, au-delà de leurs références idéologiques propres. Encore en ébullition, marquées par des grèves à répétition et des manifestations parfois violentes, ces régions centrales pourraient bien, appuyées sur une partie du mouvement syndical, faire montre d’une radicalité mettant en péril la stabilité – déjà pourtant toute relative – des gouvernements présents et futurs.
L’ensemble de ces nouvelles questions et frontières politiques – entre les partisans d’un compromis relatif avec l’appareil de l’ancien régime et ceux d’une lutte plus radicale contre ses derniers restes, entre les tenants d’une Tunisie plus fortement orientée sur des valeurs islamiques et ceux d’une Tunisie plus « moderniste », avec tout ce que ce dernier terme peut avoir de flou, enfin entre les régions paupérisées du centre et de l’ouest de la Tunisie, bastions de l’insurrection de décembre 2010, et une capitale et des provinces côtières plus favorisées – caractérisent la conjoncture présente. Ces trois césures vont s’installer, sans doute, dans un temps long. Clivant tout à la fois les partis politiques, la société civile, les régions, les classes sociales, elles nous obligent à préférer encore le terme de révolution à celui de postrévolution. La seconde est synonyme d’une certaine stabilité économique, politique et institutionnelle, qui n’est actuellement pas encore à l’œuvre. La première, au contraire, exige de penser l’ensemble des rapports de force et des clivages présents, moins marqués du sceau du consensus que de celui d’une série continue de polarisations s’exprimant de manière diverse.
La révolution tunisienne : une actualisation du passé
Pour saisir l’essence de ces débats et fractures, sans doute faut- il se départir d’une vision par trop téléologique et positiviste de l’histoire : celle qui a vu dans les soulèvements arabes l’émergence d’un « nouveau absolu ». Une certaine tendance perceptible dans les milieux autant académiques que médiatiques a parfois présenté les insurrections arabes sous un jour tout à la fois « postmoderne » et « New Age » : limitant leurs seules revendications à celles de la liberté et de la démocratie, elles auraient brisé le cercle, considéré comme infernal, des grandes utopies gauchistes, tiers-mondistes, nationalistes arabes et islamistes, en se présentant comme fondamentalement désidéologisées, et sans leaders charismatiques reconnues. Révolutions « Facebook » et soulèvements « twiterrisés », si ce n’est prônant une nouvelle forme d’individualisme éloigné de tout projet politique collectif, elles ne s’inscriraient pas du tout dans la conjoncture de la crise systémique du capitalisme globalisé, échapperaient à la question sociale et économique, se focalisant exclusivement sur la dénonciation de la corruption prédatrice des anciennes élites du régime, et ne se limiteraient qu’à souhaiter rejoindre le grand train majestueux de la démocratie libérale. Les héros fondateurs de la révolution tunisienne se retrouveraient alors plus dans les animateurs des réseaux sociaux dématérialisés que dans la jeunesse précarisée des gouvernorats de Sidi Bouzid et de Kasserine. Les révolutions arabes exprimeraient alors en tout point un nouveau paradigme, balayant le passé. L’expression désormais couramment employée « d’hiver islamiste », en forme de déception, qui aurait prétendument succédé au « printemps arabe », n’est que l’autre facette, en négatif, de ce processus rétrospectif d’idéalisation des premiers moments des révolutions arabes.
Or, la révolution tunisienne ne fut pas hors sol : elle n’a en réalité jamais cessé d’actualiser le passé. Ce faisant, elle a rouvert le large dossier des « affaires non classées » (Bensaïd, 2009). Les fantômes de son histoire contemporaine, ses acteurs principaux, ne furent point tous éliminés sous le rouleau compresseur d’une téléologie libérale en forme de « fin de l’histoire ». Le paysage politique tunisien actuel en est une confirmation flagrante : la génération islamiste arrivée aujourd’hui au pouvoir n’est pas celle de la révolution informatique. Le neuvième congrès d’Ennahda a remis en scène une génération ancienne, qui est aujourd’hui au cœur du politique. Ses adversaires, bénéficiant d’une légitimité électorale ou non, sont nés dans le creuset bourguibiste. Principal dirigeant du Parti républicain [10] et aujourd’hui député à l’Assemblée nationale constituante, Ahmed Nejib Chebbi a expérimenté, tout au long d’une longue carrière d’opposant au pouvoir, de nombreuses gammes d’idéologies politiques : d’abord proche de la mouvance baathiste, il est l’un des dirigeants du Travailleur tunisien (al-‘Âmil at-tûnisî), principale formation de l’extrême gauche tunisienne dans les années 1970 (Bouguerra, 1993), avant de fonder le Rassemblement socialiste progressiste (RSP) en 1983, en forme de nouvelle expérimentation sociale-démocrate. Premier ministre d’un gouvernement transitoire nommé en février 2011, et dont les attributions se termineront six mois plus tard, Béji Caïd Essebsi, ancien ministre de l’Intérieur, puis de la Défense et des Affaires étrangères, sous Habib Bourguiba, est aujourd’hui devenu le leader probable d’une opposition au mouvement islamiste éclatée et hétérogène politiquement, mais au moins réunie autour d’un commun rejet d’Ennahda au nom d’une Tunisie « moderniste ». Aux élections pour une Assemblée nationale constituante, les principales formations concurrentes n’avaient rien de bien novateur en terme de profil politique : le Front démocratique pour le travail et les libertés, conduit par Mustapha Ben Jaafar, était déjà légalisé avant la révolution, et se réclame de la social- démocratie. Le Mouvement des patriotes démocrates et le Parti des ouvriers communiste tunisien, clandestins avant le mois de janvier 2011, s’inscrivent dans une pensée de type marxiste [11]. Ennahda fait explicitement référence à la longue histoire de l’islam politique. Les listes indépendantes, ou issues du tissu associatif, à l’instar du réseau Doustourna [12], ne purent résister au rouleau compresseur des formations politiques classiques. Seule peut-être la Pétition populaire (al-Arîdha ash-sha’biya), étrange mouvement hétéroclite au début inconnu de tous, conduit par un homme d’affaires résidant à Londres, Hechmi Hamdi, put tirer son épingle du jeu à la grande surprise des observateurs, pour cependant éclater quelques semaines plus tard [13]. Députés, gouverneurs, ministres, diplomates, intellectuels, journalistes : les élites politiques au pouvoir, se réclamant tour à tour d’une pensée « arabo-islamique » ou d’un « modernisme » à la tunisienne renouvelé, ont vite fait d’éclipser la jeune génération des insurgés des journées de décembre 2010 et janvier 2011.
Au-delà du seul corps des professionnels de la politique, tôt ou tard arrivés sur la scène, les tensions à l’œuvre aujourd’hui en Tunisie témoignent toutes d’une certaine « remontée de l’histoire » [14] , ses « contenus profonds » ayant ainsi « la réalité d’une stimulation » (Bloch, 2012, pp 88-89). D’abord dans leur versant identitaire : les divisions des acteurs politiques sur la question de l’identité tunisienne, entre les revendications séculières et laïques d’une partie des formations de gauche et centristes et le caractère islamiste d’Ennahda, renvoient à une tension originelle au nationalisme tunisien lui-même : fasciné par les « Lumières » françaises, le fondateur du Néo-Destour, Habib Bourguiba, ne s’en oppose pas moins, en février 1929, dans les pages de L’étendard tunisien, aux membres de la Section française de l’internationale ouvrière (SFIO) qui enjoignaient les femmes tunisiennes à sortir sans le voile. En une forme de « gallicanisme à la tunisienne » (Frégosi et Zeghal, 2005), l’Etat bourguibiste fut loin de représenter un soi-disant modèle laïc : la Constitution adoptée le premier juin 1959, si elle ne fait pas de la sharia l’une ou la principale source de droit, à l’instar de l’Egypte, n’en précise pas moins, dans son préambule, qu’elle demeure « fidèle aux valeurs de l’islam, à l’unité du Maghreb arabe, à son appartenance à la famille arabe » [15]. Certes, le texte constitutionnel fait preuve d’une certaine ambigüité, étant encore soumis, jusqu’à aujourd’hui, à des interprétations diverses qui néanmoins fondent en partie le consensus national sur l’identité de la Tunisie : on ne sait ainsi exactement si l’islam demeure la religion de la Tunisie, ou de l’Etat lui-même, l’article premier de la Constitution précisant, en une formule très peu sibylline, que « la Tunisie est un pays libre, indépendant et souverain : sa religion est l’islam, sa langue l’arabe et son régime la République » [16]. (Tûnis Dawla hurra, mustaqila, dhâta siâda, al-Islâm Dînuha, wal ‘Arabiya Lughâtuha, wal Jumhûriya Nidhâmuha) [17].
Les relations historiques entre les clercs de l’islam et le mouvement national tunisien témoignent aussi de transversalités prégnantes, entrecoupées de tensions continues : l’assemblée constitutive de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), le 20 janvier 1946, peut ainsi aligner, aux côtés des ténors du mouvement syndical naissant, le Cheikh Fadhel Ben Achour, président de la Khaldounia [18], et le Cheikh Muhammed Salah Enneifer, président de l’Association des jeunes musulmans, proche des Frères musulmans égyptiens (Khaled, 2007, pp 90-91). Dès juillet 1946, le fondateur de l’UGTT, Farhat Hached, semble déjà s’opposer au Cheikh Fadhel Ben Achour : il lui reproche d’accorder une trop grande primauté aux questions religieuses, au détriment du mouvement syndical et national.
Réhabilitée partiellement sous Ben Ali, aujourd’hui citée autant par la mouvance islamiste que par la gauche radicale tunisienne, ayant sans doute ouvert le premier cycle réel de contestation au bourguibisme, la figure de Salah Ben Youssef est aussi emblématique de cette tension interne au nationalisme tunisien, où la religion ne cesse de chercher sa place et sa reconnaissance. Assassiné par les services secrets tunisiens en août 1961 alors qu’il était réfugié en Allemagne, Salah Ben Youssef, fondateur du Parti Néo-Destour en 1934, originaire de la province de Djerba, est, bien plus que son ancien compagnon Habib Bourguiba, inspiré des thèses panarabistes du président égyptien Jamal Abdel Nasser. La politique négociée « d’indépendance par étape » de Bourguiba le révulse : il dénonce, en juin 1955, les conventions franco-tunisiennes reconnues par son ancien partenaire, qui laissent notamment à la France le soin de gérer la sécurité intérieure et extérieure du pays pendant dix ans. Or, le discours de Salah Ben Youssef, au-delà de son panarabisme et de son tiers-mondisme affirmé, accorde une place forte à l’islam. Le 7 octobre 1955, c’est dans l’enceinte de la grande mosquée de la Zeytouna, dans la vieille ville de Tunis, qu’il lance son attaque la plus virulente contre Habib Bourguiba, enrobant sa diatribe d’une verve tout autant nationaliste que religieuse [19].
La place de l’islam dans la future Constitution tunisienne, les tensions qui affleurent aujourd’hui au sein même du champ politique tunisien, font donc largement écho aux spectres revenant du passé. Les élections d’octobre 2011, qui ont vu le mouvement Ennahda obtenir 89 députés sur les 217 que compte l’Assemblée, ont plus confirmé une donne historique qu’elles n’ont infirmé quoi que ce soit : le référent islamique, comme il a taraudé les premiers moments du nationalisme tunisien, ne cessera de faire de même pour la révolution en cours.
La thématique religieuse et identitaire n’est sans doute pas le seul éclat du passé venant se rappeler au présent révolutionnaire. Dès les premiers jours de l’insurrection, l’observateur averti put ainsi se rappeler les figures d’un Farhat Hached, d’un Ahmed Tlili [20], ou d’un Habib Achour [21] : car l’insurrection spontanée d’une partie de la jeunesse précarisée des régions du centre de la Tunisie put aussi se retrouver partiellement structurée par les sections régionales de la centrale syndicale de l’UGTT, dont certaines de ses fédérations – la santé, les postes et télécommunications, l’enseignement primaire et secondaire – étaient devenues, depuis plusieurs années, des bastions de l’opposition de gauche au bourguibisme et au benalisme. Véritable Janus politique, l’UGTT fut au cœur de la constitution de l’Etat bourguibiste – elle fait partie, lors des élections du 23 mars 1956, du Front national constitué autour du Néo-Destour. En même temps, elle en fut parfois l’un de ses plus féroces adversaires. La révolution tunisienne n’a pas dérogé à cette règle, pratiquement unique dans le monde arabe : nul pouvoir ne peut s’y aliéner totalement le mouvement syndical.
Enfin, la géographie de l’insurrection de décembre 2010 ne fit que redessiner une opposition historique et géopolitique bien ancrée. Partant des régions centrales, le soulèvement ne s’étend aux côtes qu’à la suite de la chute du principal bastion industriel du pays, Sfax, le 12 janvier 2011. Tunis, la capitale, fut bien la dernière à tomber. Or, il y a là une singulière réminiscence du passé, opposant, de manière toujours répétée, certaines des régions côtières (Le Sahel, Tunis, Bizerte, et le Cap Bon) aux provinces intérieures. La marginalisation des régions centrales ne fut jamais seulement économique : politiquement, le mariage de Habib Bourguiba et de Zin al-Abidine Ben Ali, tous deux originaires du Sahel, avec des « tunisoises », c’est-à-dire des femmes de la capitale [22], put symboliser un pouvoir côtier laissant, en terme de représentation politique nationale, la part pauvre aux régions intérieures. Mais la coupure géographico-politique entre une côte favorisée et des régions intérieures marginalisées est bien antérieure à l’apparition du bourguibisme, ainsi qu’à la colonisation française, même si cette dernière n’a fait que la renforcer et la favoriser. Elle dessine aussi historiquement une division entre deux mondes longtemps antagonistes, en un schéma tout khaldounien [23], opposant celui, tribal et rural, de l’intérieur, à la citadinité côtière, cœur du pouvoir politique depuis les premières dynasties hafsides au treizième siècle.
L’insurrection de Sidi Bouzid de décembre 2010 fait effet de miroir avec les soulèvements paysans et tribaux des dix-neuvièmes et vingtièmes siècles, même si elle n’en recoupe que partiellement la géographie. L’entrée des troupes françaises en Tunisie, en avril 1881, se fit relativement facilement dans les grands centres urbains du Kef, de Beja, de Tunis et de Bizerte, le nord du pays étant rapidement pacifié. C’est dans les régions du centre et du sud de la Tunisie, mais aussi à Sfax, que l’insurrection contre les troupes françaises se prépare alors, partant notamment de Gabès et de Kairouan. Les tribus nomades et semi-nomades des Nfat, des Hamama, des Frashish, des Banou-Zid, en sont aussi les principales actrices (Cherif, 1980) – le facteur tribal n’ayant par ailleurs pas été complètement étranger au soulèvement de Sidi Bouzid, en décembre 2010. En mars 1954, l’armée française affronte une résistance armée de fellaghas tunisiens implantée dans les villes de Sbeitla, Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa et Matmata, soit, pour l’essentiel, dans des provinces s’étendant du sud-ouest au centre de la Tunisie (Mestiri, 2011, p 69). Dans le bassin minier de Gafsa, bastion historique du mouvement syndical, la ville de Redeyef ne fut pas seulement le principal théâtre d’affrontement, au printemps 2008, d’une insurrection ayant préfiguré, sur bien des points, celle de décembre 2010 : déjà, en 1937, une grève des travailleurs du phosphate était férocement réprimée par les troupes françaises.
L’ambivalence des élites politiques actuelles vis-à-vis de l’ancien régime s’explique enfin par un rapport irrésolu au bourguibisme lui- même : si le RCD apparaît bien comme l’instrument du benalisme, il n’en reste pas moins l’héritier du Parti socialiste destourien. Or, l’héritage autoritaire, en Tunisie, peut tout aussi bien être perçu comme celui de l’indépendance et de la construction nationale. A gauche, ou dans les formations centristes, le passé bourguibiste semble être tout à la fois l’objet d’une détestation, de par son aspect dictatorial, et d’une indéniable fascination, les anciens prisonniers politiques d’hier n’hésitant parfois pas à se présenter aussi comme les « enfants de Bourguiba », fondateur supposé d’une modernité tunisienne qui n’aurait aucun égal dans le monde arabe. Les islamistes d’Ennahda, pourtant les plus farouches opposants à l’ancien président – dont ils ne contestent pas seulement le caractère dictatorial, mais aussi les orientations idéologiques suspectées d’être trop influencées par les « Lumières » françaises – se retrouvent aujourd’hui obligés de composer avec une histoire qu’ils n’ont pas choisie. Décrié, abhorré, ou adoré, Habib Bourguiba a laissé un héritage tenaillant encore, 22 ans après sa mise à l’écart du pouvoir, l’ensemble des acteurs politiques. « Pour, contre, avec, oui, mais pas sans » [24], le « Combattant suprême » ne laisse toujours pas indifférent. Il ne sait plus être aimé, mais il n’arrive pas non plus à être tout à fait détesté.
En somme : si la révolution tunisienne a bien sonné le glas d’une époque en partie révolue – celle du paradigme autoritaire et d’une « théologie politique » faisant des héritiers proclamés des premières indépendances des souverains intouchables – elle a aussi fait œuvre de remémoration et de réactivation d’un passé qui, s’il n’était pas complètement enfoui, n’en attendait pas moins d’être réveillé. Il s’agit peut-être bien aujourd’hui de lier l’étude des conflictualités actuelles à l’œuvre en Tunisie, rendant parfois l’avenir même de la révolution incertain, à certains héritages politiques et historiques pérennes.
Les ouvrages récents sur la Tunisie ne manquent pas, sur le mode de l’essai (Dakhlia, 2011, Ghorbal, 2012) ou de l’enquête journalistique (Puchot, 2012). Ils bénéficient indéniablement, en amont, des études et thèses académiques sur le sujet (Camau et Geisser, 2003, Khiari, 2003, Hibou, 2006, Ayari, 2009), majoritairement issues du champ académique francophone, parues bien avant la chute de Ben Ali. Compagnons du président Bourguiba et acteurs des premiers moments du mouvement national tunisien ne cessent, peu à peu, de publier leurs mémoires (Moalla, 2011, Mestiri, 2011). Les témoignages d’anciens activistes des oppositions au bourguibisme et au benalisme, ou les hommages rendus à certains d’entre eux[25], participent d’une reconstruction du passé dont, sans doute, le régime autoritaire s’évertuait à passer l’histoire sous silence (Naccache, 2009, Ben Hajj Yahia, 2011). La rigueur scientifique, parfois sèche, des sciences sociales, se dispute avec le ton passionné de la geste militante, mais les deux se complètent aujourd’hui, en un corpus textuel déjà riche et inépuisable. Ces lignes ne sauraient donc remplacer le propos de ces chercheurs, journalistes ou militants. Ils ont depuis de nombreuses années, parfois à contre-courant, lorsque la Tunisie ne fascinait pas ou ne fascinait plus, défriché les racines d’un soulèvement qu’il n’était certes pas possible de prévoir. Cet ouvrage n’a donc pas la prétention d’éclairer sous un nouveau jour l’ensemble des causes structurelles de la révolution tunisienne, ou de donner au lecteur une vision tout à fait panoramique, au travers d’une chronologie aussi progressive qu’imparfaite, du processus en cours. Sa seule ambition est de rallier, d’une manière aussi brève que probablement limitée, l’intempestif d’une révolution aux différentes temporalités historiques qui la précède. Au-delà des simples registres de la mémoire militante ou de la recherche – les deux, à tort, se regardent trop souvent en chien de faïence – les mobilisations successives, depuis le début des années 2000, des magistrats, des avocats, des journalistes, des associations tunisiennes de l’immigration, des grévistes de la faim de 2005, mais aussi – et surtout – d’une partie de la population du bassin minier de Gafsa en 2008, dessinaient aussi les contours d’une révolte qui a ouvert de nouveaux possibles. Le soulèvement de décembre 2010 et janvier 2011 n’a pas mis fin à un supposé « désert politique » tunisien, puisqu’en réalité celui-ci n’a jamais existé.
Or, la révolution tunisienne ne fut pas hors sol : elle n’a en réalité jamais cessé d’actualiser le passé. Ce faisant, elle a rouvert le large dossier des « affaires non classées » (Bensaïd, 2009). Les fantômes de son histoire contemporaine, ses acteurs principaux, ne furent point tous éliminés sous le rouleau compresseur d’une téléologie libérale en forme de « fin de l’histoire ». Le paysage politique tunisien actuel en est une confirmation flagrante : la génération islamiste arrivée aujourd’hui au pouvoir n’est pas celle de la révolution informatique. Le neuvième congrès d’Ennahda a remis en scène une génération ancienne, qui est aujourd’hui au cœur du politique. Ses adversaires, bénéficiant d’une légitimité électorale ou non, sont nés dans le creuset bourguibiste. Principal dirigeant du Parti républicain [10] et aujourd’hui député à l’Assemblée nationale constituante, Ahmed Nejib Chebbi a expérimenté, tout au long d’une longue carrière d’opposant au pouvoir, de nombreuses gammes d’idéologies politiques : d’abord proche de la mouvance baathiste, il est l’un des dirigeants du Travailleur tunisien (al-‘Âmil at-tûnisî), principale formation de l’extrême gauche tunisienne dans les années 1970 (Bouguerra, 1993), avant de fonder le Rassemblement socialiste progressiste (RSP) en 1983, en forme de nouvelle expérimentation sociale-démocrate. Premier ministre d’un gouvernement transitoire nommé en février 2011, et dont les attributions se termineront six mois plus tard, Béji Caïd Essebsi, ancien ministre de l’Intérieur, puis de la Défense et des Affaires étrangères, sous Habib Bourguiba, est aujourd’hui devenu le leader probable d’une opposition au mouvement islamiste éclatée et hétérogène politiquement, mais au moins réunie autour d’un commun rejet d’Ennahda au nom d’une Tunisie « moderniste ». Aux élections pour une Assemblée nationale constituante, les principales formations concurrentes n’avaient rien de bien novateur en terme de profil politique : le Front démocratique pour le travail et les libertés, conduit par Mustapha Ben Jaafar, était déjà légalisé avant la révolution, et se réclame de la social- démocratie. Le Mouvement des patriotes démocrates et le Parti des ouvriers communiste tunisien, clandestins avant le mois de janvier 2011, s’inscrivent dans une pensée de type marxiste [11]. Ennahda fait explicitement référence à la longue histoire de l’islam politique. Les listes indépendantes, ou issues du tissu associatif, à l’instar du réseau Doustourna [12], ne purent résister au rouleau compresseur des formations politiques classiques. Seule peut-être la Pétition populaire (al-Arîdha ash-sha’biya), étrange mouvement hétéroclite au début inconnu de tous, conduit par un homme d’affaires résidant à Londres, Hechmi Hamdi, put tirer son épingle du jeu à la grande surprise des observateurs, pour cependant éclater quelques semaines plus tard [13]. Députés, gouverneurs, ministres, diplomates, intellectuels, journalistes : les élites politiques au pouvoir, se réclamant tour à tour d’une pensée « arabo-islamique » ou d’un « modernisme » à la tunisienne renouvelé, ont vite fait d’éclipser la jeune génération des insurgés des journées de décembre 2010 et janvier 2011.
Au-delà du seul corps des professionnels de la politique, tôt ou tard arrivés sur la scène, les tensions à l’œuvre aujourd’hui en Tunisie témoignent toutes d’une certaine « remontée de l’histoire » [14] , ses « contenus profonds » ayant ainsi « la réalité d’une stimulation » (Bloch, 2012, pp 88-89). D’abord dans leur versant identitaire : les divisions des acteurs politiques sur la question de l’identité tunisienne, entre les revendications séculières et laïques d’une partie des formations de gauche et centristes et le caractère islamiste d’Ennahda, renvoient à une tension originelle au nationalisme tunisien lui-même : fasciné par les « Lumières » françaises, le fondateur du Néo-Destour, Habib Bourguiba, ne s’en oppose pas moins, en février 1929, dans les pages de L’étendard tunisien, aux membres de la Section française de l’internationale ouvrière (SFIO) qui enjoignaient les femmes tunisiennes à sortir sans le voile. En une forme de « gallicanisme à la tunisienne » (Frégosi et Zeghal, 2005), l’Etat bourguibiste fut loin de représenter un soi-disant modèle laïc : la Constitution adoptée le premier juin 1959, si elle ne fait pas de la sharia l’une ou la principale source de droit, à l’instar de l’Egypte, n’en précise pas moins, dans son préambule, qu’elle demeure « fidèle aux valeurs de l’islam, à l’unité du Maghreb arabe, à son appartenance à la famille arabe » [15]. Certes, le texte constitutionnel fait preuve d’une certaine ambigüité, étant encore soumis, jusqu’à aujourd’hui, à des interprétations diverses qui néanmoins fondent en partie le consensus national sur l’identité de la Tunisie : on ne sait ainsi exactement si l’islam demeure la religion de la Tunisie, ou de l’Etat lui-même, l’article premier de la Constitution précisant, en une formule très peu sibylline, que « la Tunisie est un pays libre, indépendant et souverain : sa religion est l’islam, sa langue l’arabe et son régime la République » [16]. (Tûnis Dawla hurra, mustaqila, dhâta siâda, al-Islâm Dînuha, wal ‘Arabiya Lughâtuha, wal Jumhûriya Nidhâmuha) [17].
Les relations historiques entre les clercs de l’islam et le mouvement national tunisien témoignent aussi de transversalités prégnantes, entrecoupées de tensions continues : l’assemblée constitutive de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), le 20 janvier 1946, peut ainsi aligner, aux côtés des ténors du mouvement syndical naissant, le Cheikh Fadhel Ben Achour, président de la Khaldounia [18], et le Cheikh Muhammed Salah Enneifer, président de l’Association des jeunes musulmans, proche des Frères musulmans égyptiens (Khaled, 2007, pp 90-91). Dès juillet 1946, le fondateur de l’UGTT, Farhat Hached, semble déjà s’opposer au Cheikh Fadhel Ben Achour : il lui reproche d’accorder une trop grande primauté aux questions religieuses, au détriment du mouvement syndical et national.
Réhabilitée partiellement sous Ben Ali, aujourd’hui citée autant par la mouvance islamiste que par la gauche radicale tunisienne, ayant sans doute ouvert le premier cycle réel de contestation au bourguibisme, la figure de Salah Ben Youssef est aussi emblématique de cette tension interne au nationalisme tunisien, où la religion ne cesse de chercher sa place et sa reconnaissance. Assassiné par les services secrets tunisiens en août 1961 alors qu’il était réfugié en Allemagne, Salah Ben Youssef, fondateur du Parti Néo-Destour en 1934, originaire de la province de Djerba, est, bien plus que son ancien compagnon Habib Bourguiba, inspiré des thèses panarabistes du président égyptien Jamal Abdel Nasser. La politique négociée « d’indépendance par étape » de Bourguiba le révulse : il dénonce, en juin 1955, les conventions franco-tunisiennes reconnues par son ancien partenaire, qui laissent notamment à la France le soin de gérer la sécurité intérieure et extérieure du pays pendant dix ans. Or, le discours de Salah Ben Youssef, au-delà de son panarabisme et de son tiers-mondisme affirmé, accorde une place forte à l’islam. Le 7 octobre 1955, c’est dans l’enceinte de la grande mosquée de la Zeytouna, dans la vieille ville de Tunis, qu’il lance son attaque la plus virulente contre Habib Bourguiba, enrobant sa diatribe d’une verve tout autant nationaliste que religieuse [19].
La place de l’islam dans la future Constitution tunisienne, les tensions qui affleurent aujourd’hui au sein même du champ politique tunisien, font donc largement écho aux spectres revenant du passé. Les élections d’octobre 2011, qui ont vu le mouvement Ennahda obtenir 89 députés sur les 217 que compte l’Assemblée, ont plus confirmé une donne historique qu’elles n’ont infirmé quoi que ce soit : le référent islamique, comme il a taraudé les premiers moments du nationalisme tunisien, ne cessera de faire de même pour la révolution en cours.
La thématique religieuse et identitaire n’est sans doute pas le seul éclat du passé venant se rappeler au présent révolutionnaire. Dès les premiers jours de l’insurrection, l’observateur averti put ainsi se rappeler les figures d’un Farhat Hached, d’un Ahmed Tlili [20], ou d’un Habib Achour [21] : car l’insurrection spontanée d’une partie de la jeunesse précarisée des régions du centre de la Tunisie put aussi se retrouver partiellement structurée par les sections régionales de la centrale syndicale de l’UGTT, dont certaines de ses fédérations – la santé, les postes et télécommunications, l’enseignement primaire et secondaire – étaient devenues, depuis plusieurs années, des bastions de l’opposition de gauche au bourguibisme et au benalisme. Véritable Janus politique, l’UGTT fut au cœur de la constitution de l’Etat bourguibiste – elle fait partie, lors des élections du 23 mars 1956, du Front national constitué autour du Néo-Destour. En même temps, elle en fut parfois l’un de ses plus féroces adversaires. La révolution tunisienne n’a pas dérogé à cette règle, pratiquement unique dans le monde arabe : nul pouvoir ne peut s’y aliéner totalement le mouvement syndical.
Enfin, la géographie de l’insurrection de décembre 2010 ne fit que redessiner une opposition historique et géopolitique bien ancrée. Partant des régions centrales, le soulèvement ne s’étend aux côtes qu’à la suite de la chute du principal bastion industriel du pays, Sfax, le 12 janvier 2011. Tunis, la capitale, fut bien la dernière à tomber. Or, il y a là une singulière réminiscence du passé, opposant, de manière toujours répétée, certaines des régions côtières (Le Sahel, Tunis, Bizerte, et le Cap Bon) aux provinces intérieures. La marginalisation des régions centrales ne fut jamais seulement économique : politiquement, le mariage de Habib Bourguiba et de Zin al-Abidine Ben Ali, tous deux originaires du Sahel, avec des « tunisoises », c’est-à-dire des femmes de la capitale [22], put symboliser un pouvoir côtier laissant, en terme de représentation politique nationale, la part pauvre aux régions intérieures. Mais la coupure géographico-politique entre une côte favorisée et des régions intérieures marginalisées est bien antérieure à l’apparition du bourguibisme, ainsi qu’à la colonisation française, même si cette dernière n’a fait que la renforcer et la favoriser. Elle dessine aussi historiquement une division entre deux mondes longtemps antagonistes, en un schéma tout khaldounien [23], opposant celui, tribal et rural, de l’intérieur, à la citadinité côtière, cœur du pouvoir politique depuis les premières dynasties hafsides au treizième siècle.
L’insurrection de Sidi Bouzid de décembre 2010 fait effet de miroir avec les soulèvements paysans et tribaux des dix-neuvièmes et vingtièmes siècles, même si elle n’en recoupe que partiellement la géographie. L’entrée des troupes françaises en Tunisie, en avril 1881, se fit relativement facilement dans les grands centres urbains du Kef, de Beja, de Tunis et de Bizerte, le nord du pays étant rapidement pacifié. C’est dans les régions du centre et du sud de la Tunisie, mais aussi à Sfax, que l’insurrection contre les troupes françaises se prépare alors, partant notamment de Gabès et de Kairouan. Les tribus nomades et semi-nomades des Nfat, des Hamama, des Frashish, des Banou-Zid, en sont aussi les principales actrices (Cherif, 1980) – le facteur tribal n’ayant par ailleurs pas été complètement étranger au soulèvement de Sidi Bouzid, en décembre 2010. En mars 1954, l’armée française affronte une résistance armée de fellaghas tunisiens implantée dans les villes de Sbeitla, Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa et Matmata, soit, pour l’essentiel, dans des provinces s’étendant du sud-ouest au centre de la Tunisie (Mestiri, 2011, p 69). Dans le bassin minier de Gafsa, bastion historique du mouvement syndical, la ville de Redeyef ne fut pas seulement le principal théâtre d’affrontement, au printemps 2008, d’une insurrection ayant préfiguré, sur bien des points, celle de décembre 2010 : déjà, en 1937, une grève des travailleurs du phosphate était férocement réprimée par les troupes françaises.
L’ambivalence des élites politiques actuelles vis-à-vis de l’ancien régime s’explique enfin par un rapport irrésolu au bourguibisme lui- même : si le RCD apparaît bien comme l’instrument du benalisme, il n’en reste pas moins l’héritier du Parti socialiste destourien. Or, l’héritage autoritaire, en Tunisie, peut tout aussi bien être perçu comme celui de l’indépendance et de la construction nationale. A gauche, ou dans les formations centristes, le passé bourguibiste semble être tout à la fois l’objet d’une détestation, de par son aspect dictatorial, et d’une indéniable fascination, les anciens prisonniers politiques d’hier n’hésitant parfois pas à se présenter aussi comme les « enfants de Bourguiba », fondateur supposé d’une modernité tunisienne qui n’aurait aucun égal dans le monde arabe. Les islamistes d’Ennahda, pourtant les plus farouches opposants à l’ancien président – dont ils ne contestent pas seulement le caractère dictatorial, mais aussi les orientations idéologiques suspectées d’être trop influencées par les « Lumières » françaises – se retrouvent aujourd’hui obligés de composer avec une histoire qu’ils n’ont pas choisie. Décrié, abhorré, ou adoré, Habib Bourguiba a laissé un héritage tenaillant encore, 22 ans après sa mise à l’écart du pouvoir, l’ensemble des acteurs politiques. « Pour, contre, avec, oui, mais pas sans » [24], le « Combattant suprême » ne laisse toujours pas indifférent. Il ne sait plus être aimé, mais il n’arrive pas non plus à être tout à fait détesté.
En somme : si la révolution tunisienne a bien sonné le glas d’une époque en partie révolue – celle du paradigme autoritaire et d’une « théologie politique » faisant des héritiers proclamés des premières indépendances des souverains intouchables – elle a aussi fait œuvre de remémoration et de réactivation d’un passé qui, s’il n’était pas complètement enfoui, n’en attendait pas moins d’être réveillé. Il s’agit peut-être bien aujourd’hui de lier l’étude des conflictualités actuelles à l’œuvre en Tunisie, rendant parfois l’avenir même de la révolution incertain, à certains héritages politiques et historiques pérennes.
Les ouvrages récents sur la Tunisie ne manquent pas, sur le mode de l’essai (Dakhlia, 2011, Ghorbal, 2012) ou de l’enquête journalistique (Puchot, 2012). Ils bénéficient indéniablement, en amont, des études et thèses académiques sur le sujet (Camau et Geisser, 2003, Khiari, 2003, Hibou, 2006, Ayari, 2009), majoritairement issues du champ académique francophone, parues bien avant la chute de Ben Ali. Compagnons du président Bourguiba et acteurs des premiers moments du mouvement national tunisien ne cessent, peu à peu, de publier leurs mémoires (Moalla, 2011, Mestiri, 2011). Les témoignages d’anciens activistes des oppositions au bourguibisme et au benalisme, ou les hommages rendus à certains d’entre eux[25], participent d’une reconstruction du passé dont, sans doute, le régime autoritaire s’évertuait à passer l’histoire sous silence (Naccache, 2009, Ben Hajj Yahia, 2011). La rigueur scientifique, parfois sèche, des sciences sociales, se dispute avec le ton passionné de la geste militante, mais les deux se complètent aujourd’hui, en un corpus textuel déjà riche et inépuisable. Ces lignes ne sauraient donc remplacer le propos de ces chercheurs, journalistes ou militants. Ils ont depuis de nombreuses années, parfois à contre-courant, lorsque la Tunisie ne fascinait pas ou ne fascinait plus, défriché les racines d’un soulèvement qu’il n’était certes pas possible de prévoir. Cet ouvrage n’a donc pas la prétention d’éclairer sous un nouveau jour l’ensemble des causes structurelles de la révolution tunisienne, ou de donner au lecteur une vision tout à fait panoramique, au travers d’une chronologie aussi progressive qu’imparfaite, du processus en cours. Sa seule ambition est de rallier, d’une manière aussi brève que probablement limitée, l’intempestif d’une révolution aux différentes temporalités historiques qui la précède. Au-delà des simples registres de la mémoire militante ou de la recherche – les deux, à tort, se regardent trop souvent en chien de faïence – les mobilisations successives, depuis le début des années 2000, des magistrats, des avocats, des journalistes, des associations tunisiennes de l’immigration, des grévistes de la faim de 2005, mais aussi – et surtout – d’une partie de la population du bassin minier de Gafsa en 2008, dessinaient aussi les contours d’une révolte qui a ouvert de nouveaux possibles. Le soulèvement de décembre 2010 et janvier 2011 n’a pas mis fin à un supposé « désert politique » tunisien, puisqu’en réalité celui-ci n’a jamais existé.
[1] Ennahda signifie « la Renaissance ».
[2] Salah Karker est décédé quelques mois plus tard, le 18 octobre 2012.
[3] Harakat al-Ittijâh al-islâmî.
[4] Al-Mujâhid al-akbar.
[5] Jusqu’au milieu des années 1980, c’est l’Union générale des étudiants de Tunisie (UGET, al-Ittihâd al-‘âm lit-Talabat Tûnis) qui est le principal syndicat étudiant. Fondée en 1952, l’UGET est au départ relativement contrôlée par le Parti Néo-Destour de Habib Bourguiba. Elle devient cependant, au cours des années 1960 et 1970, un des bastions de l’opposition de gauche au régime, prenant la majorité de la direction du syndicat étudiant lors du Congrès de Korba, en 1971. C’est en 1986 qu’est créée l’Union générale tunisienne des étudiants (UGTE, al-Ittihâd al-‘âm at-tûnisî lit-Talaba), proche du Mouvement de la tendance islamique (ath-Thâbiti, 2011).
[6] Le Néo-Destour a été fondé le 2 mars 1934 lors du Congrès de Ksar Hellal. Il est issu d’une scission du Parti libéral constitutionnel (Destour), fondé en 1920. Le Parti Néo-Destour (al-Hezb ad-dustûrî al-jadîd), devient, en 1964, le Parti socialiste destourien (PSD, al-Hezb ad-ishtirâkî ad-dustûrî). Ce n’est qu’en 1987 qu’il prend le nom de Rassemblement constitutionnel démocratique (at- Tajamu’ ad-dustûrî ad-dimuqrâtî), une fois Habib Bourguiba écarté du pouvoir.
[7] Le Congrès pour la République (al-Mu’tamar min-ajl al-Jumhûriya) est né en 2001. Il regroupe, à l’origine, des activistes issus tant de la gauche tunisienne que du nationalisme arabe, voire même de l’islam politique. Son principal fondateur, Moncef Marzouki, est devenu président de la République tunisienne en décembre 2011. Le Front démocratique pour le travail et les libertés (FDTL, Ettakatol), a été fondé en avril 1994. Il est affilié à l’Internationale socialiste (IS). Son secrétaire général, Mustapha Ben Jaafar, est devenu président de l’Assemblée nationale constituante en décembre 2011.
[8] Ali Laraidh a été nommé chef du gouvernement, en remplacement de Hamadi Jebeli, le 22 février 2013.
[9] Al-Ittihâd al-‘âm at-tûnisî lish-Shughl.
[10] Le Parti républicain (al-Hezb al-jumhûrî) est né le 9 avril 2012 de la fusion de neuf formations centristes et de centre gauche, dont le Parti démocratique progressiste, dirigé par Ahmed Nejib Chebbi, né en juin 2001.
[11] url:http://www.lescahiersdelislam.fr/admin/page/5374984/#_ftnref2 Le Mouvement des patriotes démocrates (Watad) et le Parti des ouvriers communiste tunisien disposent respectivement, au sein de l’Assemblée nationale constituante, de 2 et 3 députés. En juillet 2012, le POCT a pris le nom de Parti des travailleurs (Hezb al-‘Ummâl). En septembre 2012, le Mouvement des patriotes démocrates s’est unifié avec la majorité du Parti du travail patriotique et démocratique (PTPD).
[12] Doustourna signifie « Notre constitution ». Emmenée par un jeune juriste, Jawhar Ben Mbareck, cette liste n’a pas réussi à avoir d’élus aux élections d’octobre 2011.
[13] La Pétition populaire pour la liberté, la justice et le développement a été troisième aux élections d’octobre 2011, remportant 29 députés. Une fois les travaux de l’Assemblée nationale constituante entamés, elle éclate en plusieurs tendances.
[14] Le concept de « remontée de l’histoire » nous est rapporté par Nadine Méouchy, historienne à l’Institut français du Proche-Orient (IFPO). Il aurait été employé par l’historien français Dominique Chevallier, lors d’une conférence tenue en 1976 sur la guerre civile libanaise.
[15] http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/constitution/const1000p.htm (en français).
[16] http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/constitution/const1005p.htm (en français).
[17] Pour une version en arabe de la Constitution : http://wrcati.cawtar.org/preview.php?type=law&ID=11&fb_source=message
[18] Située non loin de la mosquée de la Zeytouna, dans le centre de Tunis, l’école de la Khaldounia, du nom de l’historien maghrébin Ibn Khaldoun, a été fondée en 1896.
[19] Sur l’affrontement entre Habib Bourguiba et Salah Ben Youssef et les événements d’octobre 1955, voir Bessis et Belhassen, 2012, pp 211-212. Sur la constitution du mouvement yousséfiste en Tunisie, voir at-Turki, 2011, et as-Saghîr, 2011.
[20] Originaire de Gafsa, Ahmed Tlili fut un des responsables de la lutte armée en Tunisie contre les autorités françaises au début des années 1950. Il a été secrétaire général de l’UGTT de 1957 à 1963.
[21] Originaire de Kerkennah, à l’est de la Tunisie, Habib Achour fut l’un des fondateurs de l’UGTT, en 1946. Trois fois secrétaire général de l’organisation syndicale, il est emprisonné par le pouvoir en janvier 1978, suite à une série de manifestations dirigées contre les politiques libérales du Premier ministre Hédi Nouira. Il est libéré un an plus tard. En 1985, il est assigné à résidence, après les manifestations contre l’augmentation du prix du pain de décembre 1983 et janvier 1984 et un nouveau bras de fer entre le gouvernement Mzali et l’UGTT.
[22] Wassila Ben Ammar épouse Habib Bourguiba en 1962. Elle est issue d’une des grandes familles de la capitale. Originaire de la Médina de Tunis, Leyla Trabelsi, mariée au président Ben Ali en 1992, est issue d’un milieu bien plus modeste.
[23] Du nom de l’historien maghrébin Ibn Khaldoun, né à Tunis en 1332. Sur les interprétations contemporaines des théories khaldouniennes, voir Ihaddaden, 2001, et Lacoste, 2009.
[24] L’expression fut autrefois régulièrement utilisée par le philosophe français Daniel Bensaïd.
[25] Voir l’ouvrage consacré à Ahmed Othmani, ancien militant de l’extrême gauche tunisienne, fondateur, au début des années 1980, de la section tunisienne d’Amnesty International et ancien président de Penal Reform International (PRI), Collectif, 2012.
Références
AYARI Michaël Béchir, S’engager en régime autoritaire. Gauchistes et islamistes dans la Tunisie indépendante, Thèse de doctorat en Sciences politiques, sous la direction de Michel Camau, Université Paul Cézanne/Aix Marseille III, janvier 2009
BEN HAJ YAHIA Fathi, La gamelle et le couffin. Fragments d’une histoire de la gauche au temps de Bourguiba, Editions Mots passants, Tunis, 2010
BENSAÏD Daniel, « il y a 580 ans, la naissance d’un mythe : Jeanne la revenante », Alternative libertaire, 2009
BESSIS Sophie et BELHASSEN Souhayr, Bourguiba, Editions Elyzad, Tunis, 2012
BLOCH Ernst, Thomas Münzer, théologien de la révolution, Les prairies ordinaires, Paris, 2012
BOUGUERRA Abdel Jalil, Min Târîkh al-Yasâr at-tûnisî, Harakat Afâq 1963-1975 (Sur l’histoire de la gauche tunisienne, le Mouvement Perspectives, 1963-1975), Cérès Editions, Tunis, 1993
CAMAU Michel et GEISSER Vincent, Le syndrome autoritaire : politique en Tunisie de Bourguiba à Ben Ali, Les Presses de Science Po, Paris, 2003
CHERIF Mohammed-Hadi, « Les mouvements paysans dans la Tunisie du XIXe siècle », in Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, N 30, 1980
COLLECTIF, Ahmed Othmani, une vie militante, Déméter, Tunis, 2012
DAKHLIA Jocelyne, Tunisie. Le pays sans bruit, Editions Acte Sud, Paris, 2011
FREGOSI Franck et ZEGHAL Malika, Religion et politique au Maghreb : les exemples tunisiens et marocains, Introduit par MOHSEN-FINAN Khadija, Institut français des relations internationales (IFRI), Policy Paper 11, mars 2005
GHORBAL Samy, Orphelins de Bourguiba et héritiers du Prophète, Cérès Editions, Tunis, 2011
HIBOU Béatrice, La force de l’obéissance : économie politique de la répression en Tunisie, Editions La Découverte, Paris, 2006
IHADDADEN Zoheir, « Ibn Khaldoun, les modernes et la Asabiya », Oumma.com, 28 juin 2001
KHALED Ahmed, Farhat Hached. Héros de la lutte sociale et nationale, martyr de la liberté (itinéraire, combat, pensée et écrits), Editions Zarâkhef, Tunis, 2007
KHIARI Sadri, Tunisie. Coercition-consentement-résistance : le délitement de la cité, Editions Karthala, Paris, 2003
LACOSTE Yves, Ibn Khaldoun. Naissance de l’histoire, passé du tiers-monde, Editions La Découverte, Paris, 2009
« Manifeste : notre révolution n’est pas une rumeur », Nawaat.org, 21 juin 2012, http://nawaat.org/portail/2012/06/21/manifeste-notre- revolution-nest-pas-une-rumeur/
MESTIRI Ahmed, Témoignage pour l’histoire. Des souvenirs, quelques réflexions et commentaires sur une époque contemporaine de la Tunisie, accessoirement du Maghreb (1940-1990) et sur la Révolution de 2010-2011, Sud Editions, Tunis, 2011
MEYER, Arno J., Les Furies. Violence, vengeance, terreur, au temps de la révolution française et de la révolution russe, Editions Fayard, Paris, 2002
MOALLA Mansour, De l’indépendance à la révolution. Système politique et développement économique en Tunisie, Sud Editions, Tunis, 2011
NACCACHE Gilbert, Qu’as-tu fait de ta jeunesse ? Itinéraires d’un opposant au régime de Bourguiba (1954-1979), suivi de Récits de prison, Editions du Cerf, Paris, 2009
PUCHOT Pierre, La révolution confisquée. Enquête sur la transition démocratique en Tunisie, Sindbad, Acte Sud, Paris, 2012
AS-SAGHÎR ‘Amira Aliya, al-Yûsufiyûn wa Taharur al-Maghreb al-‘arabî (les yousséfistes et la libération du Maghreb arabe), al- Maghâribiya lit-Tabâ’ wa an-Nashr, 2011
AL-THÂBITI ‘Adel, al-Ittihad al-‘âm at-Tûnisî lit-Talaba, Khalfiât at-Ta’sîs wa M’âlât al-Masâr (L’Union générale tunisienne des étudiants, Dessous de la fondation et cheminement), al -Maghâribiya li-Tabâ’ wa Ishâr al-Kitâb, Tunis, 2011
AT-TURKI ‘Arousiya, al-Haraka al-yûsufiya fi Tûnis 1955-1956 (Le mouvement yousséfiste en Tunisie, 1955-1956), Maktabat ‘Ala’ ad- Dîn, Sfax, 2011
BEN HAJ YAHIA Fathi, La gamelle et le couffin. Fragments d’une histoire de la gauche au temps de Bourguiba, Editions Mots passants, Tunis, 2010
BENSAÏD Daniel, « il y a 580 ans, la naissance d’un mythe : Jeanne la revenante », Alternative libertaire, 2009
BESSIS Sophie et BELHASSEN Souhayr, Bourguiba, Editions Elyzad, Tunis, 2012
BLOCH Ernst, Thomas Münzer, théologien de la révolution, Les prairies ordinaires, Paris, 2012
BOUGUERRA Abdel Jalil, Min Târîkh al-Yasâr at-tûnisî, Harakat Afâq 1963-1975 (Sur l’histoire de la gauche tunisienne, le Mouvement Perspectives, 1963-1975), Cérès Editions, Tunis, 1993
CAMAU Michel et GEISSER Vincent, Le syndrome autoritaire : politique en Tunisie de Bourguiba à Ben Ali, Les Presses de Science Po, Paris, 2003
CHERIF Mohammed-Hadi, « Les mouvements paysans dans la Tunisie du XIXe siècle », in Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, N 30, 1980
COLLECTIF, Ahmed Othmani, une vie militante, Déméter, Tunis, 2012
DAKHLIA Jocelyne, Tunisie. Le pays sans bruit, Editions Acte Sud, Paris, 2011
FREGOSI Franck et ZEGHAL Malika, Religion et politique au Maghreb : les exemples tunisiens et marocains, Introduit par MOHSEN-FINAN Khadija, Institut français des relations internationales (IFRI), Policy Paper 11, mars 2005
GHORBAL Samy, Orphelins de Bourguiba et héritiers du Prophète, Cérès Editions, Tunis, 2011
HIBOU Béatrice, La force de l’obéissance : économie politique de la répression en Tunisie, Editions La Découverte, Paris, 2006
IHADDADEN Zoheir, « Ibn Khaldoun, les modernes et la Asabiya », Oumma.com, 28 juin 2001
KHALED Ahmed, Farhat Hached. Héros de la lutte sociale et nationale, martyr de la liberté (itinéraire, combat, pensée et écrits), Editions Zarâkhef, Tunis, 2007
KHIARI Sadri, Tunisie. Coercition-consentement-résistance : le délitement de la cité, Editions Karthala, Paris, 2003
LACOSTE Yves, Ibn Khaldoun. Naissance de l’histoire, passé du tiers-monde, Editions La Découverte, Paris, 2009
« Manifeste : notre révolution n’est pas une rumeur », Nawaat.org, 21 juin 2012, http://nawaat.org/portail/2012/06/21/manifeste-notre- revolution-nest-pas-une-rumeur/
MESTIRI Ahmed, Témoignage pour l’histoire. Des souvenirs, quelques réflexions et commentaires sur une époque contemporaine de la Tunisie, accessoirement du Maghreb (1940-1990) et sur la Révolution de 2010-2011, Sud Editions, Tunis, 2011
MEYER, Arno J., Les Furies. Violence, vengeance, terreur, au temps de la révolution française et de la révolution russe, Editions Fayard, Paris, 2002
MOALLA Mansour, De l’indépendance à la révolution. Système politique et développement économique en Tunisie, Sud Editions, Tunis, 2011
NACCACHE Gilbert, Qu’as-tu fait de ta jeunesse ? Itinéraires d’un opposant au régime de Bourguiba (1954-1979), suivi de Récits de prison, Editions du Cerf, Paris, 2009
PUCHOT Pierre, La révolution confisquée. Enquête sur la transition démocratique en Tunisie, Sindbad, Acte Sud, Paris, 2012
AS-SAGHÎR ‘Amira Aliya, al-Yûsufiyûn wa Taharur al-Maghreb al-‘arabî (les yousséfistes et la libération du Maghreb arabe), al- Maghâribiya lit-Tabâ’ wa an-Nashr, 2011
AL-THÂBITI ‘Adel, al-Ittihad al-‘âm at-Tûnisî lit-Talaba, Khalfiât at-Ta’sîs wa M’âlât al-Masâr (L’Union générale tunisienne des étudiants, Dessous de la fondation et cheminement), al -Maghâribiya li-Tabâ’ wa Ishâr al-Kitâb, Tunis, 2011
AT-TURKI ‘Arousiya, al-Haraka al-yûsufiya fi Tûnis 1955-1956 (Le mouvement yousséfiste en Tunisie, 1955-1956), Maktabat ‘Ala’ ad- Dîn, Sfax, 2011