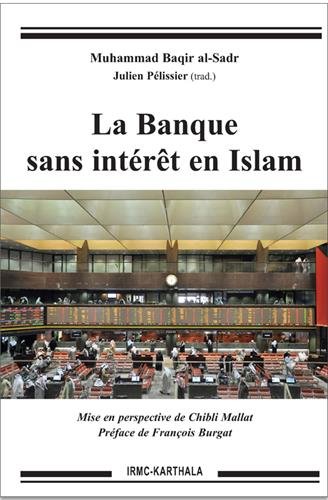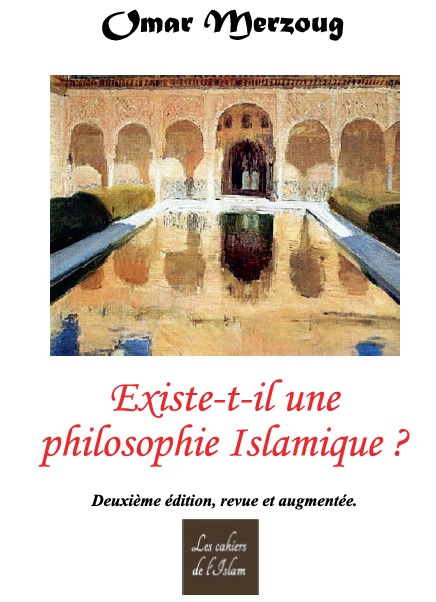Il fallait une solide connaissance du droit musulman classique et contemporain, une grande familiarité avec l’œuvre et le style de MBS, le tout arrimé à une maîtrise technique et historique du lexique français de la finance pour s’atteler à une telle traduction. La combinaison de ces qualités a permis à J. Pélissier de relever ce défi avec une subtilité et une élégance visibles dès son avant-propos ; le résultat en est un texte français certes aussi ardu que sa version originale, mais d’une précision et d’un scrupule linguistique remarquables.
Robin Beaumont
Cette recension a déjà fait l'objet d'une publication dans la Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée , 145 | septembre 2019 sous licence Creative Commons (BY NC SA).
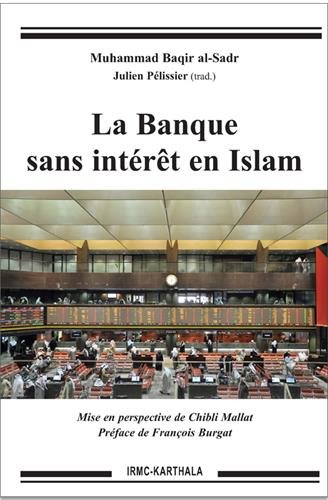
Broché: 216 pages
Editeur : Karthala (22 mars 2017)
Collection : Hommes et Sociétés
Langue : Français
ISBN-10: 2811117938
ISBN-13: 978-2811117931
Editeur : Karthala (22 mars 2017)
Collection : Hommes et Sociétés
Langue : Français
ISBN-10: 2811117938
ISBN-13: 978-2811117931
Figure centrale du renouveau de la pensée politique chiite contemporaine et de l’islam politique de façon plus transversale, Muhammad Bâqir al-Sadr (MBS, 1935-1980) est l’auteur d’une œuvre vaste et diverse qui, bien qu’en partie défrichée dans ses dimensions les plus politiques, demeure très largement méconnue en France. Si le rôle du faqîh (juriste) irakien dans la réforme du séminaire religieux chiite à Najaf dans les années 1950 et 1960 est désormais bien établi, de même que sa participation à la fondation du parti al-Da‘wa et sa contribution à la réflexion sur les institutions de la République islamique d’Iran, son œuvre reste en effet quasi inaccessible en langue française. Cette carence est plus patente encore dès lors que l’on se penche sur sa réflexion économique, et plus particulièrement, au-delà de sa somme Iqtisâdunâ (« notre économie »), sur ses propositions relatives au domaine de la finance islamique. C’est dire si est bienvenue l’excellente traduction que propose aujourd’hui Julien Pélissier aux éditions Karthala/IRMC, pour la première fois dans une langue européenne à l’exception d’une tentative peu satisfaisante en anglais, d’Al-bank al-lâ-ribawî fî-l-islâm (« la banque sans intérêt [ou « non usuraire »] en islam »).
Publié en 1969, cet ouvrage est rédigé par MBS à la demande d’un comité rassemblé par le ministère koweïtien des Waqf. Il constitue à l’époque, et en vérité jusqu’à ce jour, la seule entreprise sérieuse de théorisation d’une pratique bancaire conforme aux obligations islamiques. Contrairement à la plupart des productions savantes en droit musulman, et à d’autres œuvres à caractère programmatique de Sadr lui-même, les références aux textes sacrés et à la tradition exégétique musulmane sont absentes de La Banque sans intérêt : le fondement coranique de la prohibition de l’usure n’y est même pas rappelé. Ici, nulle entreprise théologique de déduction de la norme à partir des sources du droit ou des travaux de juristes antérieurs. Les concepts religieux mobilisés y sont réduits à la portion congrue, et ne font l’objet que d’une définition sommaire : le terme de ribâ ne fait, entre tous, l’objet d’aucun développement sur les réalités qu’il recouvre. Ce faisant, Sadr opère une rupture radicale avec les réflexions engagées depuis la fin du xixe siècle sur la finance islamique, prioritairement au Caire, empêtrées dans de longs débats sur l’acception du ribâ comme « intérêt » ou comme « usure » – cette dernière étant comprise comme un intérêt excessif. Le faqîh irakien ne s’embarrasse d’aucun compromis sémantique : La Banque sans intérêt se veut le fondement de pratiques bancaires débarrassées de toute rémunération fixe et régulière d’un emprunt ou d’un dépôt. Les tentatives plus ou moins habiles de contournement de l’interdit par un « artifice langagier » (p. 144) sont lapidairement déconstruites et disqualifiées en fin de texte, dans la première annexe.
L’ouvrage se distingue ainsi d’emblée par l’articulation d’une intransigeance sur les principes islamiques à une approche pragmatique, presque opérationnelle. Il ne s’agit pas de tirer des principes de la loi religieuse, mais de poser les fondements d’une pratique bancaire conforme à la sharî‘a dans le monde tel qu’il est. Une finance d’où serait banni l’intérêt ne pourrait tout à fait porter ses fruits qu’en tant qu’elle serait intégrée dans une économie entièrement régie par les principes de l’islam ; l’absence d’un tel « système islamique » (p. 43) dans la réalité, cependant, ne justifie aucune compromission vis-à-vis de la loi religieuse. Aussi s’agit-il de « rechercher une solution jurisprudentielle raisonnable » (p. 44) en s’interrogeant sur les modalités d’existence d’une finance respectueuse des principes généraux de la loi islamique, prête à sacrifier une partie de ses gains à la mission religieuse qu’elle sert, mais efficace dans un environnement capitaliste où la banque sans intérêt sera inévitablement concurrencée par l’attractivité de la rémunération du capital assurée par les banques usuraires. MBS s’efforce ainsi de penser une pratique bancaire viable dans le monde contemporain, qui se mette au service d’un intérêt social supérieur à la seule accumulation du gain, et encourage à investir les « capitaux oisifs » dans le travail humain.
Le texte de Sadr, court, consiste en deux grandes parties et une troisième principalement constituée de douze documents annexes, précédées d’une présentation générale de son projet. La première partie est l’occasion pour l’auteur d’exposer le concept phare de sa proposition et le fonctionnement original qu’il entend lui conférer : la mudâraba, que J. Pélissier traduit heureusement par « commandite », relation contractuelle entre un commanditaire (mudârib, ou investisseur, mustathmir), propriétaire d’un capital qu’il investit dans un projet mis en œuvre par un commandité (mudârab, ou agent, ‘âmil). En cas de succès de l’entreprise, les deux parties partagent le profit généré selon des modalités préalablement convenues ; en cas d’échec, l’agent n’a pas à rembourser le capital principal. Originalité du système, seul le mudârib porte ainsi la charge financière du risque de l’investissement. L’innovation de Sadr tient en ce qu’il propose de fondre la double relation contractuelle qu’est devenue en pratique la mudâraba (entre le déposant et la banque d’une part, la banque et l’agent de l’autre) en une seule, entre l’« investisseur-bailleur de fonds » et l’« agent-gestionnaire », au sein de laquelle l’institution bancaire joue un simple rôle d’intermédiaire, notamment en assurant la garantie du dépôt. Les réticences susceptibles d’être générées par le partage du risque et l’absence d’intérêt sont prévenues par divers mécanismes de rétribution du déposant et de la banque. Sadr entend ainsi réhabiliter la commandite islamique comme relation directe du capital au travail. La deuxième partie de l’ouvrage examine les diverses opérations bancaires au regard du système préconisé.
On ne peut ici se livrer, dans les contraintes d’espace d’une recension de traduction, à une critique exhaustive du fond du texte de MBS, dont les limites sont d’ailleurs bien identifiées dans l’avant-propos du traducteur. La financiarisation galopante d’une économie désormais mondialisée rend certains aspects de la réflexion sadrienne un peu datés. Surtout, la concentration de son projet sur un modèle bancaire fondé sur l’investissement néglige d’autres aspects fondamentaux de ce que l’on appellerait aujourd’hui l’« économie réelle », au service de laquelle l’auteur voudrait replacer une institution bancaire trop peu attentive au facteur humain : quelle place, par exemple, dans le système sadrien, pour le soutien à la consommation des ménages ? On voit mal comment l’achat d’un bien immobilier pourrait s’inscrire dans un modèle où le prêt d’un capital est rémunéré par le profit tiré de son investissement… Enfin, bien que soucieux des possibilités d’application des pratiques islamiques dans le monde réel, MBS se dispense de toute réflexion sur l’institutionnalisation de sa proposition et son inscription dans un environnement politique possiblement adverse, alors même que le terme siyâsa (« politique », mais que le traducteur rend plus d’une fois par « gestion ») revient régulièrement pour qualifier son modèle.
Il fallait une solide connaissance du droit musulman classique et contemporain, une grande familiarité avec l’œuvre et le style de MBS, le tout arrimé à une maîtrise technique et historique du lexique français de la finance pour s’atteler à une telle traduction. La combinaison de ces qualités a permis à J. Pélissier de relever ce défi avec une subtilité et une élégance visibles dès son avant-propos ; le résultat en est un texte français certes aussi ardu que sa version originale, mais d’une précision et d’un scrupule linguistique remarquables.
Conscient du travail que représente une telle traduction, on ne se permettra qu’avec humilité de suggérer deux ou trois points sur lesquels l’ouvrage aurait pu gagner davantage en autorité. On ne s’émouvra pas outre mesure des quelques choix de traduction qui s’écartent un peu de la lettre du texte arabe, sans en altérer l’esprit (par exemple l’élimination de tous les qualificatifs laudatifs qui marquent l’emphase classique de la plume de Sadr). Le fait que ne soit traduite qu’une des douze annexes, bien que revendiqué par le traducteur, laisse quelque peu dubitatif. Le lecteur arabophone aurait en outre volontiers accueilli la mention plus systématique de concepts centraux ou de termes techniques en arabe. En leur absence, il est par exemple dommage de devoir se reporter à une édition arabe pour s’assurer des termes que la traduction rend (bien justement) par « intermédiation bancaire », « business-model », etc. On sera davantage chagriné par un travail d’édition manifestement rapide, qui laisse à l’ouvrage un certain nombre de coquilles et autres erreurs typographiques.
La principale critique que l’on se permettra d’adresser à l’ouvrage publié par Karthala et l’IRMC tient à son paratexte, excessivement bref : les quatre propos liminaires au texte de Sadr auraient sans doute été utilement complétés, sinon remplacés, par une longue introduction du traducteur. En l’absence d’un tel travail et d’un appareil critique de plus grande ampleur, le lecteur se trouve assez démuni pour comprendre le propos et les enjeux d’un texte dont on peut supposer que ni les chercheurs en sciences sociales, ni les spécialistes des questions financières, ne disposent des connaissances techniques et historiques pour l’appréhender. On peine ainsi à voir à quel public s’adresse précisément la traduction, qui aurait gagné à prendre la forme (qu’elle ne revendique certes pas) d’une édition commentée au sens plein – mais c’eût été un autre travail que celui-ci, déjà fort riche. La « mise en perspective » de Chibli Mallat devient dès lors le seul guide, certes éclairant, mais limité, pour naviguer dans l’argument sadrien, et de nombreux éléments essentiels sont passés sous silence : le contexte de la rédaction de l’œuvre n’est ainsi pas vraiment abordé, quand la traduction aurait été le lieu propice au développement de l’idée, proposée par C. Mallat dans son travail sur MBS, d’une différence d’objectif entre Notre Économie d’une part – publié au début des années 1960 quand il s’agissait d’abord pour le clergé chiite irakien de contrer l’influence du marxisme –, et La Banque sans intérêt d’autre part, dont la rédaction intervient alors que la pétrodollarisation montante des économies du Golfe fait du capitalisme le nouveau modèle idéologique auquel proposer une alternative [1]. La question de la réception de l’ouvrage et de son poids dans les représentations, les débats et les pratiques actuels des acteurs de la finance en Irak et au-delà n’est qu’à peine évoquée, alors même que la figure de Sadr, auréolée de sa réputation intellectuelle et de son prestige de martyr du régime de Saddam Hussein, est aujourd’hui invoquée de façon quasi systématique par les élites politiques chiites irakiennes. À un niveau plus théorique, on aurait accueilli avec bonheur une réflexion, identifiée par François Burgat dans sa préface, sur ce que le domaine financier peut nous apprendre de la relation fort débattue entre islam politique et modernisation, d’autant qu’il s’agit là d’un aspect singulièrement délaissé par les travaux des politistes sur l’islamisme. J. Pélissier, qui réunit de façon rare les diverses formes d’expertise nécessaires à cette réflexion exigeante, y voit certes une piste à explorer, et pose même la proposition sadrienne comme un projet de modernité alternative à ce dont Patrick Haenni a pu rendre compte quant à l’intégration de l’islam politique dans l’idéologie néo-libérale [2] – mais n’élabore pas de développement sur cette problématique passionnante. En tout état de cause, ces quelques réserves ne constituent qu’un appel à voir mobilisé et travaillé le précieux matériau que nous fournit J. Pélissier dans cette belle et nécessaire traduction, pour explorer une œuvre sadrienne à laquelle la recherche, notamment française, n’a pas encore accordé l’attention qu’elle mérite, et des questions économiques et financières généralement boudées par les sociologues et les historiens des mondes musulmans contemporains.
_____________________
[1] Chibli Mallat, The Renewal of Islamic Law: Muhammad Baqer as-Sadr, Najaf and the Shi‘i International, chapitre 5, « Muhammad Baqer as-Sadr and Islamic banking », Cambridge University Press, 1993.
[2] Patrick Haenni, L’islam de marché : l’autre révolution conservatrice, Seuil, 2005.
[1] Chibli Mallat, The Renewal of Islamic Law: Muhammad Baqer as-Sadr, Najaf and the Shi‘i International, chapitre 5, « Muhammad Baqer as-Sadr and Islamic banking », Cambridge University Press, 1993.
[2] Patrick Haenni, L’islam de marché : l’autre révolution conservatrice, Seuil, 2005.