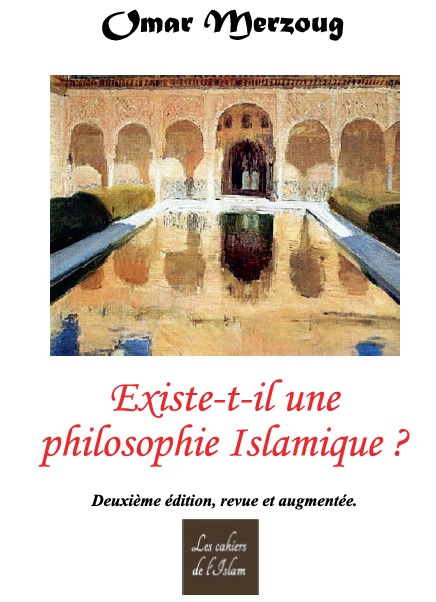De quoi le salafisme est-il le nom ? Si le mot est constamment évoqué, sa réalité historique est souvent mal connue. Il s'agit pourtant de sortir des lectures uniquement géopolitiques du salafisme, pour tenter de rendre la profondeur historique de ce mouvement.
Retour sur l'évolution et les idées de ce courant de l'islam contemporain avec Daoud Riffi, professeur agrégé, chercheur en histoire du monde arabe contemporain et éditeur, qui prépare « Une Histoire critique du salafisme » à paraître en 2020.
Entretien par Ornella Sukkar, Journaliste libanaise spécialisée dans le monde arabe et les questions d'islamisme, le dialogue entre les différentes cultures et civilisations pour le maintien de la paix entre le deux rives de la Méditerranée..
Retour sur l'évolution et les idées de ce courant de l'islam contemporain avec Daoud Riffi, professeur agrégé, chercheur en histoire du monde arabe contemporain et éditeur, qui prépare « Une Histoire critique du salafisme » à paraître en 2020.
Entretien par Ornella Sukkar, Journaliste libanaise spécialisée dans le monde arabe et les questions d'islamisme, le dialogue entre les différentes cultures et civilisations pour le maintien de la paix entre le deux rives de la Méditerranée..

Daoud Riffi
Daoud Riffi , Professeur agrégé, chercheur en histoire et éditeur (éditions Tasnîm). Son travail porte sur l’histoire intellectuelle du monde arabe contemporain (18e-20e siècle), dans trois domaines : le soufisme au Maghreb et en Europe depuis la fin du 19e siècle ; le salafisme et ses courants ; le milieu intellectuel colonial. Avec les éditions Tasnîm, il propose au lectorat francophone certaines des œuvres majeures du patrimoine spirituel et intellectuel de l’Islam.
Le salafisme est devenu un terme polémique : de quoi parle-t-on ?
"Salafisme", pour nous aujourd'hui, c’est essentiellement deux choses : le djihadisme ; un courant religieux prônant le retour aux Sources de l'islam (Coran et Sunna). Mais "salafisme" – de salafiyya en arabe – renvoie à l'origine à la fois à une période historique et à un courant théologique. La période historique est celle d' al-salaf al-sâlih, les « vertueux Anciens » : les trois premières générations de savants de l'Islam, réputées pour leur compréhension profonde du Coran et de la tradition prophétique. Le courant théologique renvoie quant à lui à l’ancienne École de credo qui refusait d'interpréter, via les méthodes de la logique et du raisonnement, les Sources scripturaires qui traitaient des questions de foi. L’École (madhhab) des salaf-s est donc l'autre nom pour l’École théologique hanbalite (à côté des deux autres du sunnisme : acharite et matouridite).
Relevons donc ce premier point : ce terme – péjoratif et inquiétant en Occident mais mélioratif dans l'imaginaire collectif musulman – a bien une histoire. Contrairement à aujourd'hui, des siècles durant le mot salaf n'est jamais employé pour désigner une volonté de « retour aux Sources », ni un courant réformiste. Jusqu'au XXe siècle, aucun savant, aucun texte ne parle du salafisme ainsi. L'intellectuel syrien Rashîd Ridâ (m. 1935), en 1914, est le premier.
Pourquoi cette innovation sémantique au XXe siècle ? Car avec l'écroulement ottoman – de l'Empire et du modèle sociétal – les mots changent aussi. À l'époque tout s'effondre : démembrement de l'Empire agonisant ; destruction des structures socio-économiques ; émergence de la figure de l'intellectuel (muthaqqaf) contre celle, traditionnelle, du savant ; développement de l'imprimerie qui diffuse largement les idées desdits muthaqqaf-s … En pleine quête de coupables au « retard du monde musulman », l'invention du salafisme sonne comme un appel à la réforme totale de l'islam, dans sa triple composante fondamentale : credo (aqîda), jurisprudence (fiqh) et spiritualité (tasawwuf – soufisme en français – constitué en confréries). On vise ainsi à sortir des règles interprétatives élaborées des siècles durant, en cherchant à extraire directement les lois des Textes, en opérant un tri en leur sein.
La genèse et même le mot de salafisme sont donc issus de notre modernité : c'est l'écroulement de l'ancien monde, celui de l'islam classique et de son modèle sociétal, qui va permettre l'entrée en scène de la salafiyya, version contemporaine.
De fait, derrière "salafisme", et au risque de choquer, on peut aujourd'hui regrouper une variété de tendances et de personnalités très diverses, depuis des penseurs volontiers pro-occidentaux jusqu'aux jihadistes actuels. Paradoxe me direz-vous ; oui si on regarde ce qui les oppose, mais non si on comprend ce qui les unit. C'est par une « archéologie » de ce courant qu'on peut espérer y voir clair dans les multiples sous-groupes apparemment antagonistes le composant. Car ses fondements doctrinaux sont antérieurs au mot « salafisme » : il faut les chercher dans l'histoire du wahhabisme.
« Wahhabisme » est-il alors synonyme de « salafisme » ?
Le mot wahhabisme, utilisé à la place de salafisme jusqu'aux années 20, renvoie au courant fondé par le prédicateur Muhammad Ibn 'Abd al-Wahhâb (m. 1792), qui a mené toute sa mission dans le Najd (Est de l'Arabie). L'essentiel de « notre » salafisme s’y trouve : une réforme – voire une révolution – au sein de l'islam, menée par la prédication et l'épée. L'idée est celle-ci : les musulmans se sont fourvoyés en suivant des écoles théologiques, juridiques et confrériques ; ils auraient dû tirer leur savoir directement des Sources. De sa prédication et de son alliance avec un chef de tribu (Ibn Saoud, l'ancêtre éponyme de la famille royale d'Arabie Saoudite) vont naître des décennies de troubles, de guerres, de destructions et de massacres de populations jugées hétérodoxes selon la vision wahhabite. Les oulémas, gardiens de l'islam classique pluriséculaire, tenteront de sauvegarder le patrimoine traditionnel des sciences islamiques. Mais c'était la fin d'un monde : l'effondrement de l'Empire ottoman et la naissance des États modernes dans le premier tiers du XXe siècle donneront victoire aux wahhabites.
C'est alors que le mot « salafisme » devient utile, et qu'il va se répandre. Le roi d'Arabie, 'Abd al-'Azîz Ibn Saoud, rejette le mot « wahhabite », qu'emploient depuis le début partisans comme opposants : cela sonne trop comme une insulte et rappelle le côté sectaire du mouvement. Lors du grand Pèlerinage de 1936, il revendique officiellement le titre de salafî pour son mouvement. Il ne chipote pas ici, l'enjeu est bien de taille. Derrière la querelle terminologique se cache une volonté idéologique qui mettra plusieurs décennies – pétrodollars aidant – à se réaliser pleinement : celle d'incarner le véritable islam des origines, celui des salaf-s. Et le mot salafisme n’est pas de lui : il lui a sans doute était soufflé par les intellectuels Syriens/Égyptiens qui ont forgé le concept, dont Ridâ, "main invisible" derrière Ibn Saoud.
Comment peut-on alors définir ce courant religieux ? Est-il homogène ?
Le mot wahhabisme, utilisé à la place de salafisme jusqu'aux années 20, renvoie au courant fondé par le prédicateur Muhammad Ibn 'Abd al-Wahhâb (m. 1792), qui a mené toute sa mission dans le Najd (Est de l'Arabie). L'essentiel de « notre » salafisme s’y trouve : une réforme – voire une révolution – au sein de l'islam, menée par la prédication et l'épée. L'idée est celle-ci : les musulmans se sont fourvoyés en suivant des écoles théologiques, juridiques et confrériques ; ils auraient dû tirer leur savoir directement des Sources. De sa prédication et de son alliance avec un chef de tribu (Ibn Saoud, l'ancêtre éponyme de la famille royale d'Arabie Saoudite) vont naître des décennies de troubles, de guerres, de destructions et de massacres de populations jugées hétérodoxes selon la vision wahhabite. Les oulémas, gardiens de l'islam classique pluriséculaire, tenteront de sauvegarder le patrimoine traditionnel des sciences islamiques. Mais c'était la fin d'un monde : l'effondrement de l'Empire ottoman et la naissance des États modernes dans le premier tiers du XXe siècle donneront victoire aux wahhabites.
C'est alors que le mot « salafisme » devient utile, et qu'il va se répandre. Le roi d'Arabie, 'Abd al-'Azîz Ibn Saoud, rejette le mot « wahhabite », qu'emploient depuis le début partisans comme opposants : cela sonne trop comme une insulte et rappelle le côté sectaire du mouvement. Lors du grand Pèlerinage de 1936, il revendique officiellement le titre de salafî pour son mouvement. Il ne chipote pas ici, l'enjeu est bien de taille. Derrière la querelle terminologique se cache une volonté idéologique qui mettra plusieurs décennies – pétrodollars aidant – à se réaliser pleinement : celle d'incarner le véritable islam des origines, celui des salaf-s. Et le mot salafisme n’est pas de lui : il lui a sans doute était soufflé par les intellectuels Syriens/Égyptiens qui ont forgé le concept, dont Ridâ, "main invisible" derrière Ibn Saoud.
Comment peut-on alors définir ce courant religieux ? Est-il homogène ?

Rifâ'a al-Tahtawî (m. 1873)
Tout dépend de l'angle d'observation : du point de vue des différences, il y a pratiquement autant de salafismes que de salafistes... Mais l'approche inverse, qui se concentre sur les convergences, est plus pertinente : il faut revenir aux principes communs à tous les sous-groupes de la salafiyya.
On divise couramment le salafisme en deux grandes tendances : réformiste et wahhabite. La première, née au XIXe siècle, est perçue positivement en Occident car elle aurait posé les bases d'un « Islam des Lumières ». Rifâ'a al-Tahtawî, Jamâl al-Dîne al-Afghânî ou Muhammad 'Abduh, qui ont d'ailleurs vécu en Europe, en sont les figures les plus célèbres. La seconde est le wahhabisme de type saoudien. Il aurait absorbé le réformisme pour finalement devenir le seul mouvement de réforme encore vivant, bien que divisé entre des sous-groupes qui se détestent mutuellement, comme le chaos moyen-oriental le montre.
Or il y a bien une parenté intellectuelle – mais non généalogique – entre ces deux courants. Comme deux faces opposées d'une même pièce : leurs divisions relèvent davantage de variations internes au sein d'une vision commune de l'Islam. Convergence de fond qui explique que parmi les vigoureux défenseurs d'Ibn 'Abd al-Wahhâb on trouve des figures aussi différentes qu'Ahmad Amin et Taha Hussein (auteurs rationalistes et modernistes), ou Tariq Ramadan et Yusuf al-Qaradawi... Pour comprendre cette unité au-delà d'une diversité apparente, il faut revenir à leur principe fondamental, véritable cœur de ces deux visages du salafisme : l'Islam traditionnel, qui se transmet depuis 10 siècles autour des Écoles théologiques, juridiques et spirituelles, aurait été une erreur historique. L'idée ici est que l'islam classique aurait dépossédé les musulmans de leur relation immédiate aux Sources, les faisant abdiquer leur pouvoir interprétatif entre les mains des différentes Écoles. La tradition islamique n'aurait pas été une chaîne reliant au Prophète, mais un écran l'en séparant.
Il ne s'agit donc pas seulement pour eux de réformer l'islam, comme on le dit souvent. Du moins cette réforme n'est-elle pas du même type que celles des siècles passés, et telle que pensée jusqu'au XIXe siècle. La notion de réforme est en effet un lieu commun en islam : son origine vient d'un hadith qui annonce la venue d'un réformateur (mujaddid) pour chaque siècle. Ces réformateurs, dans les siècles précédents, ne remettaient pas en cause la tradition islamique telle qu'elle existait, mais plutôt ses abus et faiblesses. Dans le salafisme, réformiste comme wahhabite, c'est très différent : par bien des aspects c'est toute la tradition qui est remise en cause.
On divise couramment le salafisme en deux grandes tendances : réformiste et wahhabite. La première, née au XIXe siècle, est perçue positivement en Occident car elle aurait posé les bases d'un « Islam des Lumières ». Rifâ'a al-Tahtawî, Jamâl al-Dîne al-Afghânî ou Muhammad 'Abduh, qui ont d'ailleurs vécu en Europe, en sont les figures les plus célèbres. La seconde est le wahhabisme de type saoudien. Il aurait absorbé le réformisme pour finalement devenir le seul mouvement de réforme encore vivant, bien que divisé entre des sous-groupes qui se détestent mutuellement, comme le chaos moyen-oriental le montre.
Or il y a bien une parenté intellectuelle – mais non généalogique – entre ces deux courants. Comme deux faces opposées d'une même pièce : leurs divisions relèvent davantage de variations internes au sein d'une vision commune de l'Islam. Convergence de fond qui explique que parmi les vigoureux défenseurs d'Ibn 'Abd al-Wahhâb on trouve des figures aussi différentes qu'Ahmad Amin et Taha Hussein (auteurs rationalistes et modernistes), ou Tariq Ramadan et Yusuf al-Qaradawi... Pour comprendre cette unité au-delà d'une diversité apparente, il faut revenir à leur principe fondamental, véritable cœur de ces deux visages du salafisme : l'Islam traditionnel, qui se transmet depuis 10 siècles autour des Écoles théologiques, juridiques et spirituelles, aurait été une erreur historique. L'idée ici est que l'islam classique aurait dépossédé les musulmans de leur relation immédiate aux Sources, les faisant abdiquer leur pouvoir interprétatif entre les mains des différentes Écoles. La tradition islamique n'aurait pas été une chaîne reliant au Prophète, mais un écran l'en séparant.
Il ne s'agit donc pas seulement pour eux de réformer l'islam, comme on le dit souvent. Du moins cette réforme n'est-elle pas du même type que celles des siècles passés, et telle que pensée jusqu'au XIXe siècle. La notion de réforme est en effet un lieu commun en islam : son origine vient d'un hadith qui annonce la venue d'un réformateur (mujaddid) pour chaque siècle. Ces réformateurs, dans les siècles précédents, ne remettaient pas en cause la tradition islamique telle qu'elle existait, mais plutôt ses abus et faiblesses. Dans le salafisme, réformiste comme wahhabite, c'est très différent : par bien des aspects c'est toute la tradition qui est remise en cause.
Mais les différences entre ces courants sont pourtant nombreuses
Les variations internes au salafisme sont en fait des accentuations différentes au sein d'une pensée mue par un même diagnostic. À leur commun rejet de la tradition classique se surajoutent ensuite des orientations diverses, qui sont, selon les groupes, socialement inoffensives ou dangereuses, et des idéaux variés qui cachent une réelle unité de fond.
Le wahhabisme de type saoudien d'abord : historiquement issu des milieux nomades des marges de l'Empire ottoman, peu concerné par la question coloniale et préoccupé par la création d'un État conforme à sa vision religieuse, il est surtout axé sur les questions théologiques. L'obsession d'Ibn 'Abd al-Wahhâb était en effet d'imposer sa vision de l'orthodoxie et d'excommunier tout ce qui s'en éloignait.
Les courants héritiers des réformateurs urbains de Syrie/Égypte du XIXe siècle ensuite : ils sont davantage tournés vers les questions socio-politiques et d'adaptation du droit musulman au monde moderne, peu intéressés par le théologique pur. Fondamentalement, ils sont légalistes.
Les mouvements « djihadistes » enfin : c'est le wahhabisme intégral – obsessions théologiques plus violence via le takfîr (excommunication) – avec des velléités plus strictement politiques et révolutionnaires.
Trois variantes pour une même famille cependant. Car l'essentiel pour l'analyste ici n'est pas dans ce qui divise ces tendances, même si cela peut évidemment avoir des conséquences sociétales énormes pour nous : guerres, terrorisme, etc. Au-delà de ces enjeux, il faut comprendre que pour tous ces groupes l'idée fondamentale est que l'islam tel qu'il s'est transmis à travers les siècles doit être repensé, et même renversé. Et tous s'entendent sur les coupables : le juridisme, jugé stérile voire imbécile et le soufisme perçu comme hérétique et crypto-polythéiste. En somme la tradition classique aurait fait dégénérer la communauté, la rendant colonisable pour les uns, ou à nouveau païenne pour les autres. Le cœur de cette réforme nécessaire – qu'elle aspire à une imitation de l'Occident ou à son rejet – c'est l'enjambement des siècles pour revenir aux Sources. Pour ce faire la salafiyya agit sur deux plans : en dépréciant la tradition intellectuelle pluriséculaire, notamment ottomane (par le mythe du déclin) et en réduisant le champ de cet héritage (le restreignant à quelques rares figures dans l'histoire de la pensée islamique). En jetant ainsi le bébé avec l'eau du bain, on coupe la communauté musulmane de son cadre interprétatif pluriséculaire pour lui offrir une nouvelle orthodoxie tournant le dos à la tradition. On est là, paradoxalement pour nous, en pleine modernité... Et s'il est important de comprendre cela c'est qu'il faut mesurer que ces courants qui nous font tant peur ne sont pas les produits d'un Moyen Âge ténébreux ; c'est même tout le contraire : c'est contre la tradition médiévale, et dans un esprit typique de notre modernité, que ces courants opèrent.
Comment est-on passé du réformisme au wahhabisme ?
Il faut encore revenir à Ridâ, « l'inventeur » du salafisme. Il était le disciple de 'Abduh, Cheikh réformiste d'al-Azhâr, lui-même disciple d'un autre réformiste, Afghânî. Tous deux appelaient à cette triple réforme dont je parle depuis le début, avec cependant une orientation davantage rationaliste, voire néo-moutazilite. Le sujet fait débat entre spécialistes, mais toujours est-il que Ridâ va capter l'héritage réformiste de ses maîtres pour le fondre dans la pensée wahhabite classique : c'est lui le passeur. Car Ridâ n'est pas seulement l'intellectuel prolixe de la revue Al-Manâr. Il est aussi le maître à penser de toute une génération, l'éditeur des premiers imprimés wahhabites, et celui qui enverra ses disciples en Arabie pour fournir les premiers cadres et enseignants de la jeune Arabie Saoudite. Il est enfin le référent du souverain saoudien qu'il aide directement dans la création de son État.
Les variations internes au salafisme sont en fait des accentuations différentes au sein d'une pensée mue par un même diagnostic. À leur commun rejet de la tradition classique se surajoutent ensuite des orientations diverses, qui sont, selon les groupes, socialement inoffensives ou dangereuses, et des idéaux variés qui cachent une réelle unité de fond.
Le wahhabisme de type saoudien d'abord : historiquement issu des milieux nomades des marges de l'Empire ottoman, peu concerné par la question coloniale et préoccupé par la création d'un État conforme à sa vision religieuse, il est surtout axé sur les questions théologiques. L'obsession d'Ibn 'Abd al-Wahhâb était en effet d'imposer sa vision de l'orthodoxie et d'excommunier tout ce qui s'en éloignait.
Les courants héritiers des réformateurs urbains de Syrie/Égypte du XIXe siècle ensuite : ils sont davantage tournés vers les questions socio-politiques et d'adaptation du droit musulman au monde moderne, peu intéressés par le théologique pur. Fondamentalement, ils sont légalistes.
Les mouvements « djihadistes » enfin : c'est le wahhabisme intégral – obsessions théologiques plus violence via le takfîr (excommunication) – avec des velléités plus strictement politiques et révolutionnaires.
Trois variantes pour une même famille cependant. Car l'essentiel pour l'analyste ici n'est pas dans ce qui divise ces tendances, même si cela peut évidemment avoir des conséquences sociétales énormes pour nous : guerres, terrorisme, etc. Au-delà de ces enjeux, il faut comprendre que pour tous ces groupes l'idée fondamentale est que l'islam tel qu'il s'est transmis à travers les siècles doit être repensé, et même renversé. Et tous s'entendent sur les coupables : le juridisme, jugé stérile voire imbécile et le soufisme perçu comme hérétique et crypto-polythéiste. En somme la tradition classique aurait fait dégénérer la communauté, la rendant colonisable pour les uns, ou à nouveau païenne pour les autres. Le cœur de cette réforme nécessaire – qu'elle aspire à une imitation de l'Occident ou à son rejet – c'est l'enjambement des siècles pour revenir aux Sources. Pour ce faire la salafiyya agit sur deux plans : en dépréciant la tradition intellectuelle pluriséculaire, notamment ottomane (par le mythe du déclin) et en réduisant le champ de cet héritage (le restreignant à quelques rares figures dans l'histoire de la pensée islamique). En jetant ainsi le bébé avec l'eau du bain, on coupe la communauté musulmane de son cadre interprétatif pluriséculaire pour lui offrir une nouvelle orthodoxie tournant le dos à la tradition. On est là, paradoxalement pour nous, en pleine modernité... Et s'il est important de comprendre cela c'est qu'il faut mesurer que ces courants qui nous font tant peur ne sont pas les produits d'un Moyen Âge ténébreux ; c'est même tout le contraire : c'est contre la tradition médiévale, et dans un esprit typique de notre modernité, que ces courants opèrent.
Comment est-on passé du réformisme au wahhabisme ?
Il faut encore revenir à Ridâ, « l'inventeur » du salafisme. Il était le disciple de 'Abduh, Cheikh réformiste d'al-Azhâr, lui-même disciple d'un autre réformiste, Afghânî. Tous deux appelaient à cette triple réforme dont je parle depuis le début, avec cependant une orientation davantage rationaliste, voire néo-moutazilite. Le sujet fait débat entre spécialistes, mais toujours est-il que Ridâ va capter l'héritage réformiste de ses maîtres pour le fondre dans la pensée wahhabite classique : c'est lui le passeur. Car Ridâ n'est pas seulement l'intellectuel prolixe de la revue Al-Manâr. Il est aussi le maître à penser de toute une génération, l'éditeur des premiers imprimés wahhabites, et celui qui enverra ses disciples en Arabie pour fournir les premiers cadres et enseignants de la jeune Arabie Saoudite. Il est enfin le référent du souverain saoudien qu'il aide directement dans la création de son État.

Rashîd Ridhâ (m. 1935)
L'héritage réformiste chez Ridâ fait polémique. Certains s'interrogent : comment un disciple de 'Abduh peut-il devenir wahhabite ? N'a-t-il pas feint d'être réformiste ? Mais le paradoxe n'est qu'apparent si on revient à mon propos de départ : tous ces hommes partagent la même conviction que la tradition est à renverser. Je pense que pour Ridâ il n'y avait pas d'opposition essentielle entre "réformisme" et "wahhabisme". Qu'on revienne directement aux Sources scripturaires via sa propre raison ou en limitant celle-ci, dans tous les cas l'objectif est d'enjamber les siècles et de se débarrasser des « superstitions » (khurâfa) soufies et du « suivisme aveugle » (taqlid) des juristes. Pour Ridâ ou Taha Hussein, Ibn 'Abd al-Wahhâb est un réformateur qui libère du poids de la tradition, même s'il est trop zélé parfois. Leur enthousiasme pour la geste wahhabite tient à cela : ils voient, en acte, la réforme rêvée. Alors ils pardonnent les destructions et massacres qui vont avec, car l'essentiel n'est pas là. Pour l'intellectuel policé de grande ville, ce ne sont là que les dommages collatéraux inhérents au bras armé bédouin d'un message bien inspiré.
Quels sont les liens entre les salafistes et les Frères Musulmans ?
Là encore il faut nuancer les choses afin d'y voir clair. Car derrière le nom de Frères Musulmans se cachent deux réalités : la confrérie créée par Hassan al-Banna (m. 1949) ; celle qui s'est reconstituée après les purges nassériennes.
Le fondateur, par bien des aspects, est un inclassable. Si d'un côté il suit la perspective réformiste d'Afghânî et Ridâ qu'il admire, d'un autre côté il s'inscrit aussi dans l'héritage traditionnel islamique. Formé au sein d'une confrérie Chadhilite d’Égypte (dont il reconnaîtra toute sa vie la valeur), il ne s'oppose pas davantage aux Écoles juridiques et théologiques, même s'il est un critique du système religieux en place. Par bien des aspects il pourrait s'insérer dans la perspective réformiste traditionnelle, et non dans celle de Ridâ. Politiquement, il est légaliste (il condamne la violence politique), avec une vision par étapes : par un revivalisme, à partir de l'individu, puis le village et enfin le pays, on fonde l’État islamique. C'est donc le peuple qui islamise l’État, et non l'inverse. Avec la répression du président Nasser, la persécution des Frères et la considérable reprise en main intellectuelle de la confrérie par Sayyid Qutb, un virage idéologique se fait. L'orientation est théologiquement wahhabite, avec un accent takfiriste, et c'est l’État qui est en charge de convertir la société, dans une vision pyramidale : la perspective est donc davantage révolutionnaire, ou en tout cas ultra politisée.
Stéphane Lacroix a bien montré le processus de « frérisation des wahhabites » et de « wahhabisation des Frères » à partir des années 60 : les Frères persécutés en Égypte s'exilent en Arabie – « Guerre Froide arabe » oblige – offrant leur savoir-faire politique et institutionnel aux Saoudiens. Obsession de la prise de pouvoir – par voie légale ou par révolution – , intégration de l'idée selon laquelle l'islam traditionnel des Écoles est à rejeter ; réductionnisme intellectuel global (avec quelques références qui écrasent tout le patrimoine) : on a là un champ idéologique homogène dont la variété d'applications et les multiples querelles internes ne doivent pas, encore une fois, nous empêcher de discerner la profonde unité. Comme avec Ridâ, « mentor » admiratif du roi d'Arabie, le va-et-vient Frères musulmans/wahhabisme est constant depuis plusieurs décennies.
Quels sont les liens entre les salafistes et les Frères Musulmans ?
Là encore il faut nuancer les choses afin d'y voir clair. Car derrière le nom de Frères Musulmans se cachent deux réalités : la confrérie créée par Hassan al-Banna (m. 1949) ; celle qui s'est reconstituée après les purges nassériennes.
Le fondateur, par bien des aspects, est un inclassable. Si d'un côté il suit la perspective réformiste d'Afghânî et Ridâ qu'il admire, d'un autre côté il s'inscrit aussi dans l'héritage traditionnel islamique. Formé au sein d'une confrérie Chadhilite d’Égypte (dont il reconnaîtra toute sa vie la valeur), il ne s'oppose pas davantage aux Écoles juridiques et théologiques, même s'il est un critique du système religieux en place. Par bien des aspects il pourrait s'insérer dans la perspective réformiste traditionnelle, et non dans celle de Ridâ. Politiquement, il est légaliste (il condamne la violence politique), avec une vision par étapes : par un revivalisme, à partir de l'individu, puis le village et enfin le pays, on fonde l’État islamique. C'est donc le peuple qui islamise l’État, et non l'inverse. Avec la répression du président Nasser, la persécution des Frères et la considérable reprise en main intellectuelle de la confrérie par Sayyid Qutb, un virage idéologique se fait. L'orientation est théologiquement wahhabite, avec un accent takfiriste, et c'est l’État qui est en charge de convertir la société, dans une vision pyramidale : la perspective est donc davantage révolutionnaire, ou en tout cas ultra politisée.
Stéphane Lacroix a bien montré le processus de « frérisation des wahhabites » et de « wahhabisation des Frères » à partir des années 60 : les Frères persécutés en Égypte s'exilent en Arabie – « Guerre Froide arabe » oblige – offrant leur savoir-faire politique et institutionnel aux Saoudiens. Obsession de la prise de pouvoir – par voie légale ou par révolution – , intégration de l'idée selon laquelle l'islam traditionnel des Écoles est à rejeter ; réductionnisme intellectuel global (avec quelques références qui écrasent tout le patrimoine) : on a là un champ idéologique homogène dont la variété d'applications et les multiples querelles internes ne doivent pas, encore une fois, nous empêcher de discerner la profonde unité. Comme avec Ridâ, « mentor » admiratif du roi d'Arabie, le va-et-vient Frères musulmans/wahhabisme est constant depuis plusieurs décennies.
Dans quel mesure DAESH est-il le résultat de la pensée saoudienne alors que les salafistes du royaume dénoncent ce groupe ?
Autre sujet qui dépend lui aussi de la focale utilisée: DAESH est-il l'enfant du wahhabisme ? Les spécialistes ont montré les différences internes au sein des jihadistes : les groupes armés opposés à DAESH se revendiquent du même héritage wahhabite et s'excommunient mutuellement. Mais là encore la multiplicité apparente ne doit pas cacher la forêt de convergences. La perspective, les savants et textes de référence, le vocabulaire sont les mêmes : tout est une question d'accent sur certains aspects. Il en est de même pour l'opposition Arabie saoudite/DAESH.
Rappelons que la vision théologique du wahhabisme historique est fondamentalement exclusiviste, excommuniante et belliqueuse : pour Ibn 'Abd al-Wahhâb, les musulmans de son temps ne sont tout simplement plus musulmans. Il excommunie même pour des questions juridiques, ce qui est un non-sens pour l'orthodoxie classique. Avant sa prédication, affirme le chroniqueur wahhabite Ibn Bishr, « la Péninsule arabique avait entièrement apostasié (kafarate kullu-hâ) ». Conséquence : la conversion est exigée, sinon le djihad est déclaré. L'histoire de la conquête saoudienne est une étrange répétition générale, armes modernes en moins, de DAESH : destructions complètes des sanctuaires anciens (y compris les tombes des Compagnons du Prophète), populations (à majorité musulmanes) massacrées… les fatwas wahhabites des 200 dernières années laissent peu de place au doute quant à l'ennemi à détruire : l'Empire ottoman d'abord, jugé mécréant, et toutes les structures traditionnelles ensuite (surtout les confréries soufies). Les non-musulmans ne sont pas leur problème et ce sont bien les populations musulmanes qui ont fait les frais du wahhabisme. C'est la même logique ensuite, des attentats d'al-Qaïda jusqu'à DAESH : c'est d'abord l'islam et ses adeptes qui souffrent.
La condamnation saoudienne de DAESH s'explique donc par autre chose. Sans entrer dans les considérations géopolitiques, retenons simplement qu'on est là dans une très classique opposition (théorisée par Max Weber) entre éthique de conviction et éthique de responsabilité. Au zèle révolutionnaire intransigeant des fondateurs saoudiens qui luttaient contre un pouvoir ottoman jugé impie, succède une routinisation politico-religieuse visant à maintenir au pouvoir les Saoud. L'aboutissement de cette logique est sans doute le « madkhalisme » (du nom de son savant de référence : Rabî' al-Madkhalî) qui opte pour un suivisme complet du régime en place, sans possibilité de contestation. DAESH apparaît ici comme un dérangeant concurrent, d'autant plus qu'il incarne, par bien des aspects, le wahhabisme originel dans toute sa pureté. Outre qu'il leur vole la place de leadership de la Oumma, le nouveau calife de Bagdad rappelle aux Saoudiens qu'ils ont failli à l'intransigeant message originel.
Bien difficile de détourner la jeunesse de s'engager dans les rangs de « l’État Islamique » si on considère qu'Ibn 'Abd al-Wahhâb était, peu ou prou, un mujaddid... On revient donc là à l'urgence sociale de la discipline historique, surtout pour ces questions : la déconstruction des mythes de la salafiyya, par une étude de son histoire et de ses idées, est un enjeu majeur aujourd'hui.
Autre sujet qui dépend lui aussi de la focale utilisée: DAESH est-il l'enfant du wahhabisme ? Les spécialistes ont montré les différences internes au sein des jihadistes : les groupes armés opposés à DAESH se revendiquent du même héritage wahhabite et s'excommunient mutuellement. Mais là encore la multiplicité apparente ne doit pas cacher la forêt de convergences. La perspective, les savants et textes de référence, le vocabulaire sont les mêmes : tout est une question d'accent sur certains aspects. Il en est de même pour l'opposition Arabie saoudite/DAESH.
Rappelons que la vision théologique du wahhabisme historique est fondamentalement exclusiviste, excommuniante et belliqueuse : pour Ibn 'Abd al-Wahhâb, les musulmans de son temps ne sont tout simplement plus musulmans. Il excommunie même pour des questions juridiques, ce qui est un non-sens pour l'orthodoxie classique. Avant sa prédication, affirme le chroniqueur wahhabite Ibn Bishr, « la Péninsule arabique avait entièrement apostasié (kafarate kullu-hâ) ». Conséquence : la conversion est exigée, sinon le djihad est déclaré. L'histoire de la conquête saoudienne est une étrange répétition générale, armes modernes en moins, de DAESH : destructions complètes des sanctuaires anciens (y compris les tombes des Compagnons du Prophète), populations (à majorité musulmanes) massacrées… les fatwas wahhabites des 200 dernières années laissent peu de place au doute quant à l'ennemi à détruire : l'Empire ottoman d'abord, jugé mécréant, et toutes les structures traditionnelles ensuite (surtout les confréries soufies). Les non-musulmans ne sont pas leur problème et ce sont bien les populations musulmanes qui ont fait les frais du wahhabisme. C'est la même logique ensuite, des attentats d'al-Qaïda jusqu'à DAESH : c'est d'abord l'islam et ses adeptes qui souffrent.
La condamnation saoudienne de DAESH s'explique donc par autre chose. Sans entrer dans les considérations géopolitiques, retenons simplement qu'on est là dans une très classique opposition (théorisée par Max Weber) entre éthique de conviction et éthique de responsabilité. Au zèle révolutionnaire intransigeant des fondateurs saoudiens qui luttaient contre un pouvoir ottoman jugé impie, succède une routinisation politico-religieuse visant à maintenir au pouvoir les Saoud. L'aboutissement de cette logique est sans doute le « madkhalisme » (du nom de son savant de référence : Rabî' al-Madkhalî) qui opte pour un suivisme complet du régime en place, sans possibilité de contestation. DAESH apparaît ici comme un dérangeant concurrent, d'autant plus qu'il incarne, par bien des aspects, le wahhabisme originel dans toute sa pureté. Outre qu'il leur vole la place de leadership de la Oumma, le nouveau calife de Bagdad rappelle aux Saoudiens qu'ils ont failli à l'intransigeant message originel.
Bien difficile de détourner la jeunesse de s'engager dans les rangs de « l’État Islamique » si on considère qu'Ibn 'Abd al-Wahhâb était, peu ou prou, un mujaddid... On revient donc là à l'urgence sociale de la discipline historique, surtout pour ces questions : la déconstruction des mythes de la salafiyya, par une étude de son histoire et de ses idées, est un enjeu majeur aujourd'hui.