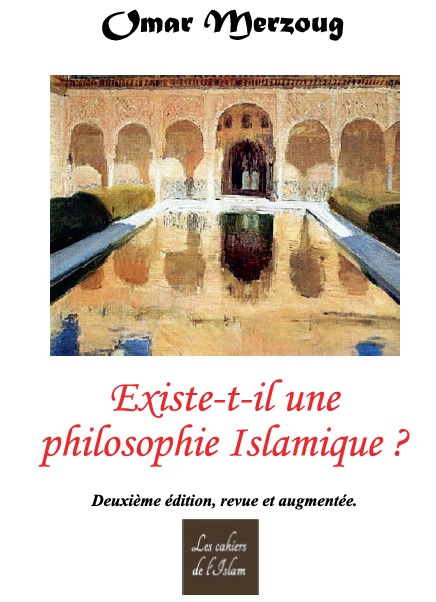" Par la géométrie, les artistes musulmans sont parvenus à illustrer visuellement une notion aussi sublime et mystique que celle du tajallī, du rayonnement infini de l’Essence divine à travers la multiplicité des plans de l’existence. Toute la philosophie de l’arabesque et de l’entrelacs, qu’il soit floral ou géométrique, comme celle du décor polygonal repose sur l’idée d’un centre omniprésent, qui se manifeste là où il veut, autant de fois qu’il veut, sans que rien dans sa nature soit affecté, augmenté ou diminué par cette apparition."
J.L Michon
Nous reproduisons ici la seconde partie d'une conférence donnée en novembre 2014 à la villa des arts de Rabat par Khireddine MOURAD.
Cette conférence aborde les notions d'art et d'esthétique en Islam à l'aide d'une approche soufie puisant sa source dans les textes scripturaires de l'Islam (Coran & Hadith) et s'appuyant sur les travaux de " deux hommes qui vont entreprendre un voyage intérieur, lequel les conduira à en accomplir un autre, géographique, aux cœurs des villes marocaines, mais aussi d’autres villes musulmanes": Titus Burckhardt et Jean louis Michon.
Poète, écrivain (voir la présentation de l'auteur ici) Khireddine MOURAD est, entre autres, l'auteur de deux ouvrages en rapport avec l'art: Marrakech et la Mamounia , ACR, Paris, 1995 ; Arts et Traditions au Maroc
Il est par ailleurs le préfacier de l'ouvrage : Le souffle féminin du message coranique de Thérèse Benjelloun, publié aux éditions Les Cahiers de l'Islam.

IV- HADITH : “DIEU EST BEAU ET IL AIME LA BEAUTÉ” [1]
Ce qui nous amène au troisième point : quand on aborde les ouvrages qui traitent de l’esthétique et de l’art dans le monde islamique, et qui sont pour la plupart écrits par des auteurs européens, nous avons quelques problèmes de compréhensions qui ressortissent précisément à l’interprétation qu’ils donnent de l’Islam, du monde islamique, etc. Ces auteurs tournent pour l’essentiel autour de deux points : Les uns disent : il n’y a pas d’art en Islam du fait qu’il interdit l’image. Et pour ceux qui lui reconnaissent un art, ils vont chercher ses origines ailleurs. Voilà ce que l’on peut lire dans l’Encyclopédie Générale de l’Islam de Cambridge, qui nous donne une vision de la situation dans laquelle se débattent les uns et les autres sur cette question :
« Bon nombre d’érudits ont remis en question, depuis une trentaine d’années, la validité de l’expression “art islamique”, “art persan”, “art turc”. Certains auteurs ont même été jusqu’à dénier qu’il y eût des origines et des caractéristiques communes à tout ce que l’on englobe sous cette appellation, affirmant que l’on devrait se contenter de désigner cet art par le pays où se trouve le monument décrit, la ville où a été fabriqué l’objet. Il nous paraît donc souhaitable, avant de décrire les grandes réussites de l’art islamique, de répondre à ces critiques, de définir dans toute la mesure du possible les traits communs à l’art islamique, d’en élucider les origines et de jeter quelque lumière sur les influences étrangères qui ont contribué à son évolution. »
Et dans la foulée, l’auteur affirme que :
« C’est un fait bien connu et accepté que les Arabes, avant de se lancer dans la conquête des territoires du Nord, n’avaient pratiquement rien que l’on pût appeler de l’art.» (Encyclopédie Générale de l'Islam 1970, 13)
La situation se résume donc ainsi : il n’y avait pas d’art, quant aux réalisations, du fait qu’il y en a eu, il faut en élucider les origines et relever les influences étrangères qui ont contribué à [leur] évolution.
Aux premiers qui affirment, à tort, que du fait que la religion islamique interdit l’image, il n’y a pas eu, à proprement parler, un développement artistique - comme si celui-ci dépendait exclusivement de la figuration- un orientaliste, Louis MASSIGNON, apporte un démenti probant dans un article qui date de 1921, intitulé Les méthodes de réalisation artistique des peuples de l’Islam (MASSIGNON, Les Allusions instigatrices 2000, 27-54). Il démontre en se fondant sur le Coran et les Hadiths, l’aberration d’une telle affirmation ; il présente ensuite le débat qui a porté sur la question de l’image chez les théologiens des différentes écoles et donne enfin les preuves des “réalisations artistiques” des sociétés musulmanes. Salah STÉTIÉ reprendra cette démonstration, point par point, et l’enrichira d’exemples et de réalisations nouvelles, en mettant en relation, d’une manière encore plus étroite la dimension soufie et l’art moderne, notamment la dimension onirique et l’illusion cinématographique (STÉTIÉ 2002, 181-214).
« Rêvons encore. Rêvons chimères, et griffons, et lions ailés. Plaçons ce bestiaire fabuleux dans un décor à sa mesure, écus et blasons, parmi des fleurs qui seraient des pierreries, des tulipes qui seraient des rubis. Il y a là un film qui, dans son délire imaginatif, baignerait dans un climat spontanément surréaliste lequel, pourtant, ne serait que l’exploitation dynamique des figures constantes de l’art islamique. De cet art islamique où, on le voit, certaines des audaces les plus extraordinaires de la conscience créatrice moderne ne se trouveraient pas dépaysées. » (STÉTIÉ 2002, 212)
Il conclut avec ces propos d’un soufi : « Il ne faut pas croire à ses rêves, car les images précaires de ce monde sont un rêve et passeront. » Et il ajoute : « Le cinéaste fait-il donc autre chose que d’illustrer, par son oeuvre, et la fascination de ce rêve et son irrémédiable vanité ? » (STÉTIÉ 2002, 213)
La réduction de l’art d’une part et des normes de l’esthétique, d’autre part, au figuratif a, en quelque sorte, appauvri les perspectives de l’histoire de l’art et de la philosophie du Beau. Conscient de démarche pour le moins déficiente, voilà ce qu’écrit, un soufi, Titus BURCHARDT :
« L'Européen qui entre pour la première fois en contact avec le monde des formes islamiques cherche instinctivement des exemples d'art figuratif, car ce sont les seuls qui lui permettent d'appliquer des critères esthétiques empruntés à l’art occidental. C'est en observant la manière dont un artiste rend la nature avec plus ou moins de fidélité et la traduit dans un certain langage formel, c'est dans ce contexte que l’Européen saisit le plus facilement le génie d'un art. Au demeurant, il risque de passer à côté des caractères essentiels de l’art islamique, qui exige l’effacement de l’artiste individuel devant les lois qu'impose la beauté dans sa nature impersonnelle. » (BURCKHARDT 1976, 9)
Par ailleurs, quand bien même telle culture ou telle croyance interdit l’image, cela ne signifie nullement qu’elle n’a ni art ni esthétique, car ces deux dimensions de l’humain ne sont pas réductibles à la seule représentation figurative. Il en est d’autres modes, en plus du visuel, de l’auditif, du tactile et du gustatif qui interpellent d’autres facultés d’appréhension. « Les arts sont, il est vrai, variés et innombrables. Écrit un auteur égyptien en 1866. Mais tous ont une importance qui leur est propre, une vertu singulière et évidente. » (MICHON 1973, 13) Pour ces autres facultés d’appréhension, ces versants inexplorés, l’immense corpus soufi, pour peu qu’on en lise quelques ouvrages, offre de nombreuses voies pour l’exploration de ces “lieux” de l’art et du beau. On y trouve des définitions du Beau, de l’art, accompagnées de parties consacrées aux mūstalaḥāt et aux mafāhim, c’est-à-dire des glossaires de terminologie et de concepts. C’est donc un grand chantier qui nous attend d’autant qu’il répond aux questions de l’heure parce que précisément les soufis et les auteurs soufis ont toujours été les hommes de leur présent.
Contrairement à ce qu’on pense, le lexique du Beau, al-jamāl, et celui de l’art, al-fan, ont été établis à l’aube de l’Islam, car ces deux aspects ont interpellé les milieux savants et, plus particulièrement, les milieux soufis et de ce fait, nous pouvons dire qu’ils ont développé tout à la fois une… -permettez-moi l’expression-, une “métaphysique du Beau en islam” et une “métaphysique de l’art islamique”. Et ces deux aspects trouvent leur fondement dans le Coran où sont énoncés les premiers principes repris et par les commentateurs du Coran, la spéculation philosophique et al-taṣawwuf.
Dans cette élaboration, ils ont tenu compte de l’impossible imitation du Créateur et des limites de l’homme. T. BURCKHARDT, à la suite de ses prédécesseurs soufis, part du Hadith qui dit : « “Dieu est beau” et Il aime la beauté (Allāhu jamīlun yuhibbu al-jamāl) » et explique : «cette parole du Prophète ouvre des perspectives illimitées, non seulement pour la vie intérieure, où la beauté aimée par Dieu est avant tout celle de l'âme, mais aussi pour l’art, dont le vrai but, compris à la lumière de cet enseignement prophétique, est de prêter un support à la contemplation de Dieu. Car la beauté est le rayonnement de Dieu dans l’univers, et toute oeuvre belle en est un reflet. » (BURCKHARDT 1976, 9) S’appuyant sur ce même Hadith, « “Dieu est beau” et Il aime la beauté (Allāhu jamīlun yuhibbu al-jamāl) » MICHON affirme qu’il « peut être regardé comme le fondement doctrinal de l’esthétique musulmane. » (MICHON 1994, 56)
V- DEUX CHEMINANTS PARLENT DE L’ART ET DE LA BEAUTÉ
Si, de siècle en siècle, les soufis du monde arabo-musulman ont médité ce Hadith et développé, à sa lumière, un arsenal lexical et conceptuel, certains auteurs plus récents du monde arabo-musulman et d’Europe, d’orientation académique (philosophie, anthropologie, histoire de l’art) ou soufie, vont se pencher sur leur corpus pour dégager la dimension esthétique à la fois intérieure et extérieure du musulman, d’une part, et définir à partir de là, la compréhension des réalisations esthétiques et artistiques musulmanes, d’autre part. Parmi les nombreux travaux dans ce domaine, je retiens, aujourd’hui, ceux de deux hommes de terrain, aux parcours particulièrement féconds à tous points de vue. Deux hommes qui vont entreprendre un voyage intérieur, lequel les conduira à en accomplir un autre, géographique, aux coeurs des villes marocaines, mais aussi d’autres villes musulmanes. Ces hommes, venus d’Europe, vont l’un et l’autre, adopter le costume, marocain, apprendre la langue arabe, embrasser la foi musulmane, approfondir leur quête dans l’initiation soufie, tout en assumant des charges dans le cadre de l’UNESCO…
Ils ne se sont pas penchés sur un art primitif avec des yeux civilisés, mais entrepris une compréhension de l’art, de la foi, de l’intérieur. Ce voyage les conduira à la découverte des “Connaissants par Dieu”, ils se feront des “Pauvres en Dieu”, deviendront des “cheminants” et s’initieront à “al-Ihsān” autrement dit al-taṣawwuf. C’est ainsi que l’un d’eux bien que fasciné, dit-il par « [les] rencontres humaines d’une qualité particulière qui vont de l’appel du muezzin entendu dès la première aube en terre musulmane à la sereine géométrie des arabesques et à l’accueil digne et chaleureux de l’artisan dans son échoppe ou du Bédouin dans sa tente », ce n’est pas par ces “traces visuelles et sonores” que lui et certains jeunes de sa génération ont connu l’Islam : « Notre démarche fut inverse et c’est de l’intérieur, par ses penseurs et ses mystiques, que l’Islam s’est révélé à nous. » Et précise-t-il un peu plus loin : « Ainsi, malgré tout ce qui nous séparait en fait de préjugés sociaux et idéologiques, l’Islam est venu apporter une réponse à nos interrogations. Cela se passait à un moment crucial de l’histoire contemporaine où, beaucoup de ceux qui la vivait, la tragédie du conflit planétaire remettait en question bien des croyances et des valeurs acquises […] » (MICHON 1994, 17-18)
Leur compréhension, leur réflexion, leur analyse de l’art et de la beauté, imprégnées d’une nouvelle foi, se feront, non plus cette fois-ci à partir de l’héritage de leur culture initiale, européenne, qu’ils maîtrisent du reste, mais à partir de leur propre cheminement, en tant que soufis en quête de réalisation, et à partir de certains travaux d’auteurs qui, ailleurs, ont, eux aussi, essayé de comprendre l’art et la beauté par-delà leur manifestation matérielle et émotionnelle, et par-delà les interprétations des courants occidentaux de l’art. Je pense, entre autres, à Coomaraswamy [2], lui-même éveillé et influencé par un autre européen soufi.
Comme cela fut dit plus haut, cette démarche va les conduire à chercher dans le Coran, les Hadiths et les écrits des soufis les fondements du Beau et sa transposition dans les réalisations sociales. C’est ainsi que T. BURCKHARDT écrit : « Il nous faut ouvrir nos considérations sur l’art de l’Islam par une description de la Kaaba et de son rôle liturgique, car son importance centrale pour l’art et surtout pour l’architecture islamique est évidente : on sait que tout musulman se tourne vers la Kaaba pour réciter les oraisons prescrites et que, par conséquent, toute mosquée est orientée dans cette direction […] » (BURCKHARDT 1985, 9).
Ce point de départ étant donné, non sans quelques explications préalables, l’auteur justifie ensuite “le langage formel” des manifestations artistiques et donc monumentales, visibles, motivées par le politique et le psychologique qui, souligne-t-il, ne constituent pas véritablement la source de l’art islamique, car, dit-il : « une réaction collective, de nature inévitablement sentimentale, ne peut pas engendrer un art dont l’équilibre interne défie les siècles. » (BURCKHARDT 1985)
T. BURCKHARDT et J.-L. MICHON, vont rattacher, à la manière des auteurs arabophones, l’interprétation des catégories de l’art depuis la lecture, al-tajwīd, la poésie, la calligraphie, l’architecture jusqu’au lambrissage, en passant par les disciplines artistiques de l’architecture, les entrelacs, les arabesques et les “arts décoratifs”, non pas à leur simple fonction ornementale, mais à des arts à part entière dont « Le langage formel […] est fidèle à l’esprit de l’Islam qui exclut le subjectivisme et les fantaisies prométhéennes. C’est une mathématique visuelle, mais dépourvue de caractère quantitatif et apparentée à la musique : une harmonie faite de régularité et de rythme continu.” (BURCKHARDT s.d., 2)
Selon T. BURCKHARDT, l’entrelacs exprime, sans aucun doute, la forme la plus satisfaisante, intellectuellement de l’unité divine soulignant la diversité inépuisable du monde. Cette « unité dans la diversité » (al-wahdah fi al-kathrah) ou « cette diversité dans l’unité » (al-kathrah fi al-wahdah) n’est autre que l’harmonie. Constitué d’un seul élément, qui se répète par symétrie, selon plusieurs axes, d’une ligne unique, multipliée à l’infini, l’entrelacs rappelle encore, à cet égard, « l’unité dans la diversité ». (Laurent GERVEREAU 2006)
Comme lui faisant écho, J.-L Michon écrit : « Par la géométrie, les artistes musulmans sont parvenus à illustrer visuellement une notion aussi sublime et mystique que celle du tajallī,du rayonnement infini de l’Essence divine à travers la multiplicité des plans de l’existence. Toute la philosophie de l’arabesque et de l’entrelacs, qu’il soit floral ou géométrique, comme celle du décor polygonal repose sur l’idée d’un centre omniprésent, qui se manifeste là où il veut, autant de fois qu’il veut, sans que rien dans sa nature soit affecté, augmenté ou diminué par cette apparition. » (MICHON 1994, 63)
Pour relever cette interprétation des formes, du “langage formel”, J.-L MICHON se fonde sur la sourate “Le Grumeau”, al-’alaq :
96.1. Lis, au Nom de ton Seigneur qui a créé,
96.2. a créé l'homme à partir d'un grumeau.
96.3. Lis ! Car ton Seigneur est le Généreux par excellence,
96.4. Celui qui a enseigné au moyen du calame,
96.5. a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas.
De cette injonction découle le ḏikr, pratique de la remémoration, la récitation et la psalmodie du Coran, la calligraphie : « Psalmodie, art qui porte le son des versets du Coran et les modules dans le temps ; calligraphie, art qui transcrit visuellement les vocables et les fixe dans l’espace… avec ces deux modes d’expression, nous nous trouvons à la source même de l’art musulman, source à laquelle, à travers les siècles, les artistes de l’Islam ne cesseront jamais de puiser leur inspiration. » (MICHON 1994, 54)
Et du fait que, selon un autre Hadith, « Dieu a prescrit la perfection –ou la beauté- en toute chose »
 «Il n’y a pas d’art pour l’art » nous dit T. BURCKHARDT. « Il est dans la nature de l’art de réjouir l’âme, mais tout art ne possède pas de facto, une dimension universelle. Dans le cas de l’art marocain, cette dimension se manifeste directement par la transparence intellectuelle, par le fait que cet art, avec son harmonie géométrique et rythmique, s’adresse non pas à une intelligence particulière plus ou moins empreinte de tendances passionnelles, mais à l’intelligence même dans ce qu’elle a d’universel. »
«Il n’y a pas d’art pour l’art » nous dit T. BURCKHARDT. « Il est dans la nature de l’art de réjouir l’âme, mais tout art ne possède pas de facto, une dimension universelle. Dans le cas de l’art marocain, cette dimension se manifeste directement par la transparence intellectuelle, par le fait que cet art, avec son harmonie géométrique et rythmique, s’adresse non pas à une intelligence particulière plus ou moins empreinte de tendances passionnelles, mais à l’intelligence même dans ce qu’elle a d’universel. »
Les deux auteurs, ensemble ou séparément, décrivent et analysent le langage formel tel qu’il est réalisé dans les monuments et les œuvres d’art, mais aussi tel qu’il est pratiqué dans la vie quotidienne des musulmans. Aussi consacrent-ils des travaux à l’étude de l’urbanisme arabo-musulman, urbanisme qui s’est efforcé de restituer par l’agencement de ses espaces l’unité divine caractéristique de l’Islam et qui, au-delà des aspects défensifs, sécuritaires, et politiques qui sont à l’œuvre dans les fondations des villes et des cités, souligne la dimension spirituelle qui élève l’homme de sa condition humaine vers son origine sacrée.
96.2. a créé l'homme à partir d'un grumeau.
96.3. Lis ! Car ton Seigneur est le Généreux par excellence,
96.4. Celui qui a enseigné au moyen du calame,
96.5. a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas.
De cette injonction découle le ḏikr, pratique de la remémoration, la récitation et la psalmodie du Coran, la calligraphie : « Psalmodie, art qui porte le son des versets du Coran et les modules dans le temps ; calligraphie, art qui transcrit visuellement les vocables et les fixe dans l’espace… avec ces deux modes d’expression, nous nous trouvons à la source même de l’art musulman, source à laquelle, à travers les siècles, les artistes de l’Islam ne cesseront jamais de puiser leur inspiration. » (MICHON 1994, 54)
Et du fait que, selon un autre Hadith, « Dieu a prescrit la perfection –ou la beauté- en toute chose »
Les deux auteurs, ensemble ou séparément, décrivent et analysent le langage formel tel qu’il est réalisé dans les monuments et les œuvres d’art, mais aussi tel qu’il est pratiqué dans la vie quotidienne des musulmans. Aussi consacrent-ils des travaux à l’étude de l’urbanisme arabo-musulman, urbanisme qui s’est efforcé de restituer par l’agencement de ses espaces l’unité divine caractéristique de l’Islam et qui, au-delà des aspects défensifs, sécuritaires, et politiques qui sont à l’œuvre dans les fondations des villes et des cités, souligne la dimension spirituelle qui élève l’homme de sa condition humaine vers son origine sacrée.
CONCLUSION
Par leurs travaux, T. BURCKHARDT et J.-L. MICHON nous invitent à une lecture de notre environnement artistique et esthétique avec la rigueur du cheminant qui n’oublie pas qu’il a été créé, que l’homme est créé en tant que Lieutenant sur terre pour adorer son Créateur. Cette dimension est un signe, l’être est un signe et il est entouré de signes qui lui rappellent la place qu’il occupe dans l’ordre de la création.
Nous pouvons, à raison, nous demander si cette vision de l’art et de l’esthétique fondée sur un “héritage du passé” a quelque utilité pour nous aujourd’hui ? Nous demander : « Pourquoi ce retour au passé ? » Ou encore : « Est-ce que ces cheminants ne sont pas dépassés devant la “modernité” ou la “postmodernité”, comme l’ont été certaines représentations physiques de la terre et certaines affirmations scientifiques, aujourd’hui complètement obsolètes ? » Je répondrais en disant d’abord que le terme “retour” est illusoire. Il n’y a pas, à proprement parler, de retour au passé –si ce n’est sous forme pathologique ! Et j’ajouterais avec insistance qu’il n’est rien de ce que nous savons qui nous vient du futur ! Certains parlent du passé comme si, ayant rompu avec lui, ils se ressourçaient à partir d’une temporalité qui se trouverait au-devant d’eux ! La double illusion s’inscrit non dans ce que l’on appelle le passé, mais dans le retour chimérique ou la négation du passé. Si chronologiquement, il se situe derrière nous, cela ne signifie pas que nous en avons réalisé le meilleur. Bien des choses, des notions, des vérités du passé sont encore devant nous. Comme nous l’ont enseigné nos prédécesseurs parce qu’ils l’ont été en leur temps, essayons avec notre passé d’être des « Hommes du Présent ».
Khireddine MOURAD
Marrakech
Octobre-novembre 2014
Marrakech
Octobre-novembre 2014
_______________________________
[1]
[2] - « Toutefois, c’est surtout le Cinghalais Ananda K. Coomaraswamy (1877-1947) érudit polyglotte qui, dans les années 1930-1940, alors conservateur au Musée des Beaux-Arts de Boston, développa les thèses de Guénon, en les appliquant aux domaines de l’art et des religions surtout indiennes, et en les étayant par un appareil de références de caractère universitaires. » (RINGGENBERG 2011, 10) « C’est à la charnière des années 1920-1930 que la pensée de Coomaraswamy opère un nouveau tournant. Coomaraswamy a découvert les livres de Guénon à la fin des années 1920, alors même qu’il s’intéresse de plus en plus à l’iconographie, à la philologie et aux religions indiennes, ce qui le conduit à publier, en 1928 et 1931, des études sur la cosmologie de l’eau (Yakṣas) […]. Cette évolution est sans toute due à la conjonction de plusieurs facteurs : une situation sentimentale apaisée, peut-être une nouvelle conscience de la mort, l’influence de Guénon avec lequel il communique dès 1935. (RINGGENBERG 2011, 23)
[1]
[2] - « Toutefois, c’est surtout le Cinghalais Ananda K. Coomaraswamy (1877-1947) érudit polyglotte qui, dans les années 1930-1940, alors conservateur au Musée des Beaux-Arts de Boston, développa les thèses de Guénon, en les appliquant aux domaines de l’art et des religions surtout indiennes, et en les étayant par un appareil de références de caractère universitaires. » (RINGGENBERG 2011, 10) « C’est à la charnière des années 1920-1930 que la pensée de Coomaraswamy opère un nouveau tournant. Coomaraswamy a découvert les livres de Guénon à la fin des années 1920, alors même qu’il s’intéresse de plus en plus à l’iconographie, à la philologie et aux religions indiennes, ce qui le conduit à publier, en 1928 et 1931, des études sur la cosmologie de l’eau (Yakṣas) […]. Cette évolution est sans toute due à la conjonction de plusieurs facteurs : une situation sentimentale apaisée, peut-être une nouvelle conscience de la mort, l’influence de Guénon avec lequel il communique dès 1935. (RINGGENBERG 2011, 23)