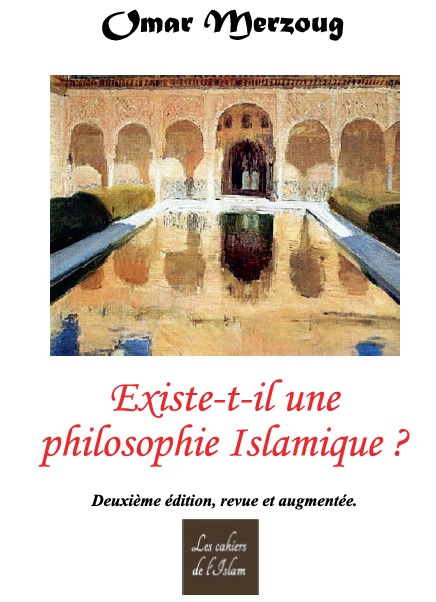Publication en collaboration avec l'Observatoire de la Vie Politique Turque .
À l’heure où les Etats-Unis tentent de rassembler une coalition internationale contre «l’Etat islamique» dans le sillage des frappes aériennes qu’ils conduisent depuis plusieurs semaines contre ce dernier en Irak et désormais en Syrie, la difficulté à enrayer la progression de l’organisation djihadiste reste entière, comme le montre l’actuel épisode tragique du siège de Kobâne.
Une réalité territoriale djihadiste
Il faut bien comprendre que cette progression, parfois perçue en Occident comme le résultat d’un processus irrationnel issu du fanatisme et de la radicalisation de certains groupes et individus, est en réalité un phénomène produit par l’évolution des équilibres politiques et stratégiques dans la région, depuis l’intervention américaine en Irak en 2003 et le début de la guerre civile en Syrie en 2011-12. Partie des zones irakiennes sunnites qui ont mal vécu la marginalisation des Arabes sunnites dans le nouvel Etat fédéral irakien (dominé par les Chiites et où les Kurdes ont gagné une forte autonomie), l’organisation djihadiste s’est implantée facilement en Syrie et n’a cessé de prospérer dans des zones à majorité sunnites pauvres, laissées pour compte de la modernisation et de la libéralisation économique de Bachar el-Assad. Ancré sur un territoire où il développe son influence, recrute ses troupes et exploite désormais des ressources pétrolières considérables, le pseudo «Etat islamique» (EI) s’emploie ainsi à unifier et à sécuriser ses récentes conquêtes, en éliminant les poches de résistance «cosmopolites» et «hérétiques» qui s’opposent encore au califat qu’il prétend avoir établi.
Une réalité territoriale djihadiste
Il faut bien comprendre que cette progression, parfois perçue en Occident comme le résultat d’un processus irrationnel issu du fanatisme et de la radicalisation de certains groupes et individus, est en réalité un phénomène produit par l’évolution des équilibres politiques et stratégiques dans la région, depuis l’intervention américaine en Irak en 2003 et le début de la guerre civile en Syrie en 2011-12. Partie des zones irakiennes sunnites qui ont mal vécu la marginalisation des Arabes sunnites dans le nouvel Etat fédéral irakien (dominé par les Chiites et où les Kurdes ont gagné une forte autonomie), l’organisation djihadiste s’est implantée facilement en Syrie et n’a cessé de prospérer dans des zones à majorité sunnites pauvres, laissées pour compte de la modernisation et de la libéralisation économique de Bachar el-Assad. Ancré sur un territoire où il développe son influence, recrute ses troupes et exploite désormais des ressources pétrolières considérables, le pseudo «Etat islamique» (EI) s’emploie ainsi à unifier et à sécuriser ses récentes conquêtes, en éliminant les poches de résistance «cosmopolites» et «hérétiques» qui s’opposent encore au califat qu’il prétend avoir établi.

© Reuters
L’impuissance des acteurs locaux et internationaux
Face à cette réalité terroriste territoriale, les frappes internationales risquent de rester de vertueux coups d’épée dans l’eau, si elles ne peuvent pas être relayées par des contre-offensives au sol. Or les puissances impliquées dans l’intervention ont exclu pour l’instant le recours à ce genre de moyens, les seules actions militaires terrestres ne peuvent venir que d’une mobilisation corrélative des adversaires régionaux immédiats de l’EI. Ce scénario butte néanmoins sur de nombreux obstacles. Difficile en effet, pour Washington et ses alliés, de conclure une alliance, même de circonstances, avec ce qui reste du régime de Bachar el-Assad, pour des raisons tant éthiques que stratégiques (Damas est l’allié de Téhéran et de Moscou). Et ce, bien que le régime baasiste qui, ces derniers jours, a ostensiblement annoncé qu’il avait satisfait aux exigences onusiennes concernant la destruction de son stock d’armes chimiques, ne cesse de manifester son désir de revenir dans le jeu international en faisant valoir qu’il combat lui aussi le terrorisme!
La coalition internationale ne peut guère plus compter sur l’Etat fédéral irakien. La débâcle de l’armée de celui-ci dans le nord de l’Irak n’a pas seulement des origines militaires, mais aussi des raisons identitaires. En dépit de quelques contre-offensives victorieuses, ses forces armées, composées pour l’essentiel de chiites, ne sont pas disposées à mourir pour des territoires sunnites qui ne sont pas ceux de ses soldats. Quant aux Kurdes, ils ont été les plus actifs en Irak et en Syrie pour s’opposer militairement à l’Etat islamique, remportant quelques francs succès. Mais eux-aussi combattent avant tout pour défendre leurs territoires et leurs populations et n’y parviennent pas toujours.
Dans un tel contexte d’impuissance, les regards, voire beaucoup d’espoirs, se sont portés vers la Turquie, membre de l’OTAN et traditionnelle alliée de l’Occident dans la région. Et pourtant, ce pays ne semble pas pressé de se joindre aux frappes aériennes de ses alliés et encore moins de s’engager dans des actions militaires au sol. Ce manque d’empressement surprend, mais là encore s’explique par une série de raisons structurelles et conjoncturelles.
Face à cette réalité terroriste territoriale, les frappes internationales risquent de rester de vertueux coups d’épée dans l’eau, si elles ne peuvent pas être relayées par des contre-offensives au sol. Or les puissances impliquées dans l’intervention ont exclu pour l’instant le recours à ce genre de moyens, les seules actions militaires terrestres ne peuvent venir que d’une mobilisation corrélative des adversaires régionaux immédiats de l’EI. Ce scénario butte néanmoins sur de nombreux obstacles. Difficile en effet, pour Washington et ses alliés, de conclure une alliance, même de circonstances, avec ce qui reste du régime de Bachar el-Assad, pour des raisons tant éthiques que stratégiques (Damas est l’allié de Téhéran et de Moscou). Et ce, bien que le régime baasiste qui, ces derniers jours, a ostensiblement annoncé qu’il avait satisfait aux exigences onusiennes concernant la destruction de son stock d’armes chimiques, ne cesse de manifester son désir de revenir dans le jeu international en faisant valoir qu’il combat lui aussi le terrorisme!
La coalition internationale ne peut guère plus compter sur l’Etat fédéral irakien. La débâcle de l’armée de celui-ci dans le nord de l’Irak n’a pas seulement des origines militaires, mais aussi des raisons identitaires. En dépit de quelques contre-offensives victorieuses, ses forces armées, composées pour l’essentiel de chiites, ne sont pas disposées à mourir pour des territoires sunnites qui ne sont pas ceux de ses soldats. Quant aux Kurdes, ils ont été les plus actifs en Irak et en Syrie pour s’opposer militairement à l’Etat islamique, remportant quelques francs succès. Mais eux-aussi combattent avant tout pour défendre leurs territoires et leurs populations et n’y parviennent pas toujours.
Dans un tel contexte d’impuissance, les regards, voire beaucoup d’espoirs, se sont portés vers la Turquie, membre de l’OTAN et traditionnelle alliée de l’Occident dans la région. Et pourtant, ce pays ne semble pas pressé de se joindre aux frappes aériennes de ses alliés et encore moins de s’engager dans des actions militaires au sol. Ce manque d’empressement surprend, mais là encore s’explique par une série de raisons structurelles et conjoncturelles.
La traditionnelle réserve de la diplomatie turque
Structurellement d’abord, rappelons que, depuis la fondation de la République, la Turquie a toujours évité de s’impliquer dans des conflits internationaux ou de voisinage. Depuis la Première guerre mondiale, elle n’a guère participé qu’à deux opérations militaires d’envergure (la projection de corps expéditionnaires en Corée en 1952 et à Chypre en 1974). Au cours des deux dernières décennies, elle a certes régulièrement mené des actions transfrontalières en Irak contre les bases arrière du PKK (en s’appuyant sur une disposition du traité anglo-irakien de 1926). Mais elle n’a guère manifesté d’enthousiasme pour les interventions internationales initiées par ses alliées dans son environnement proche. Ainsi, en 1990-91, elle ne s’est pas impliquée militairement dans la guerre du Golfe. En 2003, elle a refusé que les troupes américaines attaquent Saddam Hussein à partir de son territoire. En 2011, elle n’a pas participé militairement à la coalition en Libye, en ne lui apportant qu’une aide logistique, après l’avoir durement critiquée à ses débuts. Enfin s’il est vrai que les troupes turques ont plus souvent qu’auparavant été projetées sur des théâtres extérieurs, au cours des dernières années, c’est surtout pour servir au maintien de la paix (Balkans, Liban), soutenir des opérations de police (lutte contre la piraterie dans la Corne de l’Afrique), ou apporter une aide logistique n’impliquant pas une participation directe à des opérations militaires (Afghanistan).
L’implication initiale ambiguë de la Turquie dans la crise syrienne
Toutefois, après que la rébellion contre Bachar el-Assad soit devenue en quelques mois une guerre civile, la Turquie n’est pas restée inactive pour provoquer la chute de celui avec lequel elle avait entretenu d’excellentes relations entre 2007 et 2011. Sans se laisser militairement entrainer dans un conflit avec le régime syrien, mais souhaitant sa chute rapide après avoir rompu avec lui pendant l’été 2011, le gouvernement turc apporte d’abord son appui à l’opposition syrienne sous diverses formes, sans trop se préoccuper de la nature des mouvements qui profitent de ce soutien. Après la perte par l’armée de Damas du contrôle de sa frontière avec la Turquie (mi-2012), celle-ci devient à plus forte raison la base arrière de l’opposition syrienne. Or, cette opposition change rapidement. L’année 2013 voit notamment les mouvements islamistes les plus radicaux marginaliser les forces syriennes modérées, notamment l’Armée libre syrienne (ASL). Parmi ces mouvements «l’Etat islamique en Irak et au Levant» (EIIL, devenu par la suite «l’Etat islamique», EI) est le plus entreprenant et ne tarde pas à défaire militairement non seulement l’ASL, mais d’autres mouvements islamistes comme à Al Nosra.
A partir de l’automne 2013, au regard des l’évolution des forces sur le terrain, la Turquie commence à s’inquiéter de l’ampleur de la suprématie que les mouvements djihadistes les plus radicaux sont en train d’acquérir sur le reste de l’opposition syrienne en voie de marginalisation. Pendant l’été 2013, des contacts ont eu lieu avec le leader kurde syrien du PYD, Saleh Muslim, autre adversaire de ces forces radicales dans le nord de la Syrie. Certains évoquent alors un rapprochement entre Kurdes syriens et Ankara et voient même dans l’attentat contre l’ambassade turque à Mogadiscio, fin juillet, un avertissement des djihadistes à une Turquie en train de changer son fusil d’épaule. À cette époque la Turquie commence à répéter à l’envie qu’elle n’a jamais apporté un soutien même tacite aux mouvements islamistes en Syrie. En décembre 2013, elle annonce que, depuis le début de la guerre civile, elle a déjà expulsé 1100 militants islamistes, venus de pays européens, qui tentaient de passer par son territoire pour aller combattre en Syrie. Au début de l’année 2014, après les affrontements qui dans le nord de la Syrie voit l’EIIL accroître encore ses zones d’influence et marginaliser tant l’opposition syrienne modérée que ses rivaux djihadistes, Ahmet Davutoğlu évoque pour la première fois évoqué l’idée d’une convergence objective sur le terrain entre ce mouvement et le régime de Bachar el-Assad. Mais, à la même époque, la saisie par hasard dans la province d’Adana par la gendarmerie turque de sept camions de matériel qui se révèleront appartenir au MIT (services turcs de renseignement) relance les interrogations sur l’opacité du jeu qui est celui de la Turquie en Syrie.
La Turquie face à «l’Etat islamique»
Quoiqu’il en soit, la première confrontation directe entre l’EIIL et le gouvernement turc a lieu en mars 2014, lorsque l’organisation djihadiste commence à menacer la tombe de Süleyman Shah (une enclave territoriale turque à 20 km de la frontière). Tant l’ex-président Gül que Recep Tayyip Erdoğan font alors savoir leur détermination à défendre l’enclave. Fin mars, à la veille des élections locales, le sort de la tombe de Süleymen Shah croise par ailleurs l’affaire des écoutes téléphoniques qui secoue la vie politique turque. Une écoute à distance du ministère des affaires étrangères, publiée dans la presse et qui fait scandale, révèle en effet le contenu d’une réunion où Hakan Fidan (le chef des services de renseignement turcs) et Ahmet Davutoğlu (alors ministre des affaires étrangères) envisagent une intervention contre l’EIIL pour dégager la tombe de Suleyman Shah. Au printemps 2014, la presse turque commente abondamment les méfaits de l’EIIL sur les territoires que l’organisation contrôle : exécutions sommaires de membres de mouvements rivaux, crucifixions de personnes condamnées, décapitations, destructions de monuments historiques jugés «impies»… Il faut dire que cette situation concerne au premier chef la Turquie, car elle accroît encore le nombre des réfugiés qui affluent sur son territoire.
En juin 2014, fort de ses possessions en Syrie, l’EI lance une offensive en Irak et à la surprise générale se rend rapidement maître de Mossoul. En dépit de la soudaineté de l’attaque, le ministère turc des affaires étrangères aurait pu évacuer le personnel de son consulat dans cette ville. Mais il ne le fait pas, évoquant des raisons confuses après avoir été semble-t-il persuadé que l’organisation djihadiste respecterait l’intégrité de son poste consulaire. 49 personnes (les personnels dont le Consul et leurs familles) se retrouvent ainsi prises en otage et il faudra plus de 100 jours pour les faire libérer. Pendant l’été 2014, alors que les Américains commencent à lancer de premières frappes pour réagir à une nouvelle expansion de l’EI, qui provoque l’exode de chrétiens et de Kurdes yazidis en Irak et menace les zones kurdes syriennes, la Turquie se trouve handicapée par la situation des otages.
Au moins cette situation a-t-elle un avantage pour Ankara, celui de la dispenser de prendre position et d’entrer dans la coalition qui se forme alors laborieusement sans son engagement réel pour combattre l’EI. Pourtant, le 20 septembre, lorsque les otages sont libérés, la pression s’accroit sur la Turquie dont le président loin de s’exprimer explicitement demeure laconique et évoque une participation «flexible» à la coalition. Le 24 septembre, alors que les Etats-Unis commencent à frapper l’EI en Syrie après l’avoir attaqué en Irak, Ankara éprouve le besoin de démentir que des bases aériennes turques aient servi dans ces opérations. De toute évidence, la Turquie continue de vouloir se tenir à l’écart. Pourtant, la situation a encore évolué sur le terrain. A la veille de la libération des otages, fuyant les combats consécutifs à l’attaque de l’enclave de Kobâne, plus de 160 000 Kurdes syriens se sont réfugiés en Turquie. Dans ce contexte, des chars turcs prennent position sur la frontière et le gouvernement fait voter par le parlement une extension des possibilités d’actions militaires en Irak et en Syrie, résultant de résolutions adoptées au cours des années précédentes. La presse internationale croit voir enfin la Turquie sortir de sa réserve…
La poursuite du non-engagement turc
Pour autant, on oublie que ces motions parlementaires ne sont pas des décisions réelles d’intervention mais des cadres pour de possibles opérations, et les débats et polémiques qui les ont précédées sont édifiants. Le gouvernement, en effet, a conditionné sa participation à la coalition contre l’EI à une intervention dirigée aussi contre le régime de Bachar el-Assad. C’est ce qui a conduit le CHP et le HDP à ne pas soutenir les motions en question, en estimant que l’EI n’en était pas la première cible. Sur le terrain, cette orientation se confirme. Alors même qu’elles avaient laissé passé des militants kurdes pour aller épauler les combattants de Kobâne, dans un premier temps, les autorités turques les bloquent désormais sur la frontière. Comme on pouvait s’y attendre, une telle évolution provoque un croisement des dimensions internationale et nationale du problème kurde. Lors de son investiture, Ahmet Davutoğlu a fait de la relance du processus du règlement de la question kurde une priorité de la politique de son gouvernement. Mais peut-il espérer poursuivre une telle stratégie, si l’EI parvient à se rendre maître de la ville kurde syrienne ? De sa prison d’İmralı, le leader du PKK, Abdullah Öcalan fait savoir que le processus en question s’éteindrait si jamais un massacre avait lieu à Kobâne. Pour l’heure, le discours des principaux dirigeants turcs reste difficile à décrypter. D’un côté, le 2 octobre, Ahmet Davutoğlu, approuvé par le leader kurde turc (candidat du HDP à la dernière élection présidentielle) Selahattin Demirtaş, a dit souhaiter que Kobâne demeure kurde, de l’autre, deux jours plus tard, Recep Tayyip Erdoğan, a renvoyé le PKK et l’EI dos-à-dos en expliquant qu’il s’agissait ni plus ni moins que de mouvements terroristes similaires ; ce qui dans un tel contexte est d’autant plus lourd de sens que le président turc a aussi répondu implicitement à Abdullah Öcalan, en se demandant pourquoi le sort de la ville kurde syrienne assiégée devrait conditionner celui du sud-est de la Turquie.
Pour l’heure, les Turcs paraissent surtout préoccupés par l’idée de sécuriser les positions de l’ASL dans le nord de la Syrie. Le 4 octobre 2014 d’ailleurs, les services de renseignement turcs ont demandé à Saleh Muslim, le leader du PYD syrien de prendre clairement position contre le régime de Damas, de se démarquer du PKK et… de faire acte d’allégeance à l’ASL. Cette reprise de contact entre les Kurdes syriens et la Turquie (qui ne s’étaient pas parlés officiellement depuis 2013) annonce peut-être un changement dans l’attitude de la Turquie à l’égard de la situation de Kobâne (notamment l’acceptation que des renforts en hommes et en matériel transitent par le territoire turc), mais il est trop tôt pour le dire. Car jusqu’à présent, Ankara a plutôt affecté une posture de Ponce Pilate. Le sort tragique de Kobâne et le risque de déstabilisation qu’il représente avec de nouveaux flux migratoires en perspective n’ont eu raison ni de la traditionnelle réserve diplomatique turque, ni des calculs géopolitiques habituels : ne rien faire qui puisse favoriser les autres acteurs régionaux qu’ils se trouvent à Damas, Téhéran, Bagdad ou Moscou. Le gouvernement turc n’est certes pas le seul responsable d’une crise que les grands acteurs diplomatiques internationaux n’ont pas été en mesure de résoudre depuis le début. Mais une telle impuissance conjuguée ne peut que permettre à l’EI de prospérer.
Structurellement d’abord, rappelons que, depuis la fondation de la République, la Turquie a toujours évité de s’impliquer dans des conflits internationaux ou de voisinage. Depuis la Première guerre mondiale, elle n’a guère participé qu’à deux opérations militaires d’envergure (la projection de corps expéditionnaires en Corée en 1952 et à Chypre en 1974). Au cours des deux dernières décennies, elle a certes régulièrement mené des actions transfrontalières en Irak contre les bases arrière du PKK (en s’appuyant sur une disposition du traité anglo-irakien de 1926). Mais elle n’a guère manifesté d’enthousiasme pour les interventions internationales initiées par ses alliées dans son environnement proche. Ainsi, en 1990-91, elle ne s’est pas impliquée militairement dans la guerre du Golfe. En 2003, elle a refusé que les troupes américaines attaquent Saddam Hussein à partir de son territoire. En 2011, elle n’a pas participé militairement à la coalition en Libye, en ne lui apportant qu’une aide logistique, après l’avoir durement critiquée à ses débuts. Enfin s’il est vrai que les troupes turques ont plus souvent qu’auparavant été projetées sur des théâtres extérieurs, au cours des dernières années, c’est surtout pour servir au maintien de la paix (Balkans, Liban), soutenir des opérations de police (lutte contre la piraterie dans la Corne de l’Afrique), ou apporter une aide logistique n’impliquant pas une participation directe à des opérations militaires (Afghanistan).
L’implication initiale ambiguë de la Turquie dans la crise syrienne
Toutefois, après que la rébellion contre Bachar el-Assad soit devenue en quelques mois une guerre civile, la Turquie n’est pas restée inactive pour provoquer la chute de celui avec lequel elle avait entretenu d’excellentes relations entre 2007 et 2011. Sans se laisser militairement entrainer dans un conflit avec le régime syrien, mais souhaitant sa chute rapide après avoir rompu avec lui pendant l’été 2011, le gouvernement turc apporte d’abord son appui à l’opposition syrienne sous diverses formes, sans trop se préoccuper de la nature des mouvements qui profitent de ce soutien. Après la perte par l’armée de Damas du contrôle de sa frontière avec la Turquie (mi-2012), celle-ci devient à plus forte raison la base arrière de l’opposition syrienne. Or, cette opposition change rapidement. L’année 2013 voit notamment les mouvements islamistes les plus radicaux marginaliser les forces syriennes modérées, notamment l’Armée libre syrienne (ASL). Parmi ces mouvements «l’Etat islamique en Irak et au Levant» (EIIL, devenu par la suite «l’Etat islamique», EI) est le plus entreprenant et ne tarde pas à défaire militairement non seulement l’ASL, mais d’autres mouvements islamistes comme à Al Nosra.
A partir de l’automne 2013, au regard des l’évolution des forces sur le terrain, la Turquie commence à s’inquiéter de l’ampleur de la suprématie que les mouvements djihadistes les plus radicaux sont en train d’acquérir sur le reste de l’opposition syrienne en voie de marginalisation. Pendant l’été 2013, des contacts ont eu lieu avec le leader kurde syrien du PYD, Saleh Muslim, autre adversaire de ces forces radicales dans le nord de la Syrie. Certains évoquent alors un rapprochement entre Kurdes syriens et Ankara et voient même dans l’attentat contre l’ambassade turque à Mogadiscio, fin juillet, un avertissement des djihadistes à une Turquie en train de changer son fusil d’épaule. À cette époque la Turquie commence à répéter à l’envie qu’elle n’a jamais apporté un soutien même tacite aux mouvements islamistes en Syrie. En décembre 2013, elle annonce que, depuis le début de la guerre civile, elle a déjà expulsé 1100 militants islamistes, venus de pays européens, qui tentaient de passer par son territoire pour aller combattre en Syrie. Au début de l’année 2014, après les affrontements qui dans le nord de la Syrie voit l’EIIL accroître encore ses zones d’influence et marginaliser tant l’opposition syrienne modérée que ses rivaux djihadistes, Ahmet Davutoğlu évoque pour la première fois évoqué l’idée d’une convergence objective sur le terrain entre ce mouvement et le régime de Bachar el-Assad. Mais, à la même époque, la saisie par hasard dans la province d’Adana par la gendarmerie turque de sept camions de matériel qui se révèleront appartenir au MIT (services turcs de renseignement) relance les interrogations sur l’opacité du jeu qui est celui de la Turquie en Syrie.
La Turquie face à «l’Etat islamique»
Quoiqu’il en soit, la première confrontation directe entre l’EIIL et le gouvernement turc a lieu en mars 2014, lorsque l’organisation djihadiste commence à menacer la tombe de Süleyman Shah (une enclave territoriale turque à 20 km de la frontière). Tant l’ex-président Gül que Recep Tayyip Erdoğan font alors savoir leur détermination à défendre l’enclave. Fin mars, à la veille des élections locales, le sort de la tombe de Süleymen Shah croise par ailleurs l’affaire des écoutes téléphoniques qui secoue la vie politique turque. Une écoute à distance du ministère des affaires étrangères, publiée dans la presse et qui fait scandale, révèle en effet le contenu d’une réunion où Hakan Fidan (le chef des services de renseignement turcs) et Ahmet Davutoğlu (alors ministre des affaires étrangères) envisagent une intervention contre l’EIIL pour dégager la tombe de Suleyman Shah. Au printemps 2014, la presse turque commente abondamment les méfaits de l’EIIL sur les territoires que l’organisation contrôle : exécutions sommaires de membres de mouvements rivaux, crucifixions de personnes condamnées, décapitations, destructions de monuments historiques jugés «impies»… Il faut dire que cette situation concerne au premier chef la Turquie, car elle accroît encore le nombre des réfugiés qui affluent sur son territoire.
En juin 2014, fort de ses possessions en Syrie, l’EI lance une offensive en Irak et à la surprise générale se rend rapidement maître de Mossoul. En dépit de la soudaineté de l’attaque, le ministère turc des affaires étrangères aurait pu évacuer le personnel de son consulat dans cette ville. Mais il ne le fait pas, évoquant des raisons confuses après avoir été semble-t-il persuadé que l’organisation djihadiste respecterait l’intégrité de son poste consulaire. 49 personnes (les personnels dont le Consul et leurs familles) se retrouvent ainsi prises en otage et il faudra plus de 100 jours pour les faire libérer. Pendant l’été 2014, alors que les Américains commencent à lancer de premières frappes pour réagir à une nouvelle expansion de l’EI, qui provoque l’exode de chrétiens et de Kurdes yazidis en Irak et menace les zones kurdes syriennes, la Turquie se trouve handicapée par la situation des otages.
Au moins cette situation a-t-elle un avantage pour Ankara, celui de la dispenser de prendre position et d’entrer dans la coalition qui se forme alors laborieusement sans son engagement réel pour combattre l’EI. Pourtant, le 20 septembre, lorsque les otages sont libérés, la pression s’accroit sur la Turquie dont le président loin de s’exprimer explicitement demeure laconique et évoque une participation «flexible» à la coalition. Le 24 septembre, alors que les Etats-Unis commencent à frapper l’EI en Syrie après l’avoir attaqué en Irak, Ankara éprouve le besoin de démentir que des bases aériennes turques aient servi dans ces opérations. De toute évidence, la Turquie continue de vouloir se tenir à l’écart. Pourtant, la situation a encore évolué sur le terrain. A la veille de la libération des otages, fuyant les combats consécutifs à l’attaque de l’enclave de Kobâne, plus de 160 000 Kurdes syriens se sont réfugiés en Turquie. Dans ce contexte, des chars turcs prennent position sur la frontière et le gouvernement fait voter par le parlement une extension des possibilités d’actions militaires en Irak et en Syrie, résultant de résolutions adoptées au cours des années précédentes. La presse internationale croit voir enfin la Turquie sortir de sa réserve…
La poursuite du non-engagement turc
Pour autant, on oublie que ces motions parlementaires ne sont pas des décisions réelles d’intervention mais des cadres pour de possibles opérations, et les débats et polémiques qui les ont précédées sont édifiants. Le gouvernement, en effet, a conditionné sa participation à la coalition contre l’EI à une intervention dirigée aussi contre le régime de Bachar el-Assad. C’est ce qui a conduit le CHP et le HDP à ne pas soutenir les motions en question, en estimant que l’EI n’en était pas la première cible. Sur le terrain, cette orientation se confirme. Alors même qu’elles avaient laissé passé des militants kurdes pour aller épauler les combattants de Kobâne, dans un premier temps, les autorités turques les bloquent désormais sur la frontière. Comme on pouvait s’y attendre, une telle évolution provoque un croisement des dimensions internationale et nationale du problème kurde. Lors de son investiture, Ahmet Davutoğlu a fait de la relance du processus du règlement de la question kurde une priorité de la politique de son gouvernement. Mais peut-il espérer poursuivre une telle stratégie, si l’EI parvient à se rendre maître de la ville kurde syrienne ? De sa prison d’İmralı, le leader du PKK, Abdullah Öcalan fait savoir que le processus en question s’éteindrait si jamais un massacre avait lieu à Kobâne. Pour l’heure, le discours des principaux dirigeants turcs reste difficile à décrypter. D’un côté, le 2 octobre, Ahmet Davutoğlu, approuvé par le leader kurde turc (candidat du HDP à la dernière élection présidentielle) Selahattin Demirtaş, a dit souhaiter que Kobâne demeure kurde, de l’autre, deux jours plus tard, Recep Tayyip Erdoğan, a renvoyé le PKK et l’EI dos-à-dos en expliquant qu’il s’agissait ni plus ni moins que de mouvements terroristes similaires ; ce qui dans un tel contexte est d’autant plus lourd de sens que le président turc a aussi répondu implicitement à Abdullah Öcalan, en se demandant pourquoi le sort de la ville kurde syrienne assiégée devrait conditionner celui du sud-est de la Turquie.
Pour l’heure, les Turcs paraissent surtout préoccupés par l’idée de sécuriser les positions de l’ASL dans le nord de la Syrie. Le 4 octobre 2014 d’ailleurs, les services de renseignement turcs ont demandé à Saleh Muslim, le leader du PYD syrien de prendre clairement position contre le régime de Damas, de se démarquer du PKK et… de faire acte d’allégeance à l’ASL. Cette reprise de contact entre les Kurdes syriens et la Turquie (qui ne s’étaient pas parlés officiellement depuis 2013) annonce peut-être un changement dans l’attitude de la Turquie à l’égard de la situation de Kobâne (notamment l’acceptation que des renforts en hommes et en matériel transitent par le territoire turc), mais il est trop tôt pour le dire. Car jusqu’à présent, Ankara a plutôt affecté une posture de Ponce Pilate. Le sort tragique de Kobâne et le risque de déstabilisation qu’il représente avec de nouveaux flux migratoires en perspective n’ont eu raison ni de la traditionnelle réserve diplomatique turque, ni des calculs géopolitiques habituels : ne rien faire qui puisse favoriser les autres acteurs régionaux qu’ils se trouvent à Damas, Téhéran, Bagdad ou Moscou. Le gouvernement turc n’est certes pas le seul responsable d’une crise que les grands acteurs diplomatiques internationaux n’ont pas été en mesure de résoudre depuis le début. Mais une telle impuissance conjuguée ne peut que permettre à l’EI de prospérer.