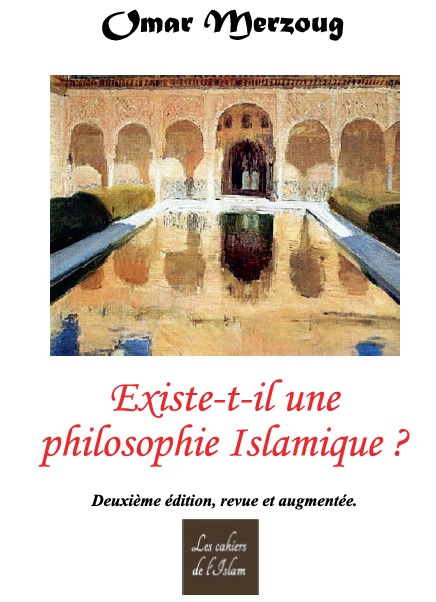Le renversement, le 3 juillet dernier, du président Mohamed Morsi par l’armée, suite à la grande manifestation du 30 juin, a accru significativement les désaccords existant entre l’Union européenne (UE) et la Turquie. Au cœur de ces dissensions : l’analyse de la crise égyptienne et le devenir des principes politiques qui sont en cause.

Les Turcs orgueilleusement seuls, les Occidentaux face à leurs propres valeurs
Le gouvernement de l’AKP a été l’un des seuls gouvernements de la région à dénoncer sans ambages un « coup d’Etat » en Egypte, en invoquant moins une solidarité politique avec les Frères musulmans que le respect des principes démocratiques qui veulent qu’un président légalement élu au suffrage universel ne puisse être destitué ni par la rue, ni par l’armée. La chute de Mohamed Morsi est intervenue au moment même où la Turquie confrontée au mouvement « Occupy Gezi ! », s’était vue plusieurs fois rappelée à l’ordre par des institutions européennes, lui recommandant de la retenue dans la gestion des manifestations et s’interrogeant sur son aptitude au respect des libertés, voire des valeurs européennes les plus élémentaires. Tête de file de ce turcoscepticisme, l’Allemagne de Madame Merkel, a même tiré largement argument de la crise de Taksim pour s’opposer à une ouverture du 22e chapitre de l’acquis communautaire, qui devait pourtant inaugurer une relance de la candidature turque, après le gel de la présidence tournante chypriote.

Alors même que l’armée intervient en Egypte, la Turquie a donc beau jeu de se retourner vers les Européens pour scruter leurs réactions à l’événement, à l’aune des principes démocratiques et humanitaires qui lui avaient été opposés, il y a quelques semaines. Sur le mode de la réponse du berger à la bergère, Recep Tayyip Erdoğan, s’en est donc pris à l’Union Européenne, le 5 juillet dernier, en dénonçant l’ambiguïté de ses prises de position embarrassées sur l’Egypte : « L’UE en particulier a une fois de plus violé ses propres valeurs, en n’appelant pas coup d’Etat un coup d’Etat. Je voudrais que les Européens relisent un peu l’acquis communautaire ! La démocratie ne peut tolérer les double-standards. », a martelé le premier ministre, lors du Congrès des scientifiques turcs expatriés, avant de poursuivre : « Où est donc cet Occident qui soutient la démocratie et prône son développement dans tous les pays ? On a là un test de sincérité et l’Occident ne l’a pas réussi. Les coups d’Etat démocratiques ça n’existe pas ! »
« Coup d’Etat » ou « Deuxième Révolution » ?
« Coup d’Etat », « Deuxième Révolution », « coup d’Etat démocratique », « processus de transition », une terminologie foisonnante et souvent hasardeuse s’est efforcée de caractériser ce qui s’est produit, le 3 juillet dernier, en Egypte. Au cœur de ce marché aux puces sémantiques, les notions de « légalité » et de « légitimité » constituent généralement les ports d’attache des navigateurs au long cours de cette nouvelle transition politique égyptienne. Une rupture de l’ordre constitutionnel est indiscutablement survenue en Egypte, lorsque l’armée a destitué le président Morsi en procédant de surcroît à son arrestation. Se drapant dans la légalité, les Frères musulmans ne veulent voir que cet aspect là des choses, auquel ils ajoutent l’atteinte portée à la légitimité politique d’un président sorti des urnes au terme d’une élection régulière. Dès lors, ils ne peuvent actuellement accepter un compromis avec les nouveaux maîtres de l’Egypte, qui signifierait qu’ils reconnaissent à la fois leur faillite propre dans l’exercice du pouvoir et la légitimité politique du régime transitoire mis en place. Car la justification de l’intervention militaire invoque pour l’essentiel cette faillite. L’armée prétend ne pas avoir été à l’origine de la déposition de Morsi. Dans une situation de déliquescence de l’Etat, elle n’aurait fait que prendre acte d’une sorte d’incapacité politique et économique du président élu à achever son mandat. Dès lors, elle serait intervenue pour sauver l’Etat d’une dislocation probable. Quant aux manifestants anti-Morsi, ils ont insisté sur le caractère massif des manifestations qui ont commencé le 30 juin et des pétitions qui les ont précédées. Ce sont ainsi les Egyptiens eux-mêmes, qui en descendant dans la rue, auraient en somme disqualifié le président à exercer le pouvoir, en lui faisant perdre la légitimité que les urnes lui avaient conférée, il y a un an…
Légalité, légitimité… Les Occidentaux sont manifestement gênés par le scénario égyptien. Quelle qu’ait pu être les difficultés de la situation antérieure, l’irruption de l’armée dans le processus politique est difficile à justifier, pour les tenants d’un système libéral et représentatif, mais l’incapacité de ces derniers à la qualifier de « coup d’Etat », évoque de leur part, une forme si ce n’est de reconnaissance, du moins de tolérance à laquelle ils sont manifestement prêts à consentir si d’aventure l’armée rend rapidement le pouvoir aux civils après des élections organisées en bonne et due forme. Rejetant ces faux semblant, les islamistes trouvent là une fois de plus l’occasion de dénoncer la duplicité des Occidentaux. Mais certain d’entre eux, comme l’intellectuel turc, Ali Bulaç s’interroge sur « l’incapacité des musulmans à faire aimer leur démocratie aux pays occidentaux… ». Les musulmans entrent dans le jeu politique, explique Bulaç, mais quand l’Occident se rend compte que ses affidés vont perdre, « il siffle la fin de la partie ! » Pas sûr pourtant que les choses soient aussi simples ? En Egypte, les Etats-Unis, pourtant loin de partager les idées des Frères, s’en sont accommodés, et les ont même soutenus jusqu’au bout, en tentant de décourager les opposants à Morsi d’organiser la grande manifestation du 30 juin. Pour ces efforts de dissuasion et son soutien à Mohamed Morsi, l’ambassadrice américaine au Caire, a été brocardée voire insultée par les manifestants du 30 juin, qui en outre n’ont pas manqué de dénoncer la collusion des Frères avec l’impérialisme américain.
Légalité, légitimité… Les Occidentaux sont manifestement gênés par le scénario égyptien. Quelle qu’ait pu être les difficultés de la situation antérieure, l’irruption de l’armée dans le processus politique est difficile à justifier, pour les tenants d’un système libéral et représentatif, mais l’incapacité de ces derniers à la qualifier de « coup d’Etat », évoque de leur part, une forme si ce n’est de reconnaissance, du moins de tolérance à laquelle ils sont manifestement prêts à consentir si d’aventure l’armée rend rapidement le pouvoir aux civils après des élections organisées en bonne et due forme. Rejetant ces faux semblant, les islamistes trouvent là une fois de plus l’occasion de dénoncer la duplicité des Occidentaux. Mais certain d’entre eux, comme l’intellectuel turc, Ali Bulaç s’interroge sur « l’incapacité des musulmans à faire aimer leur démocratie aux pays occidentaux… ». Les musulmans entrent dans le jeu politique, explique Bulaç, mais quand l’Occident se rend compte que ses affidés vont perdre, « il siffle la fin de la partie ! » Pas sûr pourtant que les choses soient aussi simples ? En Egypte, les Etats-Unis, pourtant loin de partager les idées des Frères, s’en sont accommodés, et les ont même soutenus jusqu’au bout, en tentant de décourager les opposants à Morsi d’organiser la grande manifestation du 30 juin. Pour ces efforts de dissuasion et son soutien à Mohamed Morsi, l’ambassadrice américaine au Caire, a été brocardée voire insultée par les manifestants du 30 juin, qui en outre n’ont pas manqué de dénoncer la collusion des Frères avec l’impérialisme américain.
La faillite de Morsi justifie-t-elle l’avènement d’un «coaching militaro-technocratique» à l’égyptienne ?

Sans nier la légalité et la légitimité du président renversé, on ne peut pas non plus effacer d’un revers de main, la situation de rupture de l’ordre politique et social qui a dominé les derniers jours de la présidence Morsi et que j’ai pu personnellement évaluer en étant de passage au Caire à ce moment-là : coupures d’eau et d’électricité, pénurie d’essence, insécurité dans la rue, accroissement sans précédent du commerce informel, absence d’autorité du gouvernement sur une partie des ministères, disfonctionnement de nombreux services publics… Beaucoup d’Egyptiens sont retournés à Tahrir, un peu comme ils y étaient allés il y a deux ans et demi pour mettre un terme à la présidence Moubarak et parmi eux certains avaient voté Morsi en juin 2012. Un mouvement prévisible que m’avait annoncé un chauffeur de Taxi, au moment de l’élection de Morsi, alors que nous traversions la célèbre place qui paraissait renouer avec ses embouteillages d’antan : « Et si ça ne marche pas avec Morsi, on retourne à Tahrir ! », m’avait dit goguenard mon aurige… Force est de constater qu’un an plus tard le dernier discours de Morsi, hué et abondamment twitté par tous les opposants, n’était pas sans rappeler le dernier discours de Moubarak, un jour avant sa démission, accueilli par une forêt de chaussures brandies place Tahrir…
Reste à savoir si ce mouvement de contestation qualifié par ses partisans de « seconde révolution » n’a pas été suscité par une institution militaire qui constitue un véritable Etat dans l’Etat et si au bout du compte, l’on ne cherche pas à donner une couleur révolutionnaire et un fondement légitime à une entreprise factieuse savamment orchestrée. C’est ce qu’a laissé entendre le premier ministre turc, le 11 juillet dernier, lors d’un Iftar, organisé par les patrons islamistes de la MÜSIAD, en déclarant : « Dans le passé, les coups d’Etat militaires se déroulaient avec la prise de possession de la rue par l’armée, la déclaration de la loi martiale, la prise de contrôle de la radio et télévision. Aujourd’hui, ça commence par des manifestations illégales, l’occupation de lieux symboliques, l’action des réseaux sociaux, les militaires n’entrent en lice qu’après.» On aura compris que le leader de l’AKP tente en l’occurrence de faire l’amalgame entre le mouvement de contestation de Gezi et la «deuxième révolution» égyptienne. Ce genre de raisonnement avait déjà été avancé, il y a quelques semaines, lorsqu’Erdoğan avait fait un rapprochement hasardeux entre le «printemps turc» et «l’automne brésilien», pour dénoncer l’existence d’un complot international. Mais l’on sait qu’au cours de l’histoire, pour légitimer son immixtion dans le jeu politique, l’armée turque a souvent forcé le destin, en favorisant la contestation de gouvernements dont elle voulait voir la chute. L’épisode du «coup d’Etat post moderne» de 1997 a administré un bel exemple de ce type de démarche.
L’armée en Egypte a-t-elle organisé son retour au pouvoir en suscitant la contestation du premier président élu au suffrage universel par la rue ? Une chose est sûre, depuis la révolution des officiers libres de 1952, l’armée est restée le pilier incontournable du système politique égyptien, même si elle n’a pas toujours gouverné directement. Cela tient sans doute à la stature politique et économique de l’institution militaire en elle-même, mais cette situation est aussi le résultat des difficultés de la société égyptienne à engendrer un pouvoir civil crédible, durable et pour tout dire légitime. La Révolution du 25 janvier a confirmé cet état de fait. Moubarak parti, l’armée a encadré une période de transition particulièrement instable. On a cru qu’après son élection le président nouvellement élu avait pris la mesure de ses fonctions, lorsqu’il a renvoyé le Maréchal Tantaoui et bousculé les garde-fous que l’armée avait tenté d’ériger entre les deux tours de l’élection présidentielle. Certains annonçaient déjà que, comme l’AKP en Turquie, les Frères allaient en somme «civiliser» le système politique égyptien. En réalité, le «coup de palais» de Morsi, en août 2012, a surtout permis l’avènement d’une nouvelle génération de généraux quinquagénaires dont Abel Fattah el-Sissi, le nouveau chef d’état-major, est le pur représentant, tout en amenant l’armée à prendre du recul et à s’extraire de l’exercice direct du pouvoir qu’elle avait du assumer pendant la transition. Pour autant, en échouant par la suite à gouverner le pays, la présidence Morsi n’a pas su profiter de la fenêtre d’opportunité civile qu’elle s’était ouverte…
Reste à savoir si ce mouvement de contestation qualifié par ses partisans de « seconde révolution » n’a pas été suscité par une institution militaire qui constitue un véritable Etat dans l’Etat et si au bout du compte, l’on ne cherche pas à donner une couleur révolutionnaire et un fondement légitime à une entreprise factieuse savamment orchestrée. C’est ce qu’a laissé entendre le premier ministre turc, le 11 juillet dernier, lors d’un Iftar, organisé par les patrons islamistes de la MÜSIAD, en déclarant : « Dans le passé, les coups d’Etat militaires se déroulaient avec la prise de possession de la rue par l’armée, la déclaration de la loi martiale, la prise de contrôle de la radio et télévision. Aujourd’hui, ça commence par des manifestations illégales, l’occupation de lieux symboliques, l’action des réseaux sociaux, les militaires n’entrent en lice qu’après.» On aura compris que le leader de l’AKP tente en l’occurrence de faire l’amalgame entre le mouvement de contestation de Gezi et la «deuxième révolution» égyptienne. Ce genre de raisonnement avait déjà été avancé, il y a quelques semaines, lorsqu’Erdoğan avait fait un rapprochement hasardeux entre le «printemps turc» et «l’automne brésilien», pour dénoncer l’existence d’un complot international. Mais l’on sait qu’au cours de l’histoire, pour légitimer son immixtion dans le jeu politique, l’armée turque a souvent forcé le destin, en favorisant la contestation de gouvernements dont elle voulait voir la chute. L’épisode du «coup d’Etat post moderne» de 1997 a administré un bel exemple de ce type de démarche.
L’armée en Egypte a-t-elle organisé son retour au pouvoir en suscitant la contestation du premier président élu au suffrage universel par la rue ? Une chose est sûre, depuis la révolution des officiers libres de 1952, l’armée est restée le pilier incontournable du système politique égyptien, même si elle n’a pas toujours gouverné directement. Cela tient sans doute à la stature politique et économique de l’institution militaire en elle-même, mais cette situation est aussi le résultat des difficultés de la société égyptienne à engendrer un pouvoir civil crédible, durable et pour tout dire légitime. La Révolution du 25 janvier a confirmé cet état de fait. Moubarak parti, l’armée a encadré une période de transition particulièrement instable. On a cru qu’après son élection le président nouvellement élu avait pris la mesure de ses fonctions, lorsqu’il a renvoyé le Maréchal Tantaoui et bousculé les garde-fous que l’armée avait tenté d’ériger entre les deux tours de l’élection présidentielle. Certains annonçaient déjà que, comme l’AKP en Turquie, les Frères allaient en somme «civiliser» le système politique égyptien. En réalité, le «coup de palais» de Morsi, en août 2012, a surtout permis l’avènement d’une nouvelle génération de généraux quinquagénaires dont Abel Fattah el-Sissi, le nouveau chef d’état-major, est le pur représentant, tout en amenant l’armée à prendre du recul et à s’extraire de l’exercice direct du pouvoir qu’elle avait du assumer pendant la transition. Pour autant, en échouant par la suite à gouverner le pays, la présidence Morsi n’a pas su profiter de la fenêtre d’opportunité civile qu’elle s’était ouverte…
Il n’est pas sûr que l’armée ait souhaité revenir à l’exercice direct des affaires, comme l’affirme les Frères musulmans. La période transitoire de 2011-2012 a été pour elle une épreuve difficile à assumer. Mais il est probable qu’elle s’est fait une raison et que, dès lors qu’elle revient au cœur du jeu politique égyptien, elle risque de ne pas faire les choses à moitié et de favoriser l’émergence d’un système sécuritaire, lui permettant cette fois de «coacher» plus rigoureusement le gouvernement civil sans pour autant exercer directement le pouvoir. La nomination hier du nouveau gouvernement du technocrate Hazem al-Beblaoui, où le général Abdel Fettah al-Sissi, incontournable ministre de la défense, assume aussi les fonctions de vice-premier ministre, semble confirmer cette évolution…
Publication avec l'accord de L'Observatoire de la Vie Politique Turque .
Publication avec l'accord de L'Observatoire de la Vie Politique Turque .
*Jean Marcou, professeur de droit public à l’Institut d’études politiques de Grenoble, et pensionnaire scientifique à l’Institut français d’études anatoliennes d’Istanbul (IFEA), où il dirige depuis 2006 l’Observatoire de la vie politique turque (OVIPOT).