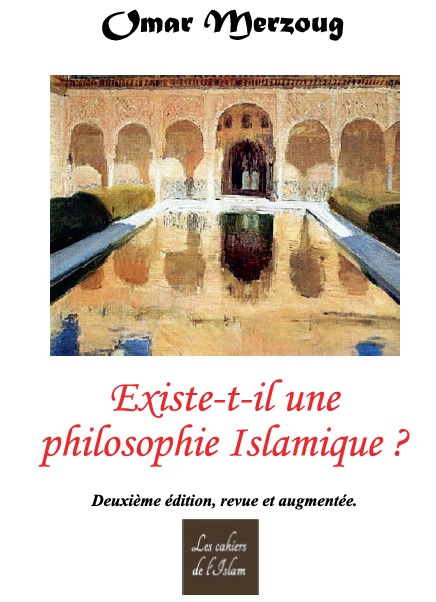La dépolitisation de l’enseignement de l’arabe
Dans les milieux académiques et journalistiques en particulier, les sujets maîtrisant suffisamment l’arabe pour mener des entretiens approfondis et analyser une collecte documentaire, sont réputés rares ou insuffisants.
De fait, suite au coup d’Etat postmoderne de 1997, un coup d’arrêt brutal a été porté à l’enseignement de l’arabe, qui avait prospéré en dehors des seules institutions dépendant de la Diyanet – écoles d’imam hatip (imams prédicateurs), facultés de théologie- au cours de la décennie 1990. Cet enseignement était notamment organisé par les confréries religieuses, financé par des ONG ou l’étranger –pays du Golfe-, et permettait à certains doctorants de théologie et de littérature arabe d’effectuer des séjours linguistiques dans divers pays du Proche-Orient. Au cours du « processus du 28 février », l’armée a rappelé le gouvernement Erbakan au respect du caractère séculaire du régime et l’a contraint à fermer les cours de lecture coranique et d’arabe ouverts ici et là, restreignant l’enseignement de l’arabe aux seuls lycées d’imams et facultés de théologie. Des personnalités officielles comme Yıldırım Aktuna, ministre de la santé de l’époque, déclarait ainsi en avril 1997 « le peuple turc n’a nul besoin d’apprendre l’arabe, pas plus que de s’arabiser » (voir l’article de Haber 365 du 1er mars 2011 ).
Il faut s’interroger également sur ce que représente la langue arabe en Turquie aujourd’hui. Le fait que celle-ci soit l’idiome originel du Coran lui confère une sorte de qualité particulière, supérieure ; le musulman pratiquant se sentira souvent forcé d’en acquérir les rudiments. Pour les Turcs qui ne bénéficient pas d’une familiarité ancienne, familiale, avec la langue arabe, apprendre l’arabe est difficile du fait de l’alphabet mais également des modalités de construction des phrases radicalement différents de leur langue maternelle.
Durant la période ottomane, des dizaines de milliers de mots arabes ont pénétré la langue administrative ottomane, l’Osmanlıca, ainsi que le turc vernaculaire. Si plusieurs milliers de ces mots d’origine arabe ont résisté à la turcification de la langue et à la romanisation de son alphabet depuis les années 1920, le sens de ces vocables s’est souvent éloigné de l’origine.
Quoiqu’il en soit, apprendre l’arabe, que ce soit pour lire le Coran ou pour faire des sciences sociales, semble avoir progressivement perdu de son caractère subversif au cours des années 2000 même si, dans l’enseignement supérieur turc, à l’échelle d’un département ou du rectorat de la faculté, l’ouverture de cours d’arabe peut encore susciter débat et cultiver de vieilles lignes de faille. Il semble en définitive que les cours d’arabe à l’université soient à mi-chemin entre une politisation contraignante et la logique d’offre et de demande. De plus, les institutions universitaires ou para-universitaires qui proposent cet enseignement ne nagent pas toutes dans le sillage du courant islamo-conservateur qui domine l’AKP. L’ouverture des cours d’arabe dans les universités publiques ou privées semble correspondre au moins autant à la prise de conscience d’une carence, à laquelle des collectifs de professeurs désirant organiser un pôle d’enseignement et de recherche centré sur le Moyen-Orient tentent de remédier. Cela paraît être le cas du département de sciences politiques de l’université d’Istanbul ou de celui de l’université du Bosphore, de l’Université de Marmara –hors Centre de recherche sur le Moyen-Orient-, de même que de l’université d’Ankara et de celle du Gazi (Ankara) par exemple. Le persan voire l’hébreu sont alors également proposés aux élèves.
De surcroît, ouvrir un cours d’arabe est d’ores et déjà sur le point de devenir un critère de conformité ou d’excellence pour les universités, centres de recherche et fondations éducatives –comme le Bilim ve Sanat Vakfı ou Yunus Emre Derneği- dont l’un des axes de la politique pédagogique consiste à offrir une formation de sciences sociales sur le Moyen-Orient. Côté débouché professionnel, dans les think-tanks turcs bénéficiant d’un budget suffisant pour constituer leurs propres équipes de chercheurs –SETA (Sosyal Ekonomik ve Toplum Araştırma Vakfı), USAK (Uluslararası Stratejik Araştırma Kurulu), ORSAM (Ortadoğu Stratejik Araştırma Merkezi), SDE (Stratejik Düşünce Enstitüsü) – les cadres dirigeants insistent sur l’importance accordée, dans les critères de recrutement, à l’aptitude linguistique dans la zone de spécialité.
Les lieux d’enseignement
Il semble qu’il ait toujours été possible pour les enfants turcs de se familiariser à l’arabe coranique auprès des imams. De nombreuses personnes – journalistes, directeurs de centre de recherche moyen-orientales, historiens, cadres de think-tanks etc.- ont ainsi reçu leurs premières leçons d’arabe de la part de clercs religieux sunnites dans diverses villes d’Anatolie ou à Istanbul.
Par ailleurs, les lycées dits « imam-hatıp », chargés de former le personnel clérical turc sunnite –les fonctionnaires de la Diyanet-, dispensent également un enseignement de langue arabe à leurs élèves. Les diplômés de ce type de lycée insistent sur le fait que l’arabe est enseigné –par des professeurs turcs- de telle manière qu’il ne sert qu’à décrypter le Coran et que même dans cet exercice, les résultants sont peu probants. L’apprentissage des sourates par cœur y serait plus valorisé que la maîtrise de la grammaire arabe.
L’arabe est aussi enseigné par des professeurs, le plus souvent turcs, dans les facultés de théologie. Parmi les étudiants en théologie d’Istanbul, d’Ankara et de Bursa, quelques contingents ont étudié une année en Jordanie, bénéficiant d’une filière établie à la fin des années 1980. Aucun sujet interviewé n’a mentionné avoir étudié l’arabe et la théologie à l’université islamique cairote d’Al-Azhar, centre islamique réputé, pas plus qu’à l’Université Islamique de Médine.
Ces dix dernières années, avec l’ouverture de centres de recherche et d’enseignement sur le Moyen-Orient au sein des facultés de sciences humaines turques –universités de Marmara, Sakarya, Bolu, Elazığ- ou tout au moins du développement des « études moyen-orientales » dans les départements et instituts de sciences sociales des universités –ÖDTÜ, Bilkent, Uludağ, Université d’Istanbul-, des cours d’arabe élémentaire puis intermédiaire ont ouvert, souvent assurés par des professeurs issus des facultés de théologie.
Par ailleurs, pour les activistes de gauche turcs qui ont combattu aux côtés des fedayins palestiniens dans les années 1970, ce surtout depuis les camps de réfugiés palestiniens du Liban, apprendre l’arabe « faisait partie du voyage », a fortiori pour ceux qui ont finalement été capturés par l’armée israélienne et emprisonnés plusieurs années. C’est le cas du journaliste et « conseiller des princes » Cengiz Çandar ou de l’essayiste Faik Bulut.
Il existe enfin et bien sûr des universitaires ou journalistes turcs qui maitrisent déjà bien un dialectal arabe proche du syro-libanais ou de l’irakien du fait de leur origine géographique, l’est et le sud-est, et familiale. Cependant ceux-ci-sont rares dans leur secteur d’activité et la connaissance d’un dialecte ne signifie pas toujours la maîtrise de l’arabe écrit.
Pour en terminer avec les lieux où s’enseigne l’arabe en Turquie, dans les rues d’Istanbul et d’Ankara, de plus en plus fréquemment des écoles privées de langues étrangères et des associations islamiques proposent par le biais d’affichettes collées à la va-vite, des cours d’arabe et de persan.
Tentative de classification des « Ortadoğucu » turcs à l’aune de la maîtrise de la langue arabe
En se basant sur les déclarations, il semble possible de proposer une classification en quatre types de « relation personnelle » à la langue arabe chez ces acteurs turcs de la production d’un savoir sur le monde arabe. Ainsi l’on trouvera tout d’abord ceux qui assument l’ignorance ou le désintérêt pour la langue en dépit d’un fort intérêt pour la zone. Ce sont là souvent des experts « transhumants », professeurs de relations internationales soucieux de suivre l’air du temps. Il y a également ceux qui confessent une maîtrise très limitée de la langue et l’expliquent par l’incompatibilité d’emploi du temps avec leurs activités professionnelles, l’absence de soutien financier ou le rejet des méthodes d’enseignement de cette langue en Turquie. On trouve par ailleurs des sujets affirmant bien maîtriser l’arabe dit littéral ou classique, c’est à dire être capable de lire n’importe quel texte en arabe et d’échanger à l’oral, mais concédant ne connaître aucun dialecte. La méconnaissance d’un dialecte prend occasionnellement l’accent du mépris pour cette langue vernaculaire non digne d’être apprise. Cette conception ignore la diglossie fondamentale de l’arabe et revient à attester du manque d’expérience de la zone. Enfin, il se trouve un échantillon encore très limité d’acteurs maîtrisant l’arabe standard et revendiquant la connaissance d’un ou plusieurs dialectes.
Les sujets des trois premières catégories pointent souvent le fait qu’ils ne sont pas des « experts » du Moyen-Orient. Lorsqu’ils sont interrogés sur leurs aptitudes linguistiques, ils réitèrent cette déclaration. Or, parmi ceux qui se sont par le passé construit une expertise dans une autre zone géographique –Balkans, Caucase, Europe de l’est etc.- rares sont ceux qui maîtrisent l’une des langues de cette zone. On comprend ainsi que l’apprentissage de la langue n’est pas considéré par ceux-là comme une composante déterminant de l’expertise régionale. Cette conviction est assez largement partagée par exemple chez les enseignants-chercheurs en relations internationales mais aussi dans le milieu journalistique.
L’aptitude linguistique en arabe peut occasionnellement être utilisée comme argument pour décrédibiliser tel ou tel autre acteur du champ, ce qui atteste de la compétition qui y règne et démontre que la maîtrise de la langue tend à être considérée comme une composante nécessaire de l’expertise, ce que l’exigence des think-tanks vis-à-vis des nouvelles recrues tend à prouver.
De manière générale, universitaires, journalistes et cadres de think-tanks déplorent le défaut d’expertise sur le monde arabe et pointent notamment du doigt la carence de personnes possédant une maîtrise suffisante de l’arabe. Il se trouve pourtant plusieurs centaines de milliers de turcs parfaitement arabophones dans la région sud-est mais rares sont ceux qui s’orientent vers les sciences sociales. Ce constat suggère que le rôle de « passeurs de savoir » et/ou d’intermédiaires entre monde arabe et Turquie n’est pas institutionnalisé, et que les représentations, les canaux relationnels et les cursus scolaires qui en favoriseraient l’institutionnalisation ne sont pas parvenus à maturité.