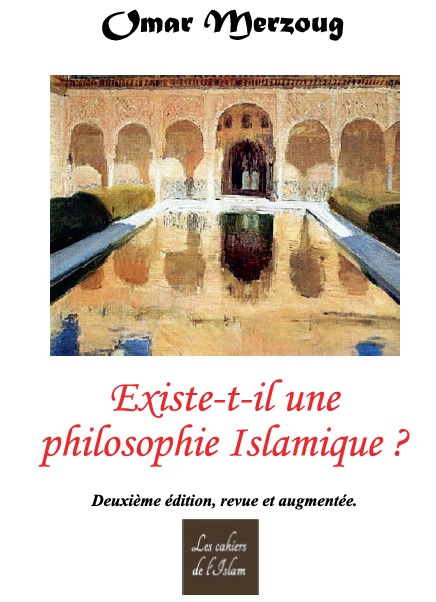Une mère palestinienne lit une histoire à ses enfants lors d’un atelier de lecture estival (AFP)
Par Bethan Staton pour Middle East Eye édition française
AMMAN - Taghreed Najjar était adolescente quand elle commença à inventer des histoires. Lectrice vorace ayant grandi dans un internat de Jérusalem dans les années 1960, ses premiers récits furent des histoires fantastiques narrant les aventures de son petit frère de trois ans, qu’elle racontait à ses autres plus jeunes frères et sœurs. Ces histoires prirent vie et, bientôt, Najjar se vit contrainte de les transcrire sur le papier.
« À l’époque, il n’y avait pas vraiment d’auteurs ou d’écrivains dont j’aurais pu m’inspirer », a-t-elle expliqué à Middle East Eye. « C’était très, très difficile, surtout en Jordanie. Il n’y avait aucun artiste pour illustrer les histoires pour enfants et les imprimeries n’étaient pas adaptées, d’un point de vue technique, pour ce genre de choses. Les images étaient toujours en noir et blanc car c’était moins cher. C’était un territoire inconnu. »
En ce temps-là, a expliqué Najjar, très peu d’avancées avaient été faites pour produire des livres pour enfants de qualité et originaux pour un public arabe : le marché était dominé par les importations en provenance de l’Ouest, des livres écrits en anglais dont le prix était plus souvent abordable et qui étaient très estimés des parents. Mais, ces dix dernières années, le secteur a connu un regain d’énergie spectaculaire – à tel point que les initiés parlent d’une renaissance, ou Nahda.
Certaines maisons d’édition, comme Kalimat, qui a produit plus de 155 livres depuis ses débuts en 2007, et Asala, fondée en 1999, ont acquis une excellente réputation pour leur production remarquable de littérature pour enfants.
Les récompenses décernées aux créateurs, telles qu’Etisalat, qui existe depuis cinq ans, donnent à ces derniers une raison de plus de rendre un travail de qualité exceptionnelle. Près de 40 ans après la publication de son premier livre, Najjar est considérée comme une pionnière. Elle est l’auteure de dizaines de livres, dont plusieurs ont été récompensés, et la fondatrice d’al-Salwa, l’une des meilleures maisons d’édition spécialisées en littérature enfantine de la région.
« Si ce n’est pas une renaissance, il existe certainement une tendance qui se dessine depuis ces sept dernières années », a affirmé Rania el-Turk, écrivain de Jordanie, à MEE. « De plus en plus de gens souhaitent non seulement apprendre l’arabe à leurs enfants mais surtout le leur faire aimer. Et je pense qu’il existe des tas d’autres raisons pour lesquelles il est intéressant d’offrir à nos enfants des livres de qualité en arabe. »
Le livre publié par Rania el-Turk à ses débuts, Ayn? (« Où ? »), est une histoire simple où les protagonistes partent à la recherche d’une coccinelle. C’est le premier livre d’images à rabats en arabe. L’idée est née de l’observation de l’auteure, selon laquelle les livres d’images tactiles, qui s’intégraient à la culture du pays (et rappelaient un contexte familier aux enfants de Jordanie, avec des descriptions d’images en arabe), n’existaient tout simplement pas. Rania el-Turk a aussi été inspirée par le travail qu’elle a réalisé dans le cadre de programmes éducatifs à Beyrouth, où elle a noté que l’illettrisme des mères et la méconnaissance des livres rédigés en arabe empêchaient aux enfants de développer un comportement positif à l’égard de la lecture.
« Les parents n’ont pas suffisamment conscience de cet enjeu, même ceux qui lisent », explique Rania el-Turk. « Nous ne disposons pas de listes dédiées aux publications en arabe, telles qu’un inventaire répertoriant 50 des meilleurs livres à lire. Je pense que nous sommes encore trop occupés à combler nos lacunes pour amorcer une prise de conscience. »
Elle n’est pas la seule à le remarquer. Rana Dajani, biologiste moléculaire de formation, explique que le manque d’intérêt pour une littérature enfantine de qualité tient en grande partie au fait que les parents de Jordanie lisent rarement des histoires à leurs enfants. Cette prise de conscience l’a poussée à lancer une initiative locale, We Love Reading, qui permet aux femmes de créer des groupes de lecture pour les enfants de leur voisinage.

Dans le livre de Najjar intitulé Le lapin de Karma, chacune des pages montre le lapin se cachant à un endroit différent. Le jeune lecteur est encouragé à participer à la recherche.
« Avant, les livres qui étaient mis à notre disposition étaient en noir et blanc ; les histoires étaient médiocres. Mais ces dix dernières années, on a assisté à une prolifération des publications pour enfants en arabe », explique Dajani. Pour elle, la poursuite de cette tendance dépendra de la création d’une atmosphère dans laquelle la lecture est valorisée et dans laquelle on lit plus par plaisir que par simple souci éducatif. « Si nous avons une culture de la lecture, les enfants demanderont un livre plutôt qu’un jouet. Ce que nous introduisons dans notre société, c’est la culture de la lecture, l’idée que la lecture est amusante, pour que les gens achètent des livres. »
Jusqu’à présent, l’initiative We Love Reading a permis d’établir 300 bibliothèques en Jordanie et a eu un impact direct sur 10 000 enfants. Les écrivains jordaniens comme Najjar et Abeer Taher el-Turk, dont le livre publié récemment, Un très vilain chat, s’est vu attribuer la prestigieuse récompense Etisalat, ont encensé le projet. Selon ces auteures, il est crucial pour le monde de l’édition de faire aimer la lecture aux enfants.
Pourtant, des problèmes subsistent. Pour Abeer, l’investissement dans des formations à destination des écrivains mais aussi des illustrateurs est un problème ; trouver les bons artistes capables de s’approprier ses histoires a été un vrai défi. « Pour avoir de bons écrivains, il faut mettre à disposition des cours universitaires spécialisés dans la littérature et l’illustration pour enfants », explique-t-elle. Aucun cours de ce type n’existe en Jordanie et, alors qu’il pourrait exister de nombreux artistes remarquables dans le pays, dessiner pour une jeune audience est un talent rare, qui se développe avec le temps.
Lorsque Najjar a débuté sa carrière d’écrivain, elle a été confrontée au même problème. Bien qu’elle ne soit pas une artiste, elle a dû illustrer son propre travail. Cependant, elle a connu son premier succès quand ses scripts ont été acceptés par Dar el-Fata el-Arabi en 1976. Véritable force révolutionnaire (dans tous les sens du terme) de la littérature pour enfants rédigée en arabe, la maison d’édition palestinienne fut fondée en 1974 par Yasser Arafat, œuvrant depuis Beyrouth pour produire des livres pour enfants qui défendaient la cause palestinienne ainsi que des sujets ayant une dimension moins politique.
« Dar el-Fata était partout. Elle a connu un succès sans précédent, a réussi à toucher l’ensemble du monde arabe et sa production s’est vendue à dix ou quinze milliers d’exemplaires - un chiffre inégalé, même aujourd’hui », explique Najjar. « Mais ce n’est pas le plus important. Ce qui est à retenir, c’est qu’elle produisait des livres. Des livres d’excellente qualité en termes de contenu, de conception et d’illustration, que les gens de la région n’avaient jamais vus ou dont ils n’avaient jamais fait l’expérience, sauf en ce qui concerne les livres étrangers.
« Le message, ici, était clair : les livres rédigés en arabe peuvent être tout aussi bien, sinon mieux. Histoire de dire : vous voyez, nous aussi nous pouvons le faire. »
Parmi les classiques publiés par Dar el-Fata, on peut compter le livre intitulé Al Bayt (« la maison »), de Zacharia Tamer, dont l’histoire est construite autour d’un récit simple. Tous les animaux ont une maison : la poule a un poulailler, le lapin a un terrier et le poisson a la rivière. Mais pas les Palestiniens. Leurs maisons leur avaient été dérobées par leurs ennemis, disait le livre : il faudrait recourir aux armes pour les reconquérir.
Jusqu’à présent, l’initiative We Love Reading a permis d’établir 300 bibliothèques en Jordanie et a eu un impact direct sur 10 000 enfants. Les écrivains jordaniens comme Najjar et Abeer Taher el-Turk, dont le livre publié récemment, Un très vilain chat, s’est vu attribuer la prestigieuse récompense Etisalat, ont encensé le projet. Selon ces auteures, il est crucial pour le monde de l’édition de faire aimer la lecture aux enfants.
Pourtant, des problèmes subsistent. Pour Abeer, l’investissement dans des formations à destination des écrivains mais aussi des illustrateurs est un problème ; trouver les bons artistes capables de s’approprier ses histoires a été un vrai défi. « Pour avoir de bons écrivains, il faut mettre à disposition des cours universitaires spécialisés dans la littérature et l’illustration pour enfants », explique-t-elle. Aucun cours de ce type n’existe en Jordanie et, alors qu’il pourrait exister de nombreux artistes remarquables dans le pays, dessiner pour une jeune audience est un talent rare, qui se développe avec le temps.
Lorsque Najjar a débuté sa carrière d’écrivain, elle a été confrontée au même problème. Bien qu’elle ne soit pas une artiste, elle a dû illustrer son propre travail. Cependant, elle a connu son premier succès quand ses scripts ont été acceptés par Dar el-Fata el-Arabi en 1976. Véritable force révolutionnaire (dans tous les sens du terme) de la littérature pour enfants rédigée en arabe, la maison d’édition palestinienne fut fondée en 1974 par Yasser Arafat, œuvrant depuis Beyrouth pour produire des livres pour enfants qui défendaient la cause palestinienne ainsi que des sujets ayant une dimension moins politique.
« Dar el-Fata était partout. Elle a connu un succès sans précédent, a réussi à toucher l’ensemble du monde arabe et sa production s’est vendue à dix ou quinze milliers d’exemplaires - un chiffre inégalé, même aujourd’hui », explique Najjar. « Mais ce n’est pas le plus important. Ce qui est à retenir, c’est qu’elle produisait des livres. Des livres d’excellente qualité en termes de contenu, de conception et d’illustration, que les gens de la région n’avaient jamais vus ou dont ils n’avaient jamais fait l’expérience, sauf en ce qui concerne les livres étrangers.
« Le message, ici, était clair : les livres rédigés en arabe peuvent être tout aussi bien, sinon mieux. Histoire de dire : vous voyez, nous aussi nous pouvons le faire. »
Parmi les classiques publiés par Dar el-Fata, on peut compter le livre intitulé Al Bayt (« la maison »), de Zacharia Tamer, dont l’histoire est construite autour d’un récit simple. Tous les animaux ont une maison : la poule a un poulailler, le lapin a un terrier et le poisson a la rivière. Mais pas les Palestiniens. Leurs maisons leur avaient été dérobées par leurs ennemis, disait le livre : il faudrait recourir aux armes pour les reconquérir.

Le livre de Tamer, Al Bayt, enseigne que tout le monde (la poule avec le poulailler, le lapin avec le terrier et le poisson avec la rivière) a une maison.
La politique explicite de Dar el-Fata a été l’un de ses principaux facteurs de succès : le message diffusé par les Palestiniens a rassemblé le monde arabe. Mais certains écrivains et artistes pensent qu’elle a aussi contribué à son déclin, limitant leur liberté en ce qui concerne la représentation des sujets qui leur plaisent. La maison d’édition fut fermée dans les années 1990. Pourtant, son succès avait apporté un important changement : une identité distinctement arabe dans le domaine de la littérature était née dans un environnement qui avait été envahi par les livres étrangers – une tendance dont l’ampleur était sans doute inquiétante.
« Pendant une longue période, les livres que les enfants recevaient et les personnages dépeints dans ces livres appartenaient à un univers étranger. Les maisons avaient l’air différent des nôtres, les policiers portaient des uniformes différents et même les traits des personnages semblaient étrangers. Même si ces livres étaient bons, [les lecteurs] ne pouvaient pas s’identifier entièrement », a expliqué Najjar au sujet des livres qui étaient disponibles dans les années 1970 et 1980.
« Étant donnés le Mandat britannique, l’occupation, etc., il y avait cette espèce de relation qui peut exister entre le gouverneur et le gouverné, dans le contexte de la colonisation. Le fait que les livres que nous lisions, que nous étudions, étaient produits par ceux qui nous gouvernaient et qui occupaient notre pays accentuait en quelque sorte cette relation.
« En ce qui me concerne, quand j’ai commencé à écrire, je pensais à tous ces enfants qui ne lisent pas, qui n’aiment pas les livres rédigés en arabe », a expliqué Abeer el-Turk. « Ma fille était l’un d’entre eux. Elle n’aimait pas les livres rédigés en arabe. Elle lisait des histoires en anglais, parce qu’il n’existait pas d’histoires intéressantes en arabe. » Cette observation – et la réalisation que sa fille souffrait de cette lacune – ont poussé Abeer à écrire des histoires amusantes, divertissantes et en arabe, pour que les enfants ne soient pas obligés de chercher des livres rédigés en anglais pour lire des histoires qu’ils aiment.
« Pendant une longue période, les livres que les enfants recevaient et les personnages dépeints dans ces livres appartenaient à un univers étranger. Les maisons avaient l’air différent des nôtres, les policiers portaient des uniformes différents et même les traits des personnages semblaient étrangers. Même si ces livres étaient bons, [les lecteurs] ne pouvaient pas s’identifier entièrement », a expliqué Najjar au sujet des livres qui étaient disponibles dans les années 1970 et 1980.
« Étant donnés le Mandat britannique, l’occupation, etc., il y avait cette espèce de relation qui peut exister entre le gouverneur et le gouverné, dans le contexte de la colonisation. Le fait que les livres que nous lisions, que nous étudions, étaient produits par ceux qui nous gouvernaient et qui occupaient notre pays accentuait en quelque sorte cette relation.
« En ce qui me concerne, quand j’ai commencé à écrire, je pensais à tous ces enfants qui ne lisent pas, qui n’aiment pas les livres rédigés en arabe », a expliqué Abeer el-Turk. « Ma fille était l’un d’entre eux. Elle n’aimait pas les livres rédigés en arabe. Elle lisait des histoires en anglais, parce qu’il n’existait pas d’histoires intéressantes en arabe. » Cette observation – et la réalisation que sa fille souffrait de cette lacune – ont poussé Abeer à écrire des histoires amusantes, divertissantes et en arabe, pour que les enfants ne soient pas obligés de chercher des livres rédigés en anglais pour lire des histoires qu’ils aiment.

Taghreed Najjar est une auteure récompensée par plusieurs prix dans le domaine de la littérature pour enfants en arabe.
Pourtant, pour ceux qui forgent le nouveau paysage de la littérature enfantine en arabe, la création d’œuvres remarquables rédigées dans cette langue s’accompagne de grands défis à relever. Dans une région aussi déchirée par les conflits, la distribution est un défi de taille ; avec la guerre, il est quasiment impossible d’envoyer des livres en Syrie et dans d’autres pays. Par ailleurs, Rania el-Turk est consciente de la censure dont ses livres font l’objet lorsqu’elle les finalise (par exemple, des standards de pudeur sont à prendre en compte pour la commercialisation de ses livres sur le marché du Golfe).
Les livres d’images de qualité sont également onéreux par nature et les bibliothèques publiques proposant le prêt de livres ne sont pas particulièrement bien implantées en Jordanie : même s’ils sont disponibles en Suède, au Japon et aux États-Unis, explique Najjar, ses livres sont pratiquement impossibles à trouver dans des villes de Jordanie un peu plus éloignées comme Ma’an ou Aqaba.
Écrivains et lecteurs s’accordent pour dire que, si la renaissance de l’édition se poursuit, il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Mais après ces dizaines d’années pendant lesquelles le marché jordanien a été alimenté en livres rédigés en anglais et en traductions, les échanges commencent à se réorienter dans le sens inverse : le livre de Najjar intitulé Pourquoi pas ? a été traduit en anglais par Lucy Coats le mois dernier sous le titre The Little Green Drum (« Le petit tambour vert »). Évoluant dans le village de Lifta, dans la Palestine des années 1930, ce livre raconte l’histoire d’une jeune fille qui prend le relai pour assumer le rôle de son père, chargé de réveiller le village pour le suhur du Ramadan (le repas pris juste avant lever du soleil).
« J’ai réalisé que si je voulais devenir écrivain, je devais être un écrivain authentique », explique Najjar. Cela ne suffirait pas d’insérer des références culturelles purement symboliques ou de décrire des contextes familiers, a-t-elle réalisé. Sa mission serait de créer sa propre voix originale. « Mon travail ne serait pas une copie. Parce que si je ne faisais qu’une copie de la littérature étrangère, mes livres n’auraient aucune valeur. »
Traduction de l’anglais (original) par STiil
Cet article a été initialement publié sur le site de notre partenaire Middle East Eye édition française .
Les livres d’images de qualité sont également onéreux par nature et les bibliothèques publiques proposant le prêt de livres ne sont pas particulièrement bien implantées en Jordanie : même s’ils sont disponibles en Suède, au Japon et aux États-Unis, explique Najjar, ses livres sont pratiquement impossibles à trouver dans des villes de Jordanie un peu plus éloignées comme Ma’an ou Aqaba.
Écrivains et lecteurs s’accordent pour dire que, si la renaissance de l’édition se poursuit, il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Mais après ces dizaines d’années pendant lesquelles le marché jordanien a été alimenté en livres rédigés en anglais et en traductions, les échanges commencent à se réorienter dans le sens inverse : le livre de Najjar intitulé Pourquoi pas ? a été traduit en anglais par Lucy Coats le mois dernier sous le titre The Little Green Drum (« Le petit tambour vert »). Évoluant dans le village de Lifta, dans la Palestine des années 1930, ce livre raconte l’histoire d’une jeune fille qui prend le relai pour assumer le rôle de son père, chargé de réveiller le village pour le suhur du Ramadan (le repas pris juste avant lever du soleil).
« J’ai réalisé que si je voulais devenir écrivain, je devais être un écrivain authentique », explique Najjar. Cela ne suffirait pas d’insérer des références culturelles purement symboliques ou de décrire des contextes familiers, a-t-elle réalisé. Sa mission serait de créer sa propre voix originale. « Mon travail ne serait pas une copie. Parce que si je ne faisais qu’une copie de la littérature étrangère, mes livres n’auraient aucune valeur. »
Traduction de l’anglais (original) par STiil
Cet article a été initialement publié sur le site de notre partenaire Middle East Eye édition française .