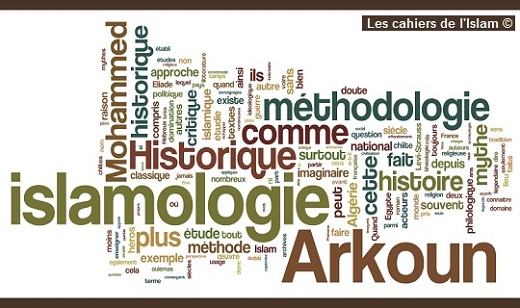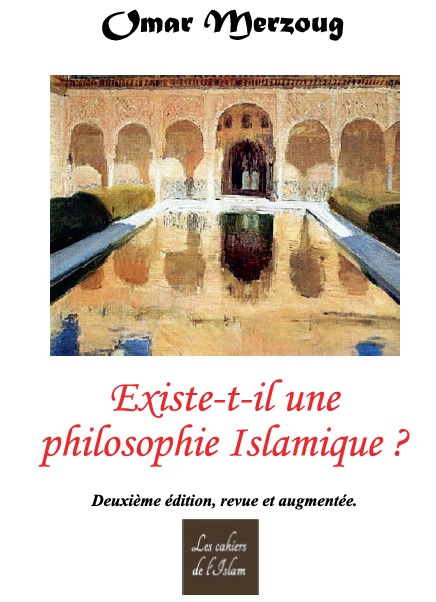En guise de préambule, je me dois de remercier M. Belhouchet, directeur du quotidien El Watan, et M. Hachemaoui, concepteur de ces rencontres, qui m’ont fait l’honneur de m’inviter à parler, ce jour à Alger, de Mohammed Arkoun, de son œuvre et de sa contribution à l’islamologie. Je dois ajouter que c’est une excellente initiative qu’ils ont prise : outre la discussion académique, il y a la dimension rituelle de cette rencontre qu’on ne peut négliger.
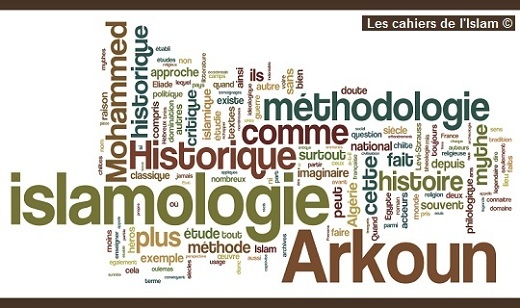
Les cahiers de l'Islam ©
Une société existe par des rites. Sans doute y a-t-il des rites propres ou typiques de l’État moderne en tant qu’État national, comme la fabrication de héros nationaux. Dans l’Algérie indépendante, seuls ont pris cette figure éminente ceux qui ont participé au combat contre la France coloniale. Cette période, très proche et très courte («huit ans sur deux mille ans», pour reprendre une formule de Kateb Yacine), écrase de son poids l’histoire de l’Algérie et la déforme : on a souvent le sentiment que seule importe l’écriture de l’histoire de la guerre d’indépendance, ou bien que seuls comptent les combattants. Une grande partie de la recherche historique est dévolue à cette période, ainsi qu’à celle du mouvement national qui l’a préparée. A partir de cette vision, on a été conduits à exalter de manière exagérée tout un épisode guerrier — y compris ses acteurs — de l’histoire de l’Algérie.
Même un critique comme Kateb Yacine a écrit une pièce de théâtre qu’il a intitulée La guerre de deux mille ans, où il envisage l’histoire de l’Algérie comme une guerre permanente. Les opposants, des plus modérés aux plus extrémistes, font de même. Le héros national prend ainsi, dans la majeure partie des cas, la figure de l’homme d’armes, du moudjahid ou du martyr de la cause nationale, comme en témoigne la toponymie des rues et des places publiques, de même que la statuaire. Cette toponymie nous dévoile non ce qu’est l’Algérie, mais la conscience qu’en ont ses dirigeants, sans discontinuer, depuis l’indépendance. Derrière chaque nom propre mis en avant, combien de noms sont mis de côté, oubliés, voire tus délibérément ? Le temps est venu sans doute de «démilitariser» le panthéon national.
La politique n’est pas réductible à la guerre, il est même dangereux de l’y réduire. C’est pour cela qu’il est devenu urgent d’ouvrir le panthéon national à d’autres héros, par exemple les gens de la culture, y compris quand ils ont été des opposants ou des critiques comme Mohammed Arkoun. Les héros d’une nation ne sont pas faits tout d’une pièce ; ils sont complexes comme l’est toute personnalité humaine, comme l’est également le contexte dans lequel ils ont évolué. Il n’y a que dans les contes de fées que les héros sont transparents. Est-il besoin de préciser que l’histoire d’un pays n’est pas un conte de fées ?
Même un critique comme Kateb Yacine a écrit une pièce de théâtre qu’il a intitulée La guerre de deux mille ans, où il envisage l’histoire de l’Algérie comme une guerre permanente. Les opposants, des plus modérés aux plus extrémistes, font de même. Le héros national prend ainsi, dans la majeure partie des cas, la figure de l’homme d’armes, du moudjahid ou du martyr de la cause nationale, comme en témoigne la toponymie des rues et des places publiques, de même que la statuaire. Cette toponymie nous dévoile non ce qu’est l’Algérie, mais la conscience qu’en ont ses dirigeants, sans discontinuer, depuis l’indépendance. Derrière chaque nom propre mis en avant, combien de noms sont mis de côté, oubliés, voire tus délibérément ? Le temps est venu sans doute de «démilitariser» le panthéon national.
La politique n’est pas réductible à la guerre, il est même dangereux de l’y réduire. C’est pour cela qu’il est devenu urgent d’ouvrir le panthéon national à d’autres héros, par exemple les gens de la culture, y compris quand ils ont été des opposants ou des critiques comme Mohammed Arkoun. Les héros d’une nation ne sont pas faits tout d’une pièce ; ils sont complexes comme l’est toute personnalité humaine, comme l’est également le contexte dans lequel ils ont évolué. Il n’y a que dans les contes de fées que les héros sont transparents. Est-il besoin de préciser que l’histoire d’un pays n’est pas un conte de fées ?
L’islamologie classique
L’islamologie classique, ainsi que l’appelait Mohammed Arkoun, et qui est souvent décriée en Algérie et dans les pays musulmans, injustement du reste, étudie principalement les textes de la tradition islamique savante comme le Coran et le commentaire coranique, le hadith, la sîra, le droit islamique, (fiqh), les chroniques historiques, le soufisme, la théologie (kalâm) et la philosophie. Pour ce faire, elle recourt principalement à la méthode historique et à la critique philologique, qui ont fait leurs preuves dans l’étude non seulement de l’Ancien et du Nouveau Testament, mais également dans l’étude des cultures classiques en général (Platon, Aristote, Homère, etc.).
L’étude des textes anciens, avant la diffusion de l’imprimerie et des droits d’auteur, pose des problèmes considérables, que le profane est loin d’imaginer. Dans la mesure où la reproduction du livre imposait de recourir aux services d’un copiste, celui-ci avait la possibilité d’ajouter des phrases, voire des passages entiers. C’est ce que l’on appelle une interpolation. Le philologue doit s’efforcer de dater le texte qu’il étudie, ensuite de repérer ces interpolations, s’il y a lieu. Le problème des textes philosophiques ou littéraires et celui des textes religieux ne sont pas les mêmes. Grâce à cette approche, on a pu arriver, par exemple, à la conclusion que derrière l’apparente unité du texte biblique on pouvait reconstituer au moins deux ensembles textuels différents, l’un dans lequel Dieu est appelé Iahvé, un autre dans lequel il est appelé Elohim (à rapprocher du nom arabe Allah).
La lecture philologique reconstitue souvent les liens de filiation entre les textes, y compris de langues différentes. Elle peut recourir aussi à la comparaison entre langues appartenant à la même aire linguistique, afin d’éclairer la signification d’un
mot : un chercheur a ainsi essayé de comprendre un mot obscur qui n’apparaît que deux fois dans la quatrième sourate du Coran (kalâla), en essayant de retrouver des termes analogues dans les autres langues sémitiques (akkadien. hébreu, syriaque, araméen). La philologie est un peu aux textes ce que la géologie est aux terrains : face à ce qui se présente sous la forme d’un bloc, une unité cohérente, elle oppose le processus historique, fait d’aléas et parfois de manipulations, qui, pareil à un cours d’eau, draine les différents éléments qui vont constituer au final le texte unique qui va être le point de départ d’une tradition. C’est ce qui ressort très bien des études menées sur la Bible.
L’étude des textes anciens, avant la diffusion de l’imprimerie et des droits d’auteur, pose des problèmes considérables, que le profane est loin d’imaginer. Dans la mesure où la reproduction du livre imposait de recourir aux services d’un copiste, celui-ci avait la possibilité d’ajouter des phrases, voire des passages entiers. C’est ce que l’on appelle une interpolation. Le philologue doit s’efforcer de dater le texte qu’il étudie, ensuite de repérer ces interpolations, s’il y a lieu. Le problème des textes philosophiques ou littéraires et celui des textes religieux ne sont pas les mêmes. Grâce à cette approche, on a pu arriver, par exemple, à la conclusion que derrière l’apparente unité du texte biblique on pouvait reconstituer au moins deux ensembles textuels différents, l’un dans lequel Dieu est appelé Iahvé, un autre dans lequel il est appelé Elohim (à rapprocher du nom arabe Allah).
La lecture philologique reconstitue souvent les liens de filiation entre les textes, y compris de langues différentes. Elle peut recourir aussi à la comparaison entre langues appartenant à la même aire linguistique, afin d’éclairer la signification d’un
mot : un chercheur a ainsi essayé de comprendre un mot obscur qui n’apparaît que deux fois dans la quatrième sourate du Coran (kalâla), en essayant de retrouver des termes analogues dans les autres langues sémitiques (akkadien. hébreu, syriaque, araméen). La philologie est un peu aux textes ce que la géologie est aux terrains : face à ce qui se présente sous la forme d’un bloc, une unité cohérente, elle oppose le processus historique, fait d’aléas et parfois de manipulations, qui, pareil à un cours d’eau, draine les différents éléments qui vont constituer au final le texte unique qui va être le point de départ d’une tradition. C’est ce qui ressort très bien des études menées sur la Bible.
La méthode historique
Quant à la méthode historique, qui est indissociable de l’approche philologique, elle est fondée sur un scepticisme méthodique qui vérifie l’authenticité de chaque fait, que ce soit pour l’histoire politique ou pour l’histoire religieuse. De ce point de vue, la méthode historique a conduit à l’effondrement des «romans nationaux» construits surtout au XIXe siècle qui voulaient voir dans la France ou l’Allemagne des entités suprahistoriques, ayant existé depuis toujours. Cependant, la méthode historique ne vise ni à démontrer la supériorité d’un «roman national» sur un autre ni à proposer de nouveaux mythes pour remplacer ceux qui sont devenus obsolètes. Son but est seulement d’établir la vérité historique : un fait a-t-il eu lieu ? Où ? Quand ? Qui y a pris part ?
Ainsi, le personnage de Jeanne d’Arc, passé au crible de la méthode historique, est dépouillé de sa dimension légendaire. Mais aussi le personnage de Napoléon ou de Lénine. L’histoire, quand elle est écrite par les acteurs, est toujours suspecte, même dans les domaines les plus anodins. Les acteurs ont une fâcheuse tendance à l’oubli, voire à enjoliver certains détails, surtout quand ils les concernent. L’historien ne peut s’en sortir qu’en confrontant les témoignages des acteurs de tous les camps, et surtout en croisant le discours des acteurs avec les informations que procurent d’autres sources (surtout les archives). Prenons l’exemple des camps de travail en URSS. Quand on lisait, il y a quelques décennies, les historiens soviétiques, ces camps n’existaient pas. Il a fallu attendre les premiers témoignages de personnes qui s’en sont échappés ou en ont été libérés (à partir de 1957), pour que le fait prenne de la consistance. Pourtant, certains ont continué à nier leur existence, soutenant qu’il s’agissait de propagande états-unienne.
Puis, enfin, il y a eu l’effondrement de l’URSS et l’ouverture des archives officielles. Pour les périodes les plus anciennes, comme l’Antiquité, il n’existe généralement pas d’archives, sauf pour ce qui concerne la collecte des impôts dans certaines régions. Dans ce cas, on recourt aux sources littéraires, et, depuis plus d’un siècle, à l’archéologie, sans oublier les sciences dites «auxiliaires» comme l’épigraphie (science des écritures) ou la numismatique (science des monnaies). Par exemple, la Bible affirme que les Hébreux ont été emmenés en captivité en Égypte et qu’ils ont quitté ce pays en traversant la mer Rouge et le désert du Sinaï, avant d’arriver en Palestine.
Les archéologues ont pris au mot ce récit et ont voulu le vérifier. On ne trouve aucune trace d’une présence d’Hébreux dans l’Égypte antique, de surcroît réduits à l’esclavage, à l’époque où ils étaient censés l’avoir été, ni du reste de leur passage dans le Sinaï. Tous les savants sérieux tiennent maintenant pour établi, grâce à l’archéologie, que jamais les Hébreux n’ont été emmenés en captivité en Égypte et qu’il n’y a donc jamais eu de sortie d’Égypte comme l’affirme la Bible. Il s’agit d’un récit légendaire. Ainsi, la méthode historique permet, grâce à un examen rigoureux de la littérature léguée par les gens du passé, d’établir les faits indubitables, et surtout d’écarter ceux qui sont trop ouvertement faux ou trop incertains. Elle permet aussi de corriger les exagérations des auteurs anciens.
Ainsi, le personnage de Jeanne d’Arc, passé au crible de la méthode historique, est dépouillé de sa dimension légendaire. Mais aussi le personnage de Napoléon ou de Lénine. L’histoire, quand elle est écrite par les acteurs, est toujours suspecte, même dans les domaines les plus anodins. Les acteurs ont une fâcheuse tendance à l’oubli, voire à enjoliver certains détails, surtout quand ils les concernent. L’historien ne peut s’en sortir qu’en confrontant les témoignages des acteurs de tous les camps, et surtout en croisant le discours des acteurs avec les informations que procurent d’autres sources (surtout les archives). Prenons l’exemple des camps de travail en URSS. Quand on lisait, il y a quelques décennies, les historiens soviétiques, ces camps n’existaient pas. Il a fallu attendre les premiers témoignages de personnes qui s’en sont échappés ou en ont été libérés (à partir de 1957), pour que le fait prenne de la consistance. Pourtant, certains ont continué à nier leur existence, soutenant qu’il s’agissait de propagande états-unienne.
Puis, enfin, il y a eu l’effondrement de l’URSS et l’ouverture des archives officielles. Pour les périodes les plus anciennes, comme l’Antiquité, il n’existe généralement pas d’archives, sauf pour ce qui concerne la collecte des impôts dans certaines régions. Dans ce cas, on recourt aux sources littéraires, et, depuis plus d’un siècle, à l’archéologie, sans oublier les sciences dites «auxiliaires» comme l’épigraphie (science des écritures) ou la numismatique (science des monnaies). Par exemple, la Bible affirme que les Hébreux ont été emmenés en captivité en Égypte et qu’ils ont quitté ce pays en traversant la mer Rouge et le désert du Sinaï, avant d’arriver en Palestine.
Les archéologues ont pris au mot ce récit et ont voulu le vérifier. On ne trouve aucune trace d’une présence d’Hébreux dans l’Égypte antique, de surcroît réduits à l’esclavage, à l’époque où ils étaient censés l’avoir été, ni du reste de leur passage dans le Sinaï. Tous les savants sérieux tiennent maintenant pour établi, grâce à l’archéologie, que jamais les Hébreux n’ont été emmenés en captivité en Égypte et qu’il n’y a donc jamais eu de sortie d’Égypte comme l’affirme la Bible. Il s’agit d’un récit légendaire. Ainsi, la méthode historique permet, grâce à un examen rigoureux de la littérature léguée par les gens du passé, d’établir les faits indubitables, et surtout d’écarter ceux qui sont trop ouvertement faux ou trop incertains. Elle permet aussi de corriger les exagérations des auteurs anciens.
Par-delà le procès idéologique de l’islamologie
Mohammed Arkoun, qui connaissait bien les sociétés musulmanes, savait que la méthode historique et l’approche philologique n’y étaient pas pratiquées, que ce soit dans le domaine de l’histoire nationale ou dans le domaine de l’histoire religieuse. Dans les écoles, et même dans les universités, en guise d’histoire de la civilisation islamique, on enseignait la version élaborée par les oulémas il y a plusieurs siècles. Par exemple, remarquons ce qui se dit du conflit sunnisme-chiisme. Pour les sunnites, le chiisme est une hérésie, invention d’extrémistes. Ce n’est qu’au XXe siècle, qu’en raison de l’œcuménisme dominant de part et d’autre, les oulémas sunnites d’Al Azhar ont accepté d’enseigner le droit des chiites duodécimains sous l’appellation fiqhja’farî, en référence au Vle imam chiite. Mais il n’a jamais été question pour eux d’enseigner la théologie duodécimaine, ni de faire connaître la tradition des imams. Du côté chiite, les choses sont à peine différentes.
Certes, les chiites ont fait preuve de moins de réticence à connaître la production intellectuelle sunnite qui leur a servi souvent de modèle. C’est ainsi que l’œuvre de Muhy al-dîn b. ‘Arabî, le maître de notre Emir Abdelkader, le plus grand soufi sunnite, est connue et même étudiée avec attention dans le monde chiite. Khumayni avait consacré un mémoire académique aux Fusûs al-hikam, son œuvre la plus difficile. Pour autant, les chiites continuent à enseigner leur propre version de l’histoire de l’Islam : selon eux, ‘Ali a été trahi par les Compagnons les plus puissants comme ‘Umar et Abû Bakr. C’est pour cela que Mohammed Arkoun, à juste titre, considérait que seul le recours à la méthode historique et l’approche philologique pouvait conduire à une issue afin d’échapper à ce duel spéculaire. Il a écrit à ce sujet : «Les uns et les autres substituent, depuis des siècles, une conviction religieuse héritée de la tradition, à l’utilisation rigoureuse de la critique historique» (L’Islam, morale et politique, Paris, 1986, p.142).
On comprend par conséquent la réserve légitime de Mohammed Arkoun à l’endroit de la critique «idéologique» de l’islamologie, y compris par Edward Saïd. Dans cette perspective, on reproche souvent à l’islamologie d’être au service de la domination occidentale sur le monde islamique. Ce type de critique est totalement irrecevable, car elle relève du procès d’intention. On peut y répondre simplement : en quoi l’étude des débats théologiques au IXe siècle de l’ère commune peut-elle servir une telle domination ? Il serait plus juste de dire que l’hostilité suscitée par l’islamologie vient de ce que celle-ci déconstruit le «roman fabuleux» que les oulémas ont édifié au cours des siècles passés. Quand l’islamologie réhabilite al-Hallâj, qui a été mis à mort au Xe siècle pour hérésie, elle oblige les musulmans à se reposer la question de cette condamnation, surtout à une époque dominée par l’islâh, par principe hostile au soufisme.
Quand elle étudie la théologie chiite, le hanbalisme ou l’ash’arisme, elle apporte de nombreux éléments pour contester ce «roman fabuleux» que les prédicateurs continuent partout de répéter. C’est pour cette raison que l’islamologie a rencontré pendant longtemps l’hostilité.
Toutefois, il faut indiquer que les tenants de la critique «idéologique» de l’islamologie qui la mettent en relation avec la domination occidentale ne sont pas entièrement dans l’erreur : en effet, si elle n’est pas un moyen de domination, elle en constitue par contre une expression indéniable. Prenons un exemple frappant. Il existe de nombreux départements universitaires en Israël dédiés aux études arabes et islamiques, dans lesquels de nombreux chercheurs s’activent (il y a parmi eux des savants palestiniens), y compris pour étudier la poésie classique ou l’histoire de la grammaire arabe. Il y a même une revue — Jerusalem Studies in Arabie and Islam — spécialement consacrée à ces domaines qui a une réputation bien établie.
En comparaison, y a-t-il dans les universités arabes, bien plus nombreuses, des départements consacrés aux études hébraïques et juives ? A Al Azhar, et, je crois aussi au Maroc, on enseigne l’hébreu. Mais nulle part, il n’existe une «majallat al-dirâsât al-yahûdiyya ou al-’ibriyya». Pourtant, dans une perspective de confrontation politico-militaire, la raison commande de connaître son ennemi. On peut dire la même chose des études sur la France en Algérie et au Maghreb.
On étudie le français comme outil linguistique et déjà moins la littérature française, à laquelle on a souvent substitué «la littérature maghrébine d’expression française». Mais on n’étudie guère la civilisation française. Combien d’étudiants en français peuvent expliquer ce qu’est le «jansénisme» ou le « gallicanisme» ? Il est vrai que les choses ne sont pas meilleures concernant les autres langues et cultures. En ce sens, mais seulement en ce sens, on peut dire que celui qui vous prend pour objet d’étude, et par conséquent vous connaît mieux que vous ne le connaissez, est, sans aucun doute, supérieur du point de vue du rapport de forces.
Certes, les chiites ont fait preuve de moins de réticence à connaître la production intellectuelle sunnite qui leur a servi souvent de modèle. C’est ainsi que l’œuvre de Muhy al-dîn b. ‘Arabî, le maître de notre Emir Abdelkader, le plus grand soufi sunnite, est connue et même étudiée avec attention dans le monde chiite. Khumayni avait consacré un mémoire académique aux Fusûs al-hikam, son œuvre la plus difficile. Pour autant, les chiites continuent à enseigner leur propre version de l’histoire de l’Islam : selon eux, ‘Ali a été trahi par les Compagnons les plus puissants comme ‘Umar et Abû Bakr. C’est pour cela que Mohammed Arkoun, à juste titre, considérait que seul le recours à la méthode historique et l’approche philologique pouvait conduire à une issue afin d’échapper à ce duel spéculaire. Il a écrit à ce sujet : «Les uns et les autres substituent, depuis des siècles, une conviction religieuse héritée de la tradition, à l’utilisation rigoureuse de la critique historique» (L’Islam, morale et politique, Paris, 1986, p.142).
On comprend par conséquent la réserve légitime de Mohammed Arkoun à l’endroit de la critique «idéologique» de l’islamologie, y compris par Edward Saïd. Dans cette perspective, on reproche souvent à l’islamologie d’être au service de la domination occidentale sur le monde islamique. Ce type de critique est totalement irrecevable, car elle relève du procès d’intention. On peut y répondre simplement : en quoi l’étude des débats théologiques au IXe siècle de l’ère commune peut-elle servir une telle domination ? Il serait plus juste de dire que l’hostilité suscitée par l’islamologie vient de ce que celle-ci déconstruit le «roman fabuleux» que les oulémas ont édifié au cours des siècles passés. Quand l’islamologie réhabilite al-Hallâj, qui a été mis à mort au Xe siècle pour hérésie, elle oblige les musulmans à se reposer la question de cette condamnation, surtout à une époque dominée par l’islâh, par principe hostile au soufisme.
Quand elle étudie la théologie chiite, le hanbalisme ou l’ash’arisme, elle apporte de nombreux éléments pour contester ce «roman fabuleux» que les prédicateurs continuent partout de répéter. C’est pour cette raison que l’islamologie a rencontré pendant longtemps l’hostilité.
Toutefois, il faut indiquer que les tenants de la critique «idéologique» de l’islamologie qui la mettent en relation avec la domination occidentale ne sont pas entièrement dans l’erreur : en effet, si elle n’est pas un moyen de domination, elle en constitue par contre une expression indéniable. Prenons un exemple frappant. Il existe de nombreux départements universitaires en Israël dédiés aux études arabes et islamiques, dans lesquels de nombreux chercheurs s’activent (il y a parmi eux des savants palestiniens), y compris pour étudier la poésie classique ou l’histoire de la grammaire arabe. Il y a même une revue — Jerusalem Studies in Arabie and Islam — spécialement consacrée à ces domaines qui a une réputation bien établie.
En comparaison, y a-t-il dans les universités arabes, bien plus nombreuses, des départements consacrés aux études hébraïques et juives ? A Al Azhar, et, je crois aussi au Maroc, on enseigne l’hébreu. Mais nulle part, il n’existe une «majallat al-dirâsât al-yahûdiyya ou al-’ibriyya». Pourtant, dans une perspective de confrontation politico-militaire, la raison commande de connaître son ennemi. On peut dire la même chose des études sur la France en Algérie et au Maghreb.
On étudie le français comme outil linguistique et déjà moins la littérature française, à laquelle on a souvent substitué «la littérature maghrébine d’expression française». Mais on n’étudie guère la civilisation française. Combien d’étudiants en français peuvent expliquer ce qu’est le «jansénisme» ou le « gallicanisme» ? Il est vrai que les choses ne sont pas meilleures concernant les autres langues et cultures. En ce sens, mais seulement en ce sens, on peut dire que celui qui vous prend pour objet d’étude, et par conséquent vous connaît mieux que vous ne le connaissez, est, sans aucun doute, supérieur du point de vue du rapport de forces.
« l’islamologie appliquée » et ses limites
Dans ses nombreuses conférences dans le monde musulman, devant un jeune public souvent enthousiaste, Mohammed Arkoun a toujours défendu l’usage de la critique historique et philologique dans l’étude de l’Islam savant. Certains sans doute se sont engagés sur cette voie sous son influence. Mais Mohammed Arkoun estimait que l’islamologie classique, même si elle conserve une utilité indéniable, notamment pour l’édition scientifique des textes, souffrait d’un handicap majeur, qu’il appelle «historicisme». En effet, une fois que l’on a établi les faits et écarté du revers de la main tout ce qui relevait de la légende et du mythe, comme le fait tout historien positiviste qui ne veut s’en tenir qu’au fait, on oublie que la légende et le mythe sont également des faits qui demandent à être compris et expliqués. Car, soulignait-il avec raison, c’est le fait légendaire qui est reçu comme la vérité par le fidèle qui a de l’impact aujourd’hui, non le fait nu établi par l’islamologue. C’est afin d’échapper à ce travers que Mohammed Arkoun a formulé le projet d’étudier le Coran et le langage coranique.
C’est ainsi qu’il écrivit : «Les Récits coraniques, le Hadith, la Sira sont toujours décrits par l’islamologie classique comme des fondations discursives rationnelles, alors qu’elles doivent beaucoup à l’activité de l’imaginaire travaillant les mythes d’origine, de fondation» (Pour une critique de la raison islamique, Paris, 1984, p. 11). On voit dès cette formulation apparaître deux termes
importants : «imaginaire» et «mythe». Cela demande un petit commentaire. Le terme «mythe», qui vient de la Grèce antique, a été totalement retravaillé par plusieurs auteurs modernes, en particulier Georges Dumézil, Claude Lévi-Strauss, J.P. Vernant, M.
Détienne, qui ont tous appartenu à la Ve section de l’EPHE, un lieu entièrement dévolu à l’étude des systèmes religieux du monde. Or, 1’usage que commence par faire Mohammed Arkoun du mot «mythe» est assez éloigné de ces auteurs.
C’est ainsi qu’il écrivit : «Les Récits coraniques, le Hadith, la Sira sont toujours décrits par l’islamologie classique comme des fondations discursives rationnelles, alors qu’elles doivent beaucoup à l’activité de l’imaginaire travaillant les mythes d’origine, de fondation» (Pour une critique de la raison islamique, Paris, 1984, p. 11). On voit dès cette formulation apparaître deux termes
importants : «imaginaire» et «mythe». Cela demande un petit commentaire. Le terme «mythe», qui vient de la Grèce antique, a été totalement retravaillé par plusieurs auteurs modernes, en particulier Georges Dumézil, Claude Lévi-Strauss, J.P. Vernant, M.
Détienne, qui ont tous appartenu à la Ve section de l’EPHE, un lieu entièrement dévolu à l’étude des systèmes religieux du monde. Or, 1’usage que commence par faire Mohammed Arkoun du mot «mythe» est assez éloigné de ces auteurs.
Dans un article qui date de 1968, il déclare : «Il suffit de mentionner le nom de Cl. Lévi-Strauss pour évoquer les vastes horizons ouverts à la réflexion sur l’homme par l’anthropologie structurale. Nous nous garderons bien, toutefois, d’aller nous égarer dans un domaine où il est très malaisé de cheminer avec assurance. Pour définir la conscience mythique et l’usage que nous voulons en faire, nous nous adresserons plutôt à un autre guide compétent, mais plus accessible : Mircea Eliade» (Essais sur la pensée islamique, 1973, p. 245).
Dans ce passage, Mohamed Arkoun semble considérer que Lévi-Strauss et Eliade ont la même conception du mythe ; or il n’en est rien. Pour Lévi-Strauss, on ne peut rendre compte d’un mythe que si l’on tient compte de la totalité culturelle dont il n’est qu’un fragment.
Il a montré cela de manière magistrale, dès 1958, dans La geste d’Asdiwal», l’analyse d’un mythe amérindien. Une autre démonstration brillante de cette approche a été faite par Détienne à propos du mythe d’Adonis. Pour Eliade, en cela proche du psychanalyste suisse C. G. Jung (ils se fréquentaient dans les rencontres de la revue Eranos), les mythes avaient une signification univoque, hors de tout contexte.
L’approche de M. Eliade a eu de nombreux adeptes, parmi lesquels Gilbert Durand. C’est à ce dernier que Mohammed Arkoun emprunte le terme «imaginaire» et non au psychanalyste Jacques Lacan (qui distinguait trois registres : Réel, Symbolique. Imaginaire). A partir des années 1980, sans doute après la révolution iranienne, Mohammed Arkoun va de plus en plus recourir au terme «imaginaire», entendu au sens de lieu de toutes les illusions et les tromperies. Pour lui, qui faisait profession de foi antipositiviste, l’imaginaire, surtout quand il est «social», est aliénant. Posant la question du «mythique», Mohammed Arkoun aboutit à une conception positiviste : derrière le mythe, siège la déraison. Quant à «l’imaginaire social», catégorie récurrente dans les écrits de Mohammed Arkoun depuis les années 1980, il pointe l’irruption de «la foule» sur la scène politique.
On peut donc conclure en soulignant que la tentative de Mohammed Arkoun de fonder «une islamologie appliquée», qu’il appelait de ses vœux, donc une islamologie débarrassée des présupposés métaphysiques qu’elle colportait depuis ses origines, a échoué parce que lui-même a refusé de faire le saut en posant la question du concept de «religion». Il n’existe pas dans son œuvre une définition de ce qu’il faut entendre par «religion», et encore moins sur ce qui spécifie l’Islam comme religion parmi d’autres.
Dans ce passage, Mohamed Arkoun semble considérer que Lévi-Strauss et Eliade ont la même conception du mythe ; or il n’en est rien. Pour Lévi-Strauss, on ne peut rendre compte d’un mythe que si l’on tient compte de la totalité culturelle dont il n’est qu’un fragment.
Il a montré cela de manière magistrale, dès 1958, dans La geste d’Asdiwal», l’analyse d’un mythe amérindien. Une autre démonstration brillante de cette approche a été faite par Détienne à propos du mythe d’Adonis. Pour Eliade, en cela proche du psychanalyste suisse C. G. Jung (ils se fréquentaient dans les rencontres de la revue Eranos), les mythes avaient une signification univoque, hors de tout contexte.
L’approche de M. Eliade a eu de nombreux adeptes, parmi lesquels Gilbert Durand. C’est à ce dernier que Mohammed Arkoun emprunte le terme «imaginaire» et non au psychanalyste Jacques Lacan (qui distinguait trois registres : Réel, Symbolique. Imaginaire). A partir des années 1980, sans doute après la révolution iranienne, Mohammed Arkoun va de plus en plus recourir au terme «imaginaire», entendu au sens de lieu de toutes les illusions et les tromperies. Pour lui, qui faisait profession de foi antipositiviste, l’imaginaire, surtout quand il est «social», est aliénant. Posant la question du «mythique», Mohammed Arkoun aboutit à une conception positiviste : derrière le mythe, siège la déraison. Quant à «l’imaginaire social», catégorie récurrente dans les écrits de Mohammed Arkoun depuis les années 1980, il pointe l’irruption de «la foule» sur la scène politique.
On peut donc conclure en soulignant que la tentative de Mohammed Arkoun de fonder «une islamologie appliquée», qu’il appelait de ses vœux, donc une islamologie débarrassée des présupposés métaphysiques qu’elle colportait depuis ses origines, a échoué parce que lui-même a refusé de faire le saut en posant la question du concept de «religion». Il n’existe pas dans son œuvre une définition de ce qu’il faut entendre par «religion», et encore moins sur ce qui spécifie l’Islam comme religion parmi d’autres.
Article à lire sur www.djazairess.com .