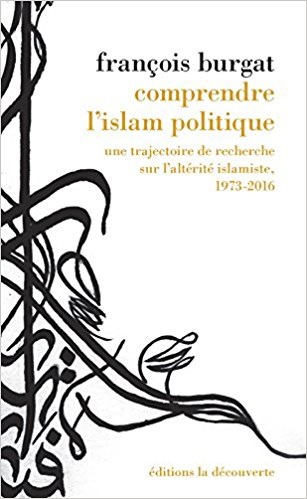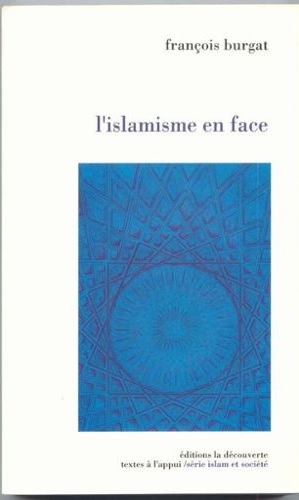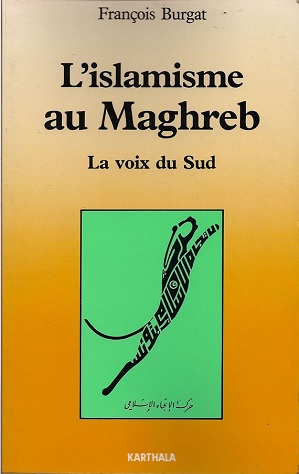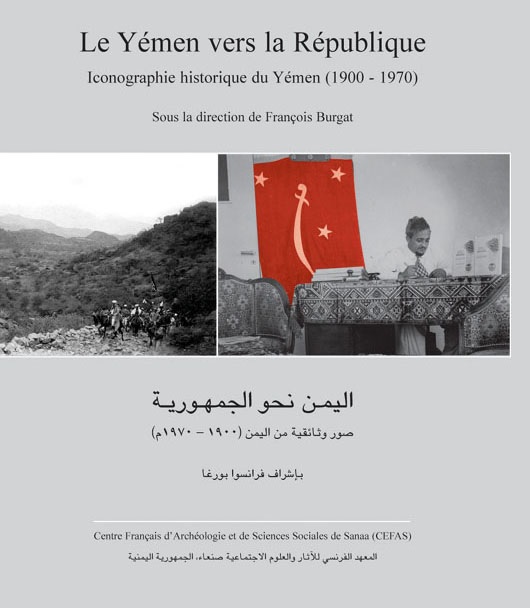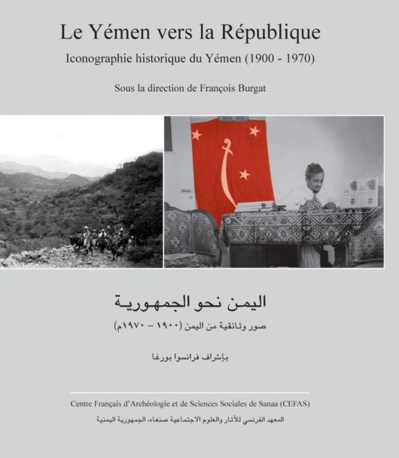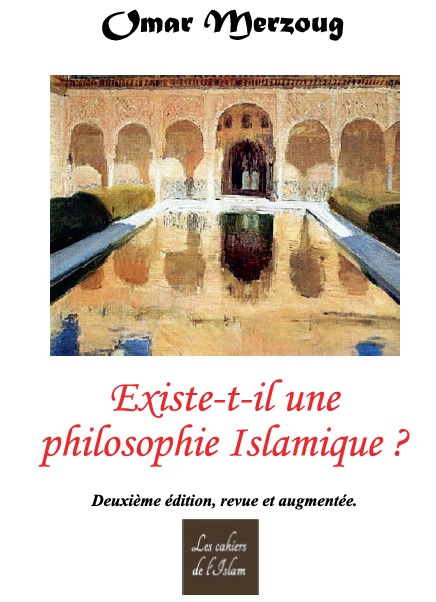C’est ainsi que nous sommes arrivés à cet entrelacs complexe de la guerre multidimensionnelle qui perdure aujourd’hui, où d’innombrables composantes de la société yéménite se sont en quelque sorte retrouvées “mercenarisées” au service des intérêts respectifs de plusieurs clans étrangers

François Burgat /Source : www.watanserb.com
François Burgat , politiste, Aix-en-Provence. Il a notamment dirigé le Centre Français d'Archéologie et de Sciences Sociales de Sanaa de 1997 à 2003 et l'Institut Français du Proche Orient de 2008 à 2013. Auteur de plusieurs ouvrages, notamment de Le Yémen vers la République. Iconographie historique du Yémen contemporain (Sanaa-Beyrouth, 2004).
Pouvez-vous nous donner quelques éléments historiques sur les origines de la guerre actuelle au Yémen ?
S'il fallait privilégier une des qualifications possibles de la guerre du Yémen, je dirais qu’il s’est d’abord agi, avant tout, d’une “simple” guerre contre-révolutionnaire. En effet, les principaux acteurs de l'un des deux camps qui structurent la confrontation, ceux que l'on nomme les Houthis, n'auraient jamais réussi à prendre, en janvier 2015, le contrôle militaire de la ville de Sanaa puis, pendant plusieurs semaines, du pays tout entier, Aden incluse, sans le soutien décisif de la contre-révolution menée par le Président Ali Abdallah Saleh. Renversé en 2011 par la poussée protestataire du “printemps” yéménite, Saleh a continué à bénéficier de la fidélité de larges pans de l'armée et de plusieurs leaders tribaux, ainsi que d’un important trésor de guerre. Les uns (les Houthis) voulurent ainsi prendre le pouvoir. Et leur allié (le Président sortant) voulut, fut-ce en le partageant, le reprendre. Ils y parvinrent en s’assurant du contrôle du gouvernement puis de la capitale Sanaa que le Président Hadi dut quitter, puis en substituant au Parlement, un Comité révolutionnaire tout entier à leur dévotion. Ensuite, assez classiquement, corollaire de la fragilisation du pouvoir central, les multiples ingérences étrangères, dont les agendas étaient bien évidemment loins d’être tous identiques, ont exacerbé toutes les contradictions, tous les égoïsmes, tous les clivages, toutes les déchirures, récentes ou anciennes, régionalistes, confessionnelles ou banalement politiques qui traversaient la société yéménite, et même chacune des composantes et chacun des clans de cette société où, en 2011, la construction étatique était encore loin d’être achevée. C’est ainsi que nous sommes arrivés à cet entrelacs complexe de la guerre multidimensionnelle qui perdure aujourd’hui, où d’innombrables composantes de la société yéménite se sont en quelque sorte retrouvées “mercenarisées” au service des intérêts respectifs de plusieurs clans étrangers.
S'il fallait privilégier une des qualifications possibles de la guerre du Yémen, je dirais qu’il s’est d’abord agi, avant tout, d’une “simple” guerre contre-révolutionnaire. En effet, les principaux acteurs de l'un des deux camps qui structurent la confrontation, ceux que l'on nomme les Houthis, n'auraient jamais réussi à prendre, en janvier 2015, le contrôle militaire de la ville de Sanaa puis, pendant plusieurs semaines, du pays tout entier, Aden incluse, sans le soutien décisif de la contre-révolution menée par le Président Ali Abdallah Saleh. Renversé en 2011 par la poussée protestataire du “printemps” yéménite, Saleh a continué à bénéficier de la fidélité de larges pans de l'armée et de plusieurs leaders tribaux, ainsi que d’un important trésor de guerre. Les uns (les Houthis) voulurent ainsi prendre le pouvoir. Et leur allié (le Président sortant) voulut, fut-ce en le partageant, le reprendre. Ils y parvinrent en s’assurant du contrôle du gouvernement puis de la capitale Sanaa que le Président Hadi dut quitter, puis en substituant au Parlement, un Comité révolutionnaire tout entier à leur dévotion. Ensuite, assez classiquement, corollaire de la fragilisation du pouvoir central, les multiples ingérences étrangères, dont les agendas étaient bien évidemment loins d’être tous identiques, ont exacerbé toutes les contradictions, tous les égoïsmes, tous les clivages, toutes les déchirures, récentes ou anciennes, régionalistes, confessionnelles ou banalement politiques qui traversaient la société yéménite, et même chacune des composantes et chacun des clans de cette société où, en 2011, la construction étatique était encore loin d’être achevée. C’est ainsi que nous sommes arrivés à cet entrelacs complexe de la guerre multidimensionnelle qui perdure aujourd’hui, où d’innombrables composantes de la société yéménite se sont en quelque sorte retrouvées “mercenarisées” au service des intérêts respectifs de plusieurs clans étrangers.
S'agit-il, comme on peut l'entendre souvent, d'une guerre entre Sunnites et Chiites?
L’une des façons de montrer que la dimension confessionnelle à laquelle le regard international tend irrésistiblement à substituer à toute autre est en réalité bien loin d’être la seule ou, à tout le moins, qu’elle n’est pas celle qui initie les conflits, est de souligner la “plasticité” exemplaire dans ce domaine de deux des principaux acteurs : l'ex-Président Ali Abdallah Saleh (jusqu’à son élimination en décembre 2107) et les Saoudiens jusqu’à ce jour. Les amis et les alliés de Hussein Badr Eddine Houthi étaient les fondateurs d’un courant réformateur de cette pensée politique zaydite qui avait, avant d’être défaite par la révolution républicaine des années soixante, fourni sa colonne vertébrale à l’imamat qui régna près de mille ans sur le pays. Lorsqu’ils ont commencé à reprocher, en 2004, à Ali Abdallah Saleh les concessions qu'il faisait aux exigences américaines de sécurité, celui-ci a cyniquement choisi de criminaliser leur appartenance (zaydite chiite, qui se trouvait pourtant être également la sienne) en leur attribuant des visées anti-républicaines (“pro-imamat”) et même anti-nationales (pro-iraniennes) qu’ils n’avaient alors aucunement. L’origine de la dissention était en réalité parfaitement profane : leur leader venait de se voir privé de la possibilité de se faire réélire au Parlement dans les rangs du Congrès Général du Peuple, le parti du Président.
Au lendemain de son renversement en 2011, le même Ali Abdallah Saleh, pour tenter de reconquérir son trône, a oublié ces manquements aux devoirs républicains et nationaux dont il accusait les Houthis, qu’il avait tenté d’écraser militairement au cours de six campagnes successives. Il s’est, assez discrètement d’abord, très ouvertement ensuite, allié avec ces mauvais citoyens, avec qui il a partagé deux années le pouvoir, avant de les trahir et de faire une offre d’alliance aux Saoudiens.
L’une des façons de montrer que la dimension confessionnelle à laquelle le regard international tend irrésistiblement à substituer à toute autre est en réalité bien loin d’être la seule ou, à tout le moins, qu’elle n’est pas celle qui initie les conflits, est de souligner la “plasticité” exemplaire dans ce domaine de deux des principaux acteurs : l'ex-Président Ali Abdallah Saleh (jusqu’à son élimination en décembre 2107) et les Saoudiens jusqu’à ce jour. Les amis et les alliés de Hussein Badr Eddine Houthi étaient les fondateurs d’un courant réformateur de cette pensée politique zaydite qui avait, avant d’être défaite par la révolution républicaine des années soixante, fourni sa colonne vertébrale à l’imamat qui régna près de mille ans sur le pays. Lorsqu’ils ont commencé à reprocher, en 2004, à Ali Abdallah Saleh les concessions qu'il faisait aux exigences américaines de sécurité, celui-ci a cyniquement choisi de criminaliser leur appartenance (zaydite chiite, qui se trouvait pourtant être également la sienne) en leur attribuant des visées anti-républicaines (“pro-imamat”) et même anti-nationales (pro-iraniennes) qu’ils n’avaient alors aucunement. L’origine de la dissention était en réalité parfaitement profane : leur leader venait de se voir privé de la possibilité de se faire réélire au Parlement dans les rangs du Congrès Général du Peuple, le parti du Président.
Au lendemain de son renversement en 2011, le même Ali Abdallah Saleh, pour tenter de reconquérir son trône, a oublié ces manquements aux devoirs républicains et nationaux dont il accusait les Houthis, qu’il avait tenté d’écraser militairement au cours de six campagnes successives. Il s’est, assez discrètement d’abord, très ouvertement ensuite, allié avec ces mauvais citoyens, avec qui il a partagé deux années le pouvoir, avant de les trahir et de faire une offre d’alliance aux Saoudiens.
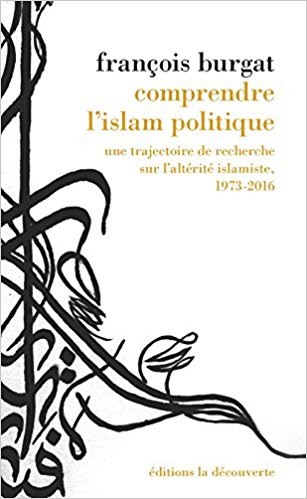
Les Saoudiens eux-mêmes n’ont pas non plus un agenda seulement sectaire, tant s’en faut. Depuis des décennies, ils ont largement montré, qu’en politique étrangère, leurs objectifs étaient bien plus pragmatiques que religieux et qu’ils cherchaient avant tout à combattre ou à acheter le soutien de tous ceux dont ils avaient peur. Lors de la guerre civile de 1994, ils ont ainsi soutenu le Yémen du Sud « communiste » puis, toujours au Yémen, longuement toléré la poussée des Houthistes - et donc des “chiites” - car elle permettait de contenir d’autres acteurs - les Frères musulmans de l’Islah et les groupes salafistes implantés à Damaj près de leur frontière - tous deux sunnites mais menaçant leur hégémonie. Quant à l’Iran, s’il a certes une propension à soutenir des mouvements tels que le Hizbollah ou certaines formations irakiennes du fait de leur appartenance chiite, les axes de sa politique régionale transcendent régulièrement cette variable sectaire : ainsi Téhéran n’hésite pas à soutenir l’action d’un parti sunnite comme le Hamas, que de leur côté combattent les autorités “sunnites” de l’université d’al-Azhar (Egypte). Comme ailleurs dans la région, les acteurs de la crise yéménite, étatiques ou infra-étatiques ont donc potentiellement des alliés et des clients très différents. Lorsque le lien national est affaibli, très classiquement les liens infra-nationaux, et l’appartenance sectaire en est un, prennent le relais. Si la différence sectaire n’est pas l’origine ou la cause de la guerre yéménite, elle lui donne aujourd’hui une partie de ses contours, puisque les belligérants ont été inéluctablement conduits à se positionner de plus en plus explicitement dans le moule de leurs appartenances respectives, claniques, régionales et politiques mais également confessionnelles [1].
Qui sont maintenant les principaux protagonistes et sur quoi s'opposent-ils ?
La liste des protagonistes du conflit est longue. Et elle est également changeante tant, en trois années, les alliances se sont modifiées. On peut distinguer aujourd’hui trois lignes de clivages, toutes les trois également internationalisées, sur des bases bien évidemment différentes : celle qui oppose les Houthis aux réminiscences (on a envie de dire aux ruines) du gouvernement de Abderrabo Mansour Hadi et aux membres de la coalition saoudienne, celle ensuite qui naît de la lutte du mouvement irrédentiste sudiste contre… le reste du Yémen et celle que forme la mobilisation des groupes radicaux contre… le reste du monde.
Le premier et le principal clivage est donc celui qui sépare les Houthis - avec puis sans leur allié Ali Abdallah Saleh - du reste du paysage politique. Les Houthis ont pour leur part choisi de mettre un terme au difficile mais néanmoins relativement prometteur processus de “dialogue national” auquel ils avaient accepté de participer, aux côtés des autres formations de l’opposition dont la mobilisation “printanière” de 2011 avait réussi à faire tomber le régime. En mars 2013, s’était ouverte une conférence réunissant 595 participants qui - même s’ils avaient été seulement sélectionnés par les envoyés du Conseil de Coopération du Golfe et donc non élus - représentaient (à l’exception d’Al-Qaeda et de Daech) les principales sensibilités du pays. Les Houthis, l’un des clans des vainqueurs de la poussée printanière, ont décidé dans ce contexte de contester un projet de Constitution fédérale dont ils estimaient qu’il les privait à la fois d’accès maritime et d’autonomie vis-à-vis de la capitale. Puis, pour amplifier leur protestation, ils se sont alliés à ce président sortant, en fait jamais vraiment sorti, qu’ils venaient de contribuer à déposer !
La liste des protagonistes du conflit est longue. Et elle est également changeante tant, en trois années, les alliances se sont modifiées. On peut distinguer aujourd’hui trois lignes de clivages, toutes les trois également internationalisées, sur des bases bien évidemment différentes : celle qui oppose les Houthis aux réminiscences (on a envie de dire aux ruines) du gouvernement de Abderrabo Mansour Hadi et aux membres de la coalition saoudienne, celle ensuite qui naît de la lutte du mouvement irrédentiste sudiste contre… le reste du Yémen et celle que forme la mobilisation des groupes radicaux contre… le reste du monde.
Le premier et le principal clivage est donc celui qui sépare les Houthis - avec puis sans leur allié Ali Abdallah Saleh - du reste du paysage politique. Les Houthis ont pour leur part choisi de mettre un terme au difficile mais néanmoins relativement prometteur processus de “dialogue national” auquel ils avaient accepté de participer, aux côtés des autres formations de l’opposition dont la mobilisation “printanière” de 2011 avait réussi à faire tomber le régime. En mars 2013, s’était ouverte une conférence réunissant 595 participants qui - même s’ils avaient été seulement sélectionnés par les envoyés du Conseil de Coopération du Golfe et donc non élus - représentaient (à l’exception d’Al-Qaeda et de Daech) les principales sensibilités du pays. Les Houthis, l’un des clans des vainqueurs de la poussée printanière, ont décidé dans ce contexte de contester un projet de Constitution fédérale dont ils estimaient qu’il les privait à la fois d’accès maritime et d’autonomie vis-à-vis de la capitale. Puis, pour amplifier leur protestation, ils se sont alliés à ce président sortant, en fait jamais vraiment sorti, qu’ils venaient de contribuer à déposer !
En décembre 2017, quelques jours avant d’être assassiné, Ali Abdallah Saleh a ensuite invité les membres de son parti (le Congrès Général du Peuple) à rompre cette alliance et à rechercher un terrain d’entente avec la coalition saoudienne. Leur chef une fois disparu, les membres du CGP n’ont manifestement pas tous répondu à son appel. Lentement en effet, le règne Houthi, malgré ses imperfections, tend à apparaître au nord, en l’absence d’alternative, comme un moindre mal [2]. A la tête du CGP, le successeur désigné par Ali Abdallah Saleh de son vivant (Ahmed, l’un de ses fils réfugié aux Emirats) a été écarté, le 8 janvier, au profit de l’ancien ministre de l’agriculture, Sadeq Amin Abou Rass. Derrière ces difficultés de succession se profile une autre réalité : le “parti du président” a aujourd’hui – comme à bien des égards la société politique toute entière - volé en éclats. Il serait divisé entre les trois grands acteurs régionaux, les Emiratis d’une part, les Saoudiens d’autre part mais également des Houthis, une quatrième partie des militants étant sans doute tout simplement démobilisée et repliée loin de tout activisme.
Contre qui les Houthis sont-ils donc aujourd’hui en lutte ?
En face de cette coalition des “rebelles”, le camp héritier de la posture légaliste, le seul à être à ce titre reconnu aujourd’hui par la communauté internationale, est dirigé par le Président Abderrabo Mansour Hadi. Le 21 février 2012, au terme d’une élection non concurrentielle, celui qui avait occupé depuis 1994 le poste de vice-président de Saleh, a été investi, pour un mandat de deux ans seulement (prolongé d’un an en 2015), de la responsabilité de lui succéder à la présidence de la République. Privé, au Sud dont il est originaire tout comme au Nord, d’une véritable légitimité populaire, le rôle de Hadi s’est vite réduit à n’être qu’une sorte de paravent/caution de l’ingérence de la coalition de dix pays sunnites qui, à l’initiative de l’Arabie Saoudite, s’est donné mandat, en mars 2015, de rétablir son pouvoir et donc, paradoxalement, la continuité révolutionnaire du printemps de 2011. Ce leadership est très vite devenu seulement théorique car Hadi, un temps basé à Aden dans l’enclave fortifiée d’al-Maachiq, s’en est fait chasser et a dû se réfugier à Riad. La stratégie militaire de la coalition a en effet très vite montré ses limites. Au sol, les milices (salafistes) armées et coordonnées par les Emiratis qui ont importé des chars, des armes lourdes et plusieurs centaines de mercenaires étrangers - chiliens, colombiens, panaméens ou australiens - ont certes réussi à “libérer” Aden des Houthistes qui ont de leur côté enrôlé massivement les travailleurs yéménites expulsés d’Arabie. Mais elles ont dû renoncer à faire de même plus au nord ou ailleurs que sur le territoire de l’ancienne République Démocratique et Populaire du Yémen. Le territoire du Nord (celui de l’ancienne RAY) est depuis lors le théâtre de frappes aériennes intensives, où ce sont les Saoudiens qui sont plus particulièrement investis [2]. Le pays a été placé sous un strict embargo international. Théoriquement réservé aux armements, il a vite affecté les circuits d’approvisionnement alimentaire et autres denrées de première nécessité, contribuant à générer dans la population un rejet quasi-généralisé de l’initiative saoudienne et de son “prétexte” local, le rétablissement du pouvoir de A. Mansour Hadi.
En face de cette coalition des “rebelles”, le camp héritier de la posture légaliste, le seul à être à ce titre reconnu aujourd’hui par la communauté internationale, est dirigé par le Président Abderrabo Mansour Hadi. Le 21 février 2012, au terme d’une élection non concurrentielle, celui qui avait occupé depuis 1994 le poste de vice-président de Saleh, a été investi, pour un mandat de deux ans seulement (prolongé d’un an en 2015), de la responsabilité de lui succéder à la présidence de la République. Privé, au Sud dont il est originaire tout comme au Nord, d’une véritable légitimité populaire, le rôle de Hadi s’est vite réduit à n’être qu’une sorte de paravent/caution de l’ingérence de la coalition de dix pays sunnites qui, à l’initiative de l’Arabie Saoudite, s’est donné mandat, en mars 2015, de rétablir son pouvoir et donc, paradoxalement, la continuité révolutionnaire du printemps de 2011. Ce leadership est très vite devenu seulement théorique car Hadi, un temps basé à Aden dans l’enclave fortifiée d’al-Maachiq, s’en est fait chasser et a dû se réfugier à Riad. La stratégie militaire de la coalition a en effet très vite montré ses limites. Au sol, les milices (salafistes) armées et coordonnées par les Emiratis qui ont importé des chars, des armes lourdes et plusieurs centaines de mercenaires étrangers - chiliens, colombiens, panaméens ou australiens - ont certes réussi à “libérer” Aden des Houthistes qui ont de leur côté enrôlé massivement les travailleurs yéménites expulsés d’Arabie. Mais elles ont dû renoncer à faire de même plus au nord ou ailleurs que sur le territoire de l’ancienne République Démocratique et Populaire du Yémen. Le territoire du Nord (celui de l’ancienne RAY) est depuis lors le théâtre de frappes aériennes intensives, où ce sont les Saoudiens qui sont plus particulièrement investis [2]. Le pays a été placé sous un strict embargo international. Théoriquement réservé aux armements, il a vite affecté les circuits d’approvisionnement alimentaire et autres denrées de première nécessité, contribuant à générer dans la population un rejet quasi-généralisé de l’initiative saoudienne et de son “prétexte” local, le rétablissement du pouvoir de A. Mansour Hadi.
Les alliances sont-elles demeurées pérennes ?
Non. Elles ont toutes évolué. Le camp des “révolutionnaires” - Hadi et ses soutiens saoudiens - était dès le début traversé de nombreuses divisions, idéologiques et stratégiques, qui ont contribué à complexifier un peu plus encore l’échiquier du conflit. Ainsi, le principal soutien intérieur d’A.M. Hadi, et donc de ses sponsors saoudiens et émiratis, se trouvait être le “parti du rassemblement islamique pour la réforme”, alias l’islah. Ce parti, qui est idéologiquement proche de la famille des Frères Musulmans, et donc d’obédience sunnite, est également doté d’appuis solides aussi bien dans le leadership des tribus zaidites du nord que dans l’armée. Fort d’une longue expérience d’opposition parlementaire, l’Islah a également acquis une expérience de gouvernement, Ali Abdallah Saleh l’ayant un temps associé à son gouvernement pour lutter, au lendemain de la réunification de 1990, contre les socialistes issus du régime du Sud. Or, pour des considérations de pure politique intérieure, les Saoudiens et plus encore les Emiratis sont connus pour être, à l’échelle régionale toute entière, de vibrants pourfendeurs des Frères Musulmans dans lesquels ils voient, avec raison, les plus menaçants - car les plus populaires - challengers de leur pouvoir [4]. L’une des manifestations de cette stratégie a été la spectaculaire campagne lancée à l’initiative de l’Arabie contre le Qatar, qui est donc de facto sorti de la coalition (comme d’ailleurs le Pakistan qui n’y a formellement figuré que quelques jours).
Non. Elles ont toutes évolué. Le camp des “révolutionnaires” - Hadi et ses soutiens saoudiens - était dès le début traversé de nombreuses divisions, idéologiques et stratégiques, qui ont contribué à complexifier un peu plus encore l’échiquier du conflit. Ainsi, le principal soutien intérieur d’A.M. Hadi, et donc de ses sponsors saoudiens et émiratis, se trouvait être le “parti du rassemblement islamique pour la réforme”, alias l’islah. Ce parti, qui est idéologiquement proche de la famille des Frères Musulmans, et donc d’obédience sunnite, est également doté d’appuis solides aussi bien dans le leadership des tribus zaidites du nord que dans l’armée. Fort d’une longue expérience d’opposition parlementaire, l’Islah a également acquis une expérience de gouvernement, Ali Abdallah Saleh l’ayant un temps associé à son gouvernement pour lutter, au lendemain de la réunification de 1990, contre les socialistes issus du régime du Sud. Or, pour des considérations de pure politique intérieure, les Saoudiens et plus encore les Emiratis sont connus pour être, à l’échelle régionale toute entière, de vibrants pourfendeurs des Frères Musulmans dans lesquels ils voient, avec raison, les plus menaçants - car les plus populaires - challengers de leur pouvoir [4]. L’une des manifestations de cette stratégie a été la spectaculaire campagne lancée à l’initiative de l’Arabie contre le Qatar, qui est donc de facto sorti de la coalition (comme d’ailleurs le Pakistan qui n’y a formellement figuré que quelques jours).
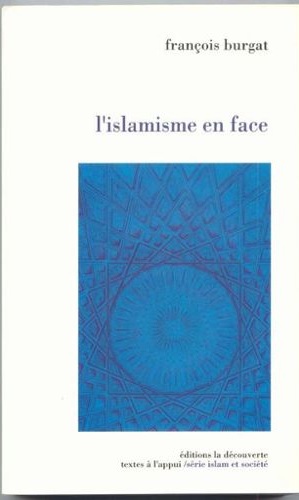
La trajectoire de Tawakul Karman, membre de la direction du parti al-Islah, récipiendaire en 2011 du prix Nobel de la paix, illustre de façon inattendue un volet au moins de l’évolution de ces alliances. Lorsque les Houthis affirment leur pouvoir sur Sanaa en janvier 2015, au détriment de celui de son parti, l’”Islah”, la “première femme politique yéménite”, forte de la visibilité que lui a conférée depuis 2011 son prix Nobel de la Paix, a choisi sans trop de nuances de confessionnaliser explicitement la crise et d’appeler depuis Riad “les pays sunnites” à venir “libérer le Yémen occupé par l’Iran”. Mais quelques mois plus tard, dans la foulée de l’embargo imposé au Qatar, en juin 2017, par l’Arabie (ainsi que le Bahrein, les Emirats et l’Egypte), démarche hostile à bien des égards à la mouvance des FM aux côtés desquels la diplomatie du Qatar était de longue date engagée, Tawakul Karman quitte ??? pour se réfugier cette fois en Turquie (dont elle a obtenu la nationalité dès octobre 2012). Aux yeux de Karman mais sans doute également aux yeux d’un certain nombre de ses compatriotes, dont des membres de l’Islah, les Saoudiens ont en quelque sorte “profité du coup de force des Houthis” pour en commettre un plus grave et plus dévastateur encore. Karman s’est donc mise à lancer cette fois de vibrantes attaques contre “l’agression émiratie et saoudienne contre le Yémen”.
En janvier 2018, au lendemain de l’assassinat par les Houthis (le 4 décembre 2017) d’Ali Abdallah Saleh en riposte à sa “trahison”, la coalition saoudienne, prenant conscience de la fragilité de son ancrage dans la population du pays qu’elle prétend “libérer”, s’est employée à améliorer ses liens avec les dirigeants du parti al-Islah. De retour d'Abou Dhabi, ceux -ci ont donc entrepris de se démarquer à la fois des Frères Musulmans dont ils ont déclaré ne plus faire partie et des déclarations hostiles de certains de leurs membres à l’égard de la coalition. Et la conséquence logique de ce resserrement des liens ne s’est pas faite attendre : le 4 février 2018, Tawakul Karman a fait l’objet d’une exclusion de son parti.
En janvier 2018, au lendemain de l’assassinat par les Houthis (le 4 décembre 2017) d’Ali Abdallah Saleh en riposte à sa “trahison”, la coalition saoudienne, prenant conscience de la fragilité de son ancrage dans la population du pays qu’elle prétend “libérer”, s’est employée à améliorer ses liens avec les dirigeants du parti al-Islah. De retour d'Abou Dhabi, ceux -ci ont donc entrepris de se démarquer à la fois des Frères Musulmans dont ils ont déclaré ne plus faire partie et des déclarations hostiles de certains de leurs membres à l’égard de la coalition. Et la conséquence logique de ce resserrement des liens ne s’est pas faite attendre : le 4 février 2018, Tawakul Karman a fait l’objet d’une exclusion de son parti.
Quel est dans tout cela le rôle des groupes radicaux ?
Il faut effectivement mentionner ensuite l’existence d’une sorte de “second” Yémen[5], celui des groupes radicaux sunnites, al-Qaïda d’abord, puis son rival l’Etat islamique ou Daech. Ils ont pour première caractéristique d’être tous deux hostiles à toute dynamique de concertation. Ils ont tous deux un agenda militaire, dont l’une des principales particularités - outre le recours à des modes d’actions tels que les attentats suicides - est qu’il ne s’inscrit pas à l’intérieur des frontières du Yémen. Accessoirement, ces groupes sont également en rivalité, pas seulement idéologique. Par rapport au pouvoir de l’ancien président Saleh ou de son successeur Hadi, les Houthis constituent un adversaire plus “naturel” encore puisque ils sont identifiés comme des chiites. L’agenda de Daech s’est ressenti tout particulièrement de cette dimension sectaire et des civils, seulement coupables de fréquenter des mosquées zaydites, ont été régulièrement la cible d’attentats meurtriers. Il est intéressant de noter qu’en revanche al-Qaïda dans la Péninsule arabique (AQPA), dérivée de l’organisation fondée par Oussama Ben Laden, qui avait lui-même exprimé une vision classiquement politique de la problématique yéménite, est nettement moins engagée dans une logique sectaire que sa “jeune” concurrente Daech. Elle n’avait en tous les cas pas attendu l’arrivée au pouvoir des Houthis pour combattre - fût-il sunnite - le pouvoir installé à Sanaa. Même si AQPA semble avoir bénéficié d’une longue tolérance de la coalition, qui a espéré y trouver un partenaire dans sa lutte contre les Houthis, les attaques qu’elle a revendiquées ont frappé assez indistinctement les membres ou les adversaires de la coalition “sunnite”.
Il faut effectivement mentionner ensuite l’existence d’une sorte de “second” Yémen[5], celui des groupes radicaux sunnites, al-Qaïda d’abord, puis son rival l’Etat islamique ou Daech. Ils ont pour première caractéristique d’être tous deux hostiles à toute dynamique de concertation. Ils ont tous deux un agenda militaire, dont l’une des principales particularités - outre le recours à des modes d’actions tels que les attentats suicides - est qu’il ne s’inscrit pas à l’intérieur des frontières du Yémen. Accessoirement, ces groupes sont également en rivalité, pas seulement idéologique. Par rapport au pouvoir de l’ancien président Saleh ou de son successeur Hadi, les Houthis constituent un adversaire plus “naturel” encore puisque ils sont identifiés comme des chiites. L’agenda de Daech s’est ressenti tout particulièrement de cette dimension sectaire et des civils, seulement coupables de fréquenter des mosquées zaydites, ont été régulièrement la cible d’attentats meurtriers. Il est intéressant de noter qu’en revanche al-Qaïda dans la Péninsule arabique (AQPA), dérivée de l’organisation fondée par Oussama Ben Laden, qui avait lui-même exprimé une vision classiquement politique de la problématique yéménite, est nettement moins engagée dans une logique sectaire que sa “jeune” concurrente Daech. Elle n’avait en tous les cas pas attendu l’arrivée au pouvoir des Houthis pour combattre - fût-il sunnite - le pouvoir installé à Sanaa. Même si AQPA semble avoir bénéficié d’une longue tolérance de la coalition, qui a espéré y trouver un partenaire dans sa lutte contre les Houthis, les attaques qu’elle a revendiquées ont frappé assez indistinctement les membres ou les adversaires de la coalition “sunnite”.
Le retour de l’irrédentisme du Sud ?
Il reste en effet une troisième ligne de clivage, réactivée par la crise, entre les sécessionnistes du Sud d’une part et les Houthis aussi bien que le gouvernement soutenu par la coalition saoudienne. Ceux là sont partisans du retour à la situation qui avait précédé la réunification de mai 1990. Alors que l’affirmation des Houthis, à partir de 2004, avait réouvert, jusqu’à un certain point au moins, la déchirure de la guerre républicaine des années soixante (entre “royalistes” partisans de l’Imamat zaydite, alors soutenus par les Saoudiens et les “républicains” soutenus ou même portés alors par l’égyptien Abdel Nasser), la poussée des sécessionnistes du Sud s’opère le long de la fracture Nord-Sud que la réunification de 1990, mise à mal en juillet 1994 par la fugitive rébellion des troupes du Sud, n’a jamais réussi à refermer complètement [6]. Depuis le début de l’année 2018, cette dynamique sudiste s’est spectaculairement accélérée [7]. La création d’un Conseil de transition sudiste (CST) avait été annoncée dès le 11 mai 2017, à l’initiative de deux anciens collaborateurs du président Hadi, Aïdarous al-Zubaïdi (gouverneur d’Aden) et le ministre d’Etat Hedi Ben Brik, tous deux licenciés après avoir exprimé leurs sympathies sécessionnistes. En janvier 2018, au terme de plusieurs jours d’affrontements, le CST a réussi à prendre le contrôle de la quasi-totalité de la ville, au détriment des troupes demeurées fidèles à Hadi. Rien de tel n’aurait bien sûr pu se produire sans soutien extérieur. Celui-ci est paradoxalement venu des Emiratis. Cette troisième ligne de fracture du conflit s’est en effet internationalisée le long d’un nouveau clivage, interne à la coalition, qui a donc ouvert une faille dans le jeu des alliances régionales, les Saoudiens, et leur obligé le président Hadi étant loin de s’être rangés à une telle option sécessionniste.. Riad continue en effet à espérer faire chuter les Houthis pour installer à sa frontière sud un régime prêt à lui témoigner sa reconnaissance. Les Emiratis en revanche ont choisi de soutenir très ouvertement la partition pour laquelle oeuvre le Conseil sudiste de transition. D’abord parce qu’ils sont, plus encore que les Saoudiens, soucieux de trouver une alternative au leadership de la famille politique de l’Islah dont, malgré leurs récentes concessions, ils redoutent plus particulièrement l’influence. Ensuite parce qu’ils ont, semble-t-il, une volonté de contrôler le plus possible les ports et façades maritimes le long de la voie navale d’échanges commerciaux passant par le détroit du Bab el Mandeb, volonté qui les amènent à prendre pied également au Somaliland et en Erythrée [8].
Il reste en effet une troisième ligne de clivage, réactivée par la crise, entre les sécessionnistes du Sud d’une part et les Houthis aussi bien que le gouvernement soutenu par la coalition saoudienne. Ceux là sont partisans du retour à la situation qui avait précédé la réunification de mai 1990. Alors que l’affirmation des Houthis, à partir de 2004, avait réouvert, jusqu’à un certain point au moins, la déchirure de la guerre républicaine des années soixante (entre “royalistes” partisans de l’Imamat zaydite, alors soutenus par les Saoudiens et les “républicains” soutenus ou même portés alors par l’égyptien Abdel Nasser), la poussée des sécessionnistes du Sud s’opère le long de la fracture Nord-Sud que la réunification de 1990, mise à mal en juillet 1994 par la fugitive rébellion des troupes du Sud, n’a jamais réussi à refermer complètement [6]. Depuis le début de l’année 2018, cette dynamique sudiste s’est spectaculairement accélérée [7]. La création d’un Conseil de transition sudiste (CST) avait été annoncée dès le 11 mai 2017, à l’initiative de deux anciens collaborateurs du président Hadi, Aïdarous al-Zubaïdi (gouverneur d’Aden) et le ministre d’Etat Hedi Ben Brik, tous deux licenciés après avoir exprimé leurs sympathies sécessionnistes. En janvier 2018, au terme de plusieurs jours d’affrontements, le CST a réussi à prendre le contrôle de la quasi-totalité de la ville, au détriment des troupes demeurées fidèles à Hadi. Rien de tel n’aurait bien sûr pu se produire sans soutien extérieur. Celui-ci est paradoxalement venu des Emiratis. Cette troisième ligne de fracture du conflit s’est en effet internationalisée le long d’un nouveau clivage, interne à la coalition, qui a donc ouvert une faille dans le jeu des alliances régionales, les Saoudiens, et leur obligé le président Hadi étant loin de s’être rangés à une telle option sécessionniste.. Riad continue en effet à espérer faire chuter les Houthis pour installer à sa frontière sud un régime prêt à lui témoigner sa reconnaissance. Les Emiratis en revanche ont choisi de soutenir très ouvertement la partition pour laquelle oeuvre le Conseil sudiste de transition. D’abord parce qu’ils sont, plus encore que les Saoudiens, soucieux de trouver une alternative au leadership de la famille politique de l’Islah dont, malgré leurs récentes concessions, ils redoutent plus particulièrement l’influence. Ensuite parce qu’ils ont, semble-t-il, une volonté de contrôler le plus possible les ports et façades maritimes le long de la voie navale d’échanges commerciaux passant par le détroit du Bab el Mandeb, volonté qui les amènent à prendre pied également au Somaliland et en Erythrée [8].
Ali Abdallah Saleh, ancien président yéménite, a été tué début décembre 2017 par ses anciens alliés houthistes. Qui était-il ? Comment est-il parvenu à s'imposer sur la scène politique yéménite avant les débuts de la guerre ?
Ali Abdallah Saleh (21 juillet 1947 - 4 décembre 2017) n’était pas la figure la plus séduisante du paysage politique arabe même si, il est vrai, de Bachar al-Assad à Saddam Hussein, la concurrence existe. La génération des Nasser, Boumediene ou Bourguiba avait un idéal nationaliste clairement identifiable. Saleh, plus encore que d’autres, apparaît aujourd’hui comme une sorte d’archétype de ces leaders dont la trajectoire a été avant tout opportuniste. Sans ressources sociales particulières, l’origine de son ascendant personnel a sans doute à voir avec la richesse qu’il a accumulée en instaurant - grâce à ses pouvoirs de chef de la région militaire commandant la façade maritime de la Tihama et avec l’aide d’un restaurateur libanais de Sanaa - un très rémunérateur trafic d’alcool. Pour se maintenir au pouvoir, il a démontré ensuite un talent et un cynisme certains, n’hésitant jamais à instrumentaliser chacune des divisions, régionalistes et confessionnelles, de sa société. Il l’a fait en 2004 pour, comme cela a été dit, discréditer les critiques banalement politiques de ses interlocuteurs Houthis, qui moquaient les concessions qu’il avait été contraint de faire aux Américains dans le cadre de leur “guerre contre la terreur”. En 2006, pour combattre cette fois l’influence croissante du Hizbollah après ses succès militaires contre Israël en 2006, Saleh n’avait pas hésité à mettre en avant l’identité confessionnelle (chiite) des bourreaux de Saddam Hussein, baptisé pour la circonstance “le lion des sunnites”. On sait qu’ensuite il s’est allié à ces même Houthis à qui il avait infligé six guerres successives avant de les trahir et de se retourner contre eux, ou de tenter de le faire, avec pour lui, les conséquences tragiques que l’on sait.
Ali Abdallah Saleh (21 juillet 1947 - 4 décembre 2017) n’était pas la figure la plus séduisante du paysage politique arabe même si, il est vrai, de Bachar al-Assad à Saddam Hussein, la concurrence existe. La génération des Nasser, Boumediene ou Bourguiba avait un idéal nationaliste clairement identifiable. Saleh, plus encore que d’autres, apparaît aujourd’hui comme une sorte d’archétype de ces leaders dont la trajectoire a été avant tout opportuniste. Sans ressources sociales particulières, l’origine de son ascendant personnel a sans doute à voir avec la richesse qu’il a accumulée en instaurant - grâce à ses pouvoirs de chef de la région militaire commandant la façade maritime de la Tihama et avec l’aide d’un restaurateur libanais de Sanaa - un très rémunérateur trafic d’alcool. Pour se maintenir au pouvoir, il a démontré ensuite un talent et un cynisme certains, n’hésitant jamais à instrumentaliser chacune des divisions, régionalistes et confessionnelles, de sa société. Il l’a fait en 2004 pour, comme cela a été dit, discréditer les critiques banalement politiques de ses interlocuteurs Houthis, qui moquaient les concessions qu’il avait été contraint de faire aux Américains dans le cadre de leur “guerre contre la terreur”. En 2006, pour combattre cette fois l’influence croissante du Hizbollah après ses succès militaires contre Israël en 2006, Saleh n’avait pas hésité à mettre en avant l’identité confessionnelle (chiite) des bourreaux de Saddam Hussein, baptisé pour la circonstance “le lion des sunnites”. On sait qu’ensuite il s’est allié à ces même Houthis à qui il avait infligé six guerres successives avant de les trahir et de se retourner contre eux, ou de tenter de le faire, avec pour lui, les conséquences tragiques que l’on sait.
Sa mort met-elle fin aux espoirs d'une résolution du conflit en cours?
Sa mort est un épisode important du conflit mais ce n’en est pas le tournant, que de nombreux observateurs, dont j’ai d’ailleurs fait partie, ont pu un temps envisager. En effet, la relative facilité avec laquelle Saleh a été encerclé puis assassiné à son domicile, au coeur d’une région où plusieurs tribus et/ou segments de l’armée ou membres de son parti le Congrès Général du Peuple auraient dû le protéger, démontre en quelque sorte que lorsqu’il a fait défection, il avait été largement “démonétisé” par ses “partenaires” et surtout rivaux houthis. Et qu’il ne constituait donc plus une pièce maîtresse de l’échiquier politique national dont la disparition serait susceptible de changer significativement le cours des choses.
La guerre au Yémen bénéficie d'une couverture médiatique moindre par rapport à d'autres conflits (ex. Syrie, Libye) y compris dans le monde arabo-musulman. Peut-on expliquer cette absence de médiatisation ?
L’une des raisons de cette relative indifférence, française et européenne en générale, est sans doute que l’inusable logiciel “islamistes” contre “laïcs”, au travers duquel les élites européennes limitent trop systématiquement leur lecture des tensions qui déchirent n’importe quelle société du monde musulman, montre ici, plus particulièrement encore que par le passé, ses limites criantes. La figure de “la jeune combattante kurde laïque aux cheveux longs” posant dans les ruines produites par les aviations occidentales, qui déforme jusqu’à l’aveuglement la perception de la crise irako-syrienne, n’a pas cours au Yémen. Aux “pétro-fondamentalistes” saoudiens volant au secours d’un parti islamiste (al-Islah) font face des Houthistes dont le slogan, marqué par l’influence iranienne, n’est autre que “Dieu est grand, mort à l’Amérique, mort à Israël, la malédiction sur les juifs, l’islam vaincra”. Cette situation interdit donc aux “anti-Saoudiens” comme aux “anti-Iraniens”, majoritaires dans les opinions occidentales, d’identifier au Yémen le moindre “camp de la laïcité” ou de “la modernité” menacé pour y ancrer leur empathie. S’ajoute ensuite, bien évidemment, le versant clientéliste qui lie Français, Britanniques ou Américains à leur excellent client saoudien. La France est à ce jour “très discrètement co-belligerante”. Elle fournit à son client saoudien armes, munitions mais également...cibles, repérées par satellite mais également, parfois, par avions ! [9]. En dernière instance, si la campagne saoudienne reçoit l’appui aveugle des Etats Unis, c’est à cause de l’ampleur des contrats d’armements que brandit régulièrement Donald Trump avec une rare indécence [10]. Mais c’est également parce que ces armes sont réputés affaiblir, par Houthis interposés - même si tout porte à croire qu’il n’en est absolument rien - l’ennemi obsessionnel (l’Iran) du premier allié des Etats Unis - l’Etat Hébreu - dans la région.
Sa mort est un épisode important du conflit mais ce n’en est pas le tournant, que de nombreux observateurs, dont j’ai d’ailleurs fait partie, ont pu un temps envisager. En effet, la relative facilité avec laquelle Saleh a été encerclé puis assassiné à son domicile, au coeur d’une région où plusieurs tribus et/ou segments de l’armée ou membres de son parti le Congrès Général du Peuple auraient dû le protéger, démontre en quelque sorte que lorsqu’il a fait défection, il avait été largement “démonétisé” par ses “partenaires” et surtout rivaux houthis. Et qu’il ne constituait donc plus une pièce maîtresse de l’échiquier politique national dont la disparition serait susceptible de changer significativement le cours des choses.
La guerre au Yémen bénéficie d'une couverture médiatique moindre par rapport à d'autres conflits (ex. Syrie, Libye) y compris dans le monde arabo-musulman. Peut-on expliquer cette absence de médiatisation ?
L’une des raisons de cette relative indifférence, française et européenne en générale, est sans doute que l’inusable logiciel “islamistes” contre “laïcs”, au travers duquel les élites européennes limitent trop systématiquement leur lecture des tensions qui déchirent n’importe quelle société du monde musulman, montre ici, plus particulièrement encore que par le passé, ses limites criantes. La figure de “la jeune combattante kurde laïque aux cheveux longs” posant dans les ruines produites par les aviations occidentales, qui déforme jusqu’à l’aveuglement la perception de la crise irako-syrienne, n’a pas cours au Yémen. Aux “pétro-fondamentalistes” saoudiens volant au secours d’un parti islamiste (al-Islah) font face des Houthistes dont le slogan, marqué par l’influence iranienne, n’est autre que “Dieu est grand, mort à l’Amérique, mort à Israël, la malédiction sur les juifs, l’islam vaincra”. Cette situation interdit donc aux “anti-Saoudiens” comme aux “anti-Iraniens”, majoritaires dans les opinions occidentales, d’identifier au Yémen le moindre “camp de la laïcité” ou de “la modernité” menacé pour y ancrer leur empathie. S’ajoute ensuite, bien évidemment, le versant clientéliste qui lie Français, Britanniques ou Américains à leur excellent client saoudien. La France est à ce jour “très discrètement co-belligerante”. Elle fournit à son client saoudien armes, munitions mais également...cibles, repérées par satellite mais également, parfois, par avions ! [9]. En dernière instance, si la campagne saoudienne reçoit l’appui aveugle des Etats Unis, c’est à cause de l’ampleur des contrats d’armements que brandit régulièrement Donald Trump avec une rare indécence [10]. Mais c’est également parce que ces armes sont réputés affaiblir, par Houthis interposés - même si tout porte à croire qu’il n’en est absolument rien - l’ennemi obsessionnel (l’Iran) du premier allié des Etats Unis - l’Etat Hébreu - dans la région.
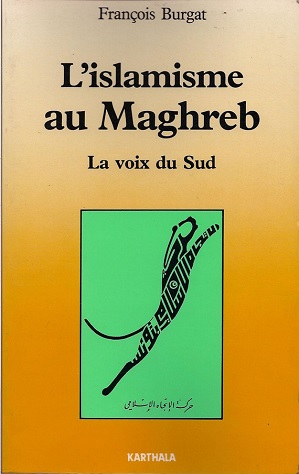
L'ONU a-t-elle pris des initiatives pour mobiliser la "communauté internationale" sur ce conflit? La Ligue arabe ?
Bien évidemment plusieurs tentatives ont été menées, principalement mais pas seulement sous l’égide de l’ONU, du Koweit ou du Sultanat d’Oman. Le Sultanat d’Oman, seul pays du Conseil de Coopération du Golfe à être demeuré extérieur à la coalition saoudienne, y a joué un rôle privilégié, tout comme l’ONU par l’intermédiaire de ses trois représentants successifs: le Marocain Jamal Benomar, le Mauritanien Ould Cheikh (2015- février 2018) puis le Britannique Martin Griffiths. Pas plus qu’en Syrie ou en Libye, les médiations de l’ONU n’ont véritablement convaincu. La Ligue arabe, est-il besoin de le rappeler, est de facto elle-même trop directement sous l’influence des dix pays de la coalition “sunnite” pour espérer jouer un rôle différent de celle-ci. Et l’ONU, pas plus que dans d’autres conflits, n’a réussi à émerger comme une institution dotée d’une quelconque autonomie par rapport aux acteurs dominants dans la région, en l’occurrence le clan emmené par les Saoudiens. La principale raison de l’échec répété de ces tentatives de négociations tient avant tout au fait que la coalition saoudienne, épaulée par les Occidentaux, n’a jamais voulu considérer la réalité du rapport de force né de la poussée militaire des Houthis et de leur allié d’un temps Ali Abdallah Saleh. Et qu’ils ont donc toujours voulu imposer une base de négociation (retour à la case départ niant les prises de guerre des Houthis) irréaliste et comme telle assez logiquement rejetée par le camp concerné. Même si la situation yéménite est loin d’être aussi polarisée que celle de la Syrie, les Russes n’en sont pas absents. En février 2018, au Conseil de Sécurité, les Britanniques les ont confrontés avec des motions visant à faire condamner le soutien iranien aux Houthis.
Bien évidemment plusieurs tentatives ont été menées, principalement mais pas seulement sous l’égide de l’ONU, du Koweit ou du Sultanat d’Oman. Le Sultanat d’Oman, seul pays du Conseil de Coopération du Golfe à être demeuré extérieur à la coalition saoudienne, y a joué un rôle privilégié, tout comme l’ONU par l’intermédiaire de ses trois représentants successifs: le Marocain Jamal Benomar, le Mauritanien Ould Cheikh (2015- février 2018) puis le Britannique Martin Griffiths. Pas plus qu’en Syrie ou en Libye, les médiations de l’ONU n’ont véritablement convaincu. La Ligue arabe, est-il besoin de le rappeler, est de facto elle-même trop directement sous l’influence des dix pays de la coalition “sunnite” pour espérer jouer un rôle différent de celle-ci. Et l’ONU, pas plus que dans d’autres conflits, n’a réussi à émerger comme une institution dotée d’une quelconque autonomie par rapport aux acteurs dominants dans la région, en l’occurrence le clan emmené par les Saoudiens. La principale raison de l’échec répété de ces tentatives de négociations tient avant tout au fait que la coalition saoudienne, épaulée par les Occidentaux, n’a jamais voulu considérer la réalité du rapport de force né de la poussée militaire des Houthis et de leur allié d’un temps Ali Abdallah Saleh. Et qu’ils ont donc toujours voulu imposer une base de négociation (retour à la case départ niant les prises de guerre des Houthis) irréaliste et comme telle assez logiquement rejetée par le camp concerné. Même si la situation yéménite est loin d’être aussi polarisée que celle de la Syrie, les Russes n’en sont pas absents. En février 2018, au Conseil de Sécurité, les Britanniques les ont confrontés avec des motions visant à faire condamner le soutien iranien aux Houthis.
Voyez-vous une issue à cette guerre? Si oui, laquelle?
Au regard de la situation actuelle sur le terrain, disons avant tout qu’il est extrêmement difficile d'imaginer une victoire militaire de la coalition. Plus que jamais, la porte de sortie de la crise sera donc négociée. Pour qu'une négociation ait une chance d'aboutir, il faudra banalement que les points de vue des deux principaux belligérants, i.e. la coalition et les Houthis, se rapprochent. Il faudra manifestement pour se faire que la coalition saoudienne cesse d’exiger de leurs adversaires, de façon très irréaliste, de négocier sans moindrement tenir compte de leur victoire militaire. Pour parvenir à ce désengagement réaliste de l’Arabie, il faudra que ses sponsors occidentaux révisent leur politique de soutien aveugle. Un éventuel accord entre Houthis et Saoudiens laissera toutefois intact deux autres lignes de clivage. Celle d’abord qui sépare les partisans et les adversaires du nouvel irrédentisme sudiste. Celle aussi qui coupe le Yémen “politique” de l’agenda transnational des groupes sunnites radicaux Daech et al- Qaïda.
En février 2018, les Houthis ont fait eux-mêmes une proposition de paix qui n’a pas véritablement retenu l’attention de la communauté internationale. Diverses tentatives sont en cours actuellement pour chercher des pistes d’accord entre les seuls acteurs internes du conflit. Des pourparlers directs entre Saoudiens et Houthis seraient (démentis par les Houthis) en cours à Oman, hors de la présence du gouvernement Hadi que les Saoudiens pourraient être prêts à lâcher pour prix d’un accord avec le principal belligérant.
Mais à ce jour aucune brèche n’apparaît encore très clairement dans ce cercle vicieux très international qui a plongé depuis maintenant trois ans le pays dans une crise non seulement politique mais également humanitaire sans précédent (une très large majorité - 22.2 million de Yéménites sur 27.5 - serait aujourd’hui aux frontières de la malnutrition) et condamne des millions de Yéménites au désespoir.
Au regard de la situation actuelle sur le terrain, disons avant tout qu’il est extrêmement difficile d'imaginer une victoire militaire de la coalition. Plus que jamais, la porte de sortie de la crise sera donc négociée. Pour qu'une négociation ait une chance d'aboutir, il faudra banalement que les points de vue des deux principaux belligérants, i.e. la coalition et les Houthis, se rapprochent. Il faudra manifestement pour se faire que la coalition saoudienne cesse d’exiger de leurs adversaires, de façon très irréaliste, de négocier sans moindrement tenir compte de leur victoire militaire. Pour parvenir à ce désengagement réaliste de l’Arabie, il faudra que ses sponsors occidentaux révisent leur politique de soutien aveugle. Un éventuel accord entre Houthis et Saoudiens laissera toutefois intact deux autres lignes de clivage. Celle d’abord qui sépare les partisans et les adversaires du nouvel irrédentisme sudiste. Celle aussi qui coupe le Yémen “politique” de l’agenda transnational des groupes sunnites radicaux Daech et al- Qaïda.
En février 2018, les Houthis ont fait eux-mêmes une proposition de paix qui n’a pas véritablement retenu l’attention de la communauté internationale. Diverses tentatives sont en cours actuellement pour chercher des pistes d’accord entre les seuls acteurs internes du conflit. Des pourparlers directs entre Saoudiens et Houthis seraient (démentis par les Houthis) en cours à Oman, hors de la présence du gouvernement Hadi que les Saoudiens pourraient être prêts à lâcher pour prix d’un accord avec le principal belligérant.
Mais à ce jour aucune brèche n’apparaît encore très clairement dans ce cercle vicieux très international qui a plongé depuis maintenant trois ans le pays dans une crise non seulement politique mais également humanitaire sans précédent (une très large majorité - 22.2 million de Yéménites sur 27.5 - serait aujourd’hui aux frontières de la malnutrition) et condamne des millions de Yéménites au désespoir.
_____________________
[1] Voir sur ce sujet la très fine étude de Laurent Bonnefoy et Abdussalam al Rubaidi, “Recompositions islamistes sunnites et polarisation confessionnelle dans le Yémen en guerre”, in Avec ou sans les Frères. Les islamistes arabes face à la résilience autoritaire (Laurent Bonnefoy et François Burgat, dir.), Critique internationale, 2018/1 (n° 78).
[2] Le Monde.
[3] A titre d’exemple, disons que ces frappes ont été plus nombreuses encore que celles de la coalition internationale pilotée par les Etats-Unis sur la Syrie ou sur l’Irak.
[4] Cf. Marc Cher Leparrain, Les Emirats arabes, chasseurs de Frères musulmans, une politique régionale méconnue : https://orientxxi.info/magazine/les-emirats-arabes-unis-chasseurs-de-freres-musulmans,1718.
[5] FB “Le Yémen en 2014 : le fédéralisme contre les motos et les drônes ?”: https://iremam.hypotheses.org/4619.
[6] Voir Franck Mermier in Yémen, le tournant révolutionnaire: http://www.karthala.com/hommes-et-societes-sciences-economiques-et-politiques/2587-yemen-le-tournant-revolutionnaire-9782811106935.html.
[7] Cf Laurent Bonnefoy, Au Yémen, une frontière entre le nord et le sud reprend forme dans les esprits: http://www.lemonde.fr/international/article/2018/03/16/laurent-bonnefoy-au-yemen-une-frontiere-entre-le-nord-et-le-sud-reprend-forme-dans-les-esprits_5271970_3210.html?xtmc=laurent_bonnefoy&xtcr=1.
[8] Sur les rivalités régionales (Oman, Arabie Saoudite et Emirats), voir notamment http://blogs.lse.ac.uk/mec/2017/12/28/emiratis-omanis-saudis-the-rising-competition-for-yemens-al-mahr.
[9] http://www.lefigaro.fr/international/2016/05/05/01003-20160505ARTFIG00132-arabie-yemen-guerre-et-trafics-sur-une-frontiere-brulante.php?redirect_premium.
[10] https://www.youtube.com/watch?v=ykJXkcepiIQ.
[1] Voir sur ce sujet la très fine étude de Laurent Bonnefoy et Abdussalam al Rubaidi, “Recompositions islamistes sunnites et polarisation confessionnelle dans le Yémen en guerre”, in Avec ou sans les Frères. Les islamistes arabes face à la résilience autoritaire (Laurent Bonnefoy et François Burgat, dir.), Critique internationale, 2018/1 (n° 78).
[2] Le Monde.
[3] A titre d’exemple, disons que ces frappes ont été plus nombreuses encore que celles de la coalition internationale pilotée par les Etats-Unis sur la Syrie ou sur l’Irak.
[4] Cf. Marc Cher Leparrain, Les Emirats arabes, chasseurs de Frères musulmans, une politique régionale méconnue : https://orientxxi.info/magazine/les-emirats-arabes-unis-chasseurs-de-freres-musulmans,1718.
[5] FB “Le Yémen en 2014 : le fédéralisme contre les motos et les drônes ?”: https://iremam.hypotheses.org/4619.
[6] Voir Franck Mermier in Yémen, le tournant révolutionnaire: http://www.karthala.com/hommes-et-societes-sciences-economiques-et-politiques/2587-yemen-le-tournant-revolutionnaire-9782811106935.html.
[7] Cf Laurent Bonnefoy, Au Yémen, une frontière entre le nord et le sud reprend forme dans les esprits: http://www.lemonde.fr/international/article/2018/03/16/laurent-bonnefoy-au-yemen-une-frontiere-entre-le-nord-et-le-sud-reprend-forme-dans-les-esprits_5271970_3210.html?xtmc=laurent_bonnefoy&xtcr=1.
[8] Sur les rivalités régionales (Oman, Arabie Saoudite et Emirats), voir notamment http://blogs.lse.ac.uk/mec/2017/12/28/emiratis-omanis-saudis-the-rising-competition-for-yemens-al-mahr.
[9] http://www.lefigaro.fr/international/2016/05/05/01003-20160505ARTFIG00132-arabie-yemen-guerre-et-trafics-sur-une-frontiere-brulante.php?redirect_premium.
[10] https://www.youtube.com/watch?v=ykJXkcepiIQ.