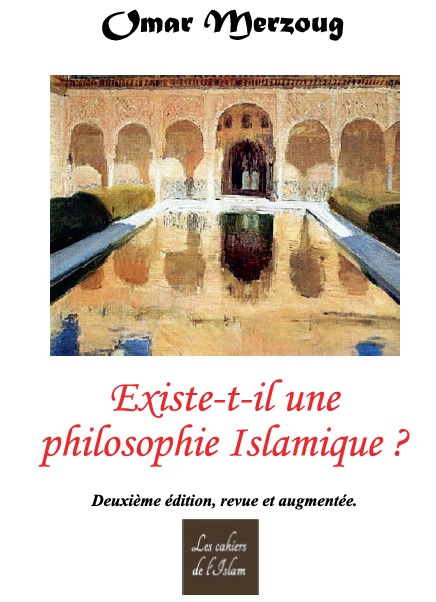Connu comme réalisateur pour des films comme Fotoğraf (2001) ou Bahoz (2009), Ka zım Öz a découvert les coulisses du cinéma dans les années 90 au sein du Collectif cinéma du Centre culturel Mésopotamie [Mezopotamya Kültür Merkezi]. Créée en 1996, l’initiative naît alors d’une envie de faire connaître la culture kurde à un large public, au-delà de ses territoires. Les années 90 sont des années de conflits dans les régions kurdes, et le collectif se donne pour objectif d’éveiller les consciences sur « les tabous de la question kurde et les aspects les plus sombres de la guerre civile ». En 18 ans d’existence, le collectif est parvenu à s’imposer comme un des principaux représentants du cinéma kurde en Turquie et à l’étranger. Assurer le bon déroulement des tournages constitue une première difficulté ; assurer la diffusion et la projection des films en est une autre. Le cinéma « alternatif » et le cinéma kurde n’ont pas toujours eu droit de cité. Diyarbakır, Batman, Dersim, les salles de cinéma alternatives d’Istanbul, les festivals en Turquie et à l’étranger… À écouter Kazım Öz, on visualise progressivement des espaces plus ou moins autorisés, une « géographie de la permissivité » en quelque sorte. L’atmosphère politique en Turquie et la défense de la turcité ont souvent confiné l’expression des identités minoritaires à des cercles fermés. Kazım Öz a récemment quitté le collectif, mais il poursuit son métier de cinéaste. Nous sommes revenus sur l’histoire du collectif et sur son expérience du monde artistique, afin de mieux comprendre les motivations de sa prise de parole, mais aussi ses limites.
Kazım Öz– Le Centre culturel Mésopotamie a ouvert en 1991, mais le Collectif cinéma ne s’est créé qu’un peu plus tard, en 1996. J’étais parmi les premiers étudiants du cours de cinéma qui s’est monté au sein du centre culturel. Une fois le projet lancé, nous avons rapidement créé un collectif avec quelques ami-e-s. Les premiers films du collectif ont été produits dès 1996, mais c’est avec le tournage et la sortie de Ax en 1999 [1] que les choses sérieuses ont véritablement commencé. Je faisais des études pour devenir ingénieur en bâtiment et je ne m’y connaissais absolument pas en cinéma. Il nous a bien fallu quelques années de travail avant d’acquérir un niveau satisfaisant dans le domaine. Nous avons progressé ensemble : nous étions tour à tour étudiant et professeur, et chacun enseignait aux autres. Nous choisissions une spécialité (le cinéma de la Nouvelle Vague par exemple), nous prenions le temps de faire des recherches sur le sujet et nous revenions le présenter aux autres membres du groupe. Nous organisions des débats, des projections de films en tous genres (court et long métrages, documentaires, etc.). En 10-15 ans d’existence, le collectif a produit près de 40 films. Nous avons également organisé des festivals au Kurdistan pendant 4-5 ans : le festival Yılmaz Güney à Batman, par exemple, ou encore le festival du film des droits de l’homme à Dersim.
CPM- Y avait-il parmi vous des étudiant-e-s en cinéma ? Quelle était la principale motivation à l’origine de la création du collectif ? À un niveau plus personnel, qu’est-ce qui vous a poussé à rejoindre le collectif ?
KÖ- Il y avait quelques étudiant-e-s en cinéma, mais ce n’était pas un critère déterminant. Les membres étaient issus d’horizons divers. Le groupe a commencé avec une dizaine de personnes, certains membres sont partis au fil des années quand d’autres nous ont rejoint, mais je fais partie de ceux qui sont là depuis le début. Notre motivation venait de notre intérêt pour les différents types de cinéma alternatif, cinéma révolutionnaire et notamment l’idée d’un cinéma kurde. Les années 90 ont été des années de découverte identitaire pour les Kurdes et cette découverte a eu une influence sur tous les domaines artistiques : peinture, théâtre, cinéma. Le Collectif cinéma avait pour objectif d’être tout à fait indépendant d’un point de vue de la production, des financements, des projections… indépendant du marché du film en somme. C’est comme cela que nous avons officiellement monté l’entreprise Yapım13 pour le montage et la distribution. Le collectif a plus ou moins réussi à faire passer son message selon les films, mais nous en avons tout de même produit un certain nombre.
CPM– Le Collectif cinéma était donc à la fois un lieu de formation et un lieu de production du cinéma. Vous organisiez d’ailleurs des ateliers dans ce sens. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces ateliers : quel était l’objectif et qui pouvait y participer ?
KÖ- Oui, nous avons pu organiser un atelier par an à Istanbul ces cinq dernières années. J’en étais le responsable. Il s’agissait de formations sur 6 mois à raison de trois soirs par semaine, avec un effectif d’une vingtaine d’étudiant-e-s plus une dizaine d’enseignant-e-s. Le programme était intense, et je peux dire sans rougir que nous avions un bon niveau d’enseignement, quasi académique. Une fois la formation terminée, nous réalisions un film. Les ateliers étaient des lieux d’apprentissage à la fois théorique et pratique. Ils s’adressaient à tout le monde : aux enseignant-e-s, aux étudiant-e-s, aux ouvrier-e-s… Notre contingent étant limité à une vingtaine de participant-e-s, nous faisions une sélection parmi les candidat-e-s sur entretien. Pour nous, l’essentiel était la véritable motivation du candidat : cinéma commercial ou cinéma indépendant ? Nous étions à la recherche de profils atypiques, capables de développer le cinéma alternatif. Les participant-e-s venaient proposer leurs scénarios et nous organisions collectivement le tournage. Les films comme Qapsûl [Kapsül] ou Xal û Xwarze [Dayı ve Yeğen] ont été réalisés dans le cadre des ateliers. Ce sont les fruits d’un travail collectif. Je dois admettre que l’identité du groupe attirait mécaniquement des personnes intéressées par l’idée de produire du « cinéma kurde », mais nous ne cherchions pas forcément ce type de profils. La plupart était proche du mouvement kurde, mais il y avait parmi nous des personnes de sensibilités politiques différentes. Nous n’avons jamais véritablement eu de désaccords politiques au sein du collectif, tout le monde avait à peu près le même point de vue. Le film Ax [Toprak], tourné en 1999, est un exemple de travail collectif. J’étais réalisateur, mais nous étions cinq ou six personnes à écrire le scénario et le tournage est le résultat d’un travail d’équipe.
KÖ- Cette question est revenue constamment dans nos débats. Certain-e-s voulaient que l’on ne vise que les festivals. D’autres disaient qu’il fallait essentiellement s’adresser aux Turcs. D’autres enfin voulaient faire des films qui s’adresseraient principalement aux ouvriers. La question kurde était le thème qui emportait la plus large adhésion. De quoi s’agit-il quand on parle de « problème kurde » ? Nous avions à cœur de parler de cette tragédie. En dépit des divergences d’opinions, nous avons décidé de faire en sorte que notre propos s’adresse au public le plus large possible. Nous n’avons donc pas, pour ainsi dire, de public privilégié. Ce n’est pas aux Kurdes que nous devions raconter la question kurde. Quant à la question de la langue, ce n’était pas non plus un critère mais, dans la mesure du possible, nous avons essayé de tourner dans la langue maternelle des acteurs.
CPM- De l’écriture du scénario à la distribution, une équipe spécialisée travaille habituellement à chaque étape de la production d’un film. C’est un travail considérable, d’autant plus lourd pour une équipe réduite comme celle de Yapim13. Le cinéma alternatif n’est pourtant pas, à ma connaissance, très lucratif. Comment avez-vous réussi à financer le tournage de vos films ?
KÖ– Nous répartissions les tâches de travail au sein de l’équipe. Chacun-e se spécialisait dans deux domaines et pouvait ainsi suivre la production du film à différentes étapes. J’ai pu parfois me retrouver réalisateur sur un film, et monteur ou producteur sur un autre. C’est ainsi que fonctionnait le collectif. Mais ce qui nous a le plus posé problème, c’est la perte d’énergie. La réalisation d’un film pouvait nous prendre jusqu’à deux ans. Une fois terminée, nous ne pouvions pas vraiment nous concentrer sur un nouveau projet car il fallait encore s’occuper de la promotion. C’est d’ailleurs le principal handicap du cinéma alternatif. Nous avons fait « avec les moyens du bord » car nous n’avons pu trouver que très rarement des soutiens financiers. Nous avons parfois financé les films grâce aux recettes d’un concert. Nous nous mettions d’accord avec des groupes de musique pour qu’ils nous reversent l’argent des billets d’entrée. Nous vendions aussi des places de cinéma pour nos films. Nous avons même organisé une croisière en bateau pour le film Demsala dawi: Şewaxan [Son Mevsim: Şavaklar]. Certains films ont pu être financés grâce aux récompenses gagnées dans divers festivals pour la production précédente. Quand Bir varmış, bir yokmuş a gagné le prix du meilleur documentaire au festival de Montréal, au Canada, nous avons tout de suite investi l’argent récolté dans le film suivant. La créativité était notre seule chance de survie. Nous avons produit une quarantaine de films, mais nous aurions pu en tourner beaucoup plus. Nous aurions pu faire encore deux ou trois long métrages après Bahoz [Fırtına] mais nous avons connu une période de grosse difficulté financière. De nombreuses projections du film ont été interdites, le film a été refusé par des festivals, nous n’avons donc pas eu de retour sur investissement alors que nous avions investi pas mal d’argent.
CPM- Vos films et ceux du collecitf ne sont pas faciles à trouver sur Internet. Où peut-on les voir ?
KÖ- Nos films ne sont pas en vente sur le marché. Sur Internet, vous pouvez en trouver quelques-uns. Nous avons aussi fait un coffret de DVD qui rassemble 25 de nos productions, que l’on offrait ou envoyait pour présenter notre travail. Nous n’avons pas mis systématiquement nos films en ligne, et je dois avouer que c’était l’une une de nos faiblesses. Quant aux projections en salle, Ax [Toprak 1999] a été présenté dans près de 50-60 festivals à travers le monde mais il a été interdit en Turquie. Nous avons organisé des projections spéciales. C’était une période où, au sein du collectif, nous avons beaucoup débattu de la question de la diffusion car nous ne parvenions pas à distribuer librement nos films. Nous avons eu besoin de mobiliser une équipe qui se consacre uniquement à la diffusion. Dans les endroits dépourvus de salle de cinéma, nous montions nous-mêmes un lieu de projection avec un projecteur, un système son et quelques chaises pour pouvoir projeter nos films au public. C’est comme cela que nous avons réussi à montrer Bahoz [Fırtına]. Nous sommes allés démarcher de nombreuses salles, mais nous n’avons quasiment pas trouvé de cinéma qui accepte le film, même pas à Beyoğlu. Ce sont des salles indépendantes, comme le cinéma Yeşilçam, qui acceptaient en général. Le film y est resté 14 semaines à l’affiche, mais malgré le succès, nous n’avons pas trouvé de salle plus grande pour le projeter. Nous avons malheureusement perdu beaucoup de spectateurs de cette façon. D’autres salles de cinéma ont accepté, des cinémas en banlieue d’Istanbul par exemple, pendant une ou deux semaines. Nous faisions un cinéma politique et c’est un handicap. Je reçois toujours des messages de gens qui voient Bahoz [Fırtına] seulement aujourd’hui alors qu’il est sorti il y a déjà 6 ans.
CPM- Dans quelle mesure la sortie de vos films est-elle relayée par les médias ?
KÖ– Les médias mainstream ne nous invitent pas. Les invitations viennent généralement des médias alternatifs. Des articles paraissent dans certains journaux comme Özgür Gündem, Evrensel, Birgün ou Radikal. Ce sont essentiellement ceux qui s’intéressent à la politique kurde mais ils ne manquent pas d’aborder le contenu du film. Ils sont en général conscients des enjeux du propos, mais ils se contentent de discours convenus pour ne pas créer de polémique. Ils appliquent une forme d’autocensure en quelque sorte. Pour ce qui est de la télévision, c’est encore autre chose. Ils ne font pas d’analyse, les entretiens sont pontués de « phrases choc » et tu n’as pas vraiment l’occasion de t’exprimer. C’est uniquement dans des revues spécialisées comme Altyazı, Yeni sinema ou Entract que l’on peut trouver des critiques approfondies. Ces revues sont vraiment bien de ce point de vue-là. Jusqu’à présent, voilà comment cela s’est déroulé… nous verrons ce que l’avenir nous réserve.
CPM– Quelles sont les réactions des spectateurs ? Quels sont généralement les éléments de vos films qui plaisent le plus d’après vous ?
KÖ– Lors de la projection de Bir varmış bir yokmuş à Ankara, les réactions étaient très positives. Les dialogues ont surpris par exemple. D’après les spectateurs, c’est la sincérité du film qui les avait le plus touchés. Les gens étaient émus. Une des personnes représentant la délégation européenne m’a demandé comment j’avais pu obtenir la confiance des habitant-e-s pour qu’ils acceptent de me laisser entrer chez eux. Ce sont des questions de cet ordre qui reviennent fréquemment, cela me plaît bien. De tous les films que nous avons tournés, c’est sans doute Bahoz [Fırtına] qui a fait le plus réagir, autant chez les Kurdes que chez les Turcs. Le film a révélé le problème kurde à celles et ceux qui ne connaissaient pas la question. Je crois qu’il a provoqué un étonnement, une émotion de la rencontre : ils se sont dit « Ah, ce sont donc ces gens-là qui habitent dans l’Est ? ». En général, dans le cinéma alternatif en Turquie, les personnages révolutionnaires sont des anti-héros. Dans Bahoz, au contraire, les caractères sont plein de vie, ils luttent et ne se laissent pas abattre.
KÖ– Il existe effectivement des formes de pression. Si je n’ai pas eu trop de problèmes jusqu’à présent, c’est parce que j’ai pris des précautions. Nous avons réfléchi au comportement à adopter pour éviter les ennuis. Pour Ax [Toprak], le tournage s’est déroulé de manière tout à fait illégale. Étant donné le sujet, il me paraissait évident que je n’obtiendrai pas l’autorisation pour tourner le film. J’ai eu un procès pour ce film. Ils ont trouvé mon nom dans le carnet d’un des membres de la contre-guérilla, le meurtrier de Musa Anter , qui a avoué son crime avant de fuir à l’étranger. La police s’est saisie de ses affaires personnelles, et il y avait visiblement une liste de noms, dont le mien, quelque part dans ses notes. Je ne sais pas pourquoi, il a peut-être vu un de nos films… Nous avons aussi connu des périodes de garde à vue. En ce qui concerne les projections, il s’agit plutôt d’une sérieuse autocensure des salles de cinéma elles-mêmes. Les directions pensent que ces films sont dangereux et prennent peur. Bahoz est resté une semaine sur les écrans avant d’être retiré, même dans les salles les plus avant-gardistes d’Istanbul. Nous avons souvent vécu le même problème dans d’autres villes : à Malatya, à Van ou Mersin, le film a été retiré dès la deuxième semaine. Les directions précisent souvent qu’elles reçoivent des menaces, mais je n’en suis pas si sûr. À Adana, par exemple, un des membres du comité de sélection m’a dit que le film avait bel et bien été sélectionné mais qu’il avait été retiré par la suite. Il y a visiblement des choses qui se passent en coulisse. Le film a été projeté sans problème à Diyarbakır en revanche, et c’est là-bas qu’il a fait le plus d’entrées. Quand nous l’avons envoyé dans les différents festivals en Turquie, les jurys ont dit qu’ils ne l’avaient pas aimé, mais je n’en suis pas convaincu. C’est un film qui aurait mérité d’être accepté dans au moins un festival.
CPM– À la différence des festivals en Turquie où il est parfois difficile de faire projeter un film à caractère politique, les festivals à l’étranger semblent jouer un rôle « stratégique », si je puis dire. Le contexte dissipe les crispations idéologiques et il est alors plus facile de montrer son film. Lorsque vous gagnez un prix, votre légimité s’en trouve en quelque sorte renforcée. Cela a-t-il des conséquences sur les retombées du film en Turquie ? Cela facilite-t-il sa diffusion ?
KÖ- Fotoğraf a été présenté à Cannes par exemple. Ax [Toprak] et Dur [Uzak] ont été montrés dans de nombreux festivals en Europe, comme au festival du film de Méditerranée à Paris mais aussi en Italie. Mes films ont plus souvent été projetés à l’étranger qu’en Turquie. Quand ils rencontrent un certain succès à l’étranger, la réception en Turquie s’en trouve facilitée. Bir varmış bir yokmuş a obtenu un prix au Canada et un prix à Paris. Il a été projeté à Istanbul, mais le niveau de tolérance varie considérablement d’un festival à l’autre en Turquie. Certains sont sur des lignes nationalistes, de droite [milliyetçi] comme de gauche [ulusalcı]. Le festival du film d’Istanbul est l’un des meilleurs festivals de ce point de vue, l’un des plus démocrates, et l’équipe est très professionnelle. Elle maintient les films à l’affiche même si elle reçoit des menaces. Le fait d’être à Istanbul aide également, la ville est relativement plus ouverte.
CPM- En 2015, la question de la censure est revenue à l’ordre du jour. Les films qui s’opposent à la ligne politique du pouvoir font l’objet de pressions, comme cela a été le cas pour le film Bakur, qui a été censuré lors du festival du film d’Istanbul organisé par İKSV. Toute une série de manifestations ont d’ailleurs été organisées pour protester contre la décision de retrait du film. Peut-on dire que cette mobilisation a marqué une étape dans l’histoire de la censure en Turquie ?
KÖ– Tout à fait. Ils ont prétexté l’absence d’autorisation de tournage pour interdire la projection du film. Le festival İKSV établit généralement sa programmation librement. L’ingérence du pouvoir dans ce type de festival est révélateur de mutations politiques plus globales, notamment avec l’arrivée de l’AKP au sommet de l’État. Nous vivons une nouvelle étape de l’histoire de la Turquie, où l’ensemble de l’appareil d’État leur est désormais acquis. La censure de film comme celle de Bakur n’est que le résultat de ce processus. La mobilisation organisée pour protester contre cette interdiction a permis de mettre en évidence les tactiques déployées par le pouvoir afin d’utiliser l’appareil d’État à son profit. Mon film Beyaz Çınar était programmé , mais je l’ai retiré du festival pour manifester mon désaccord, à l’instar des autres réalisateurs. La mobilisation pour Bakur s’est progressivement transformée en une protestation plus générale qui a entravé le bon déroulement du festival. Cela faisait longtemps qu’un cas de censure n’avait pas mobilisé autant de personnes dans le monde de l’art.
CPM- On parle beaucoup de la censure dans le contexte médiatique. C’était particulièrement le cas pendant la période pré-électorale cette année. Avez-vous ressenti davantage de pressions ces derniers temps ? Pourquoi la majorité des artistes reste-t-elle silencieuse face à ce phénomène ?
KÖ– Oui, je pense effectivement que le monde de l’art subi des pressions identiques à celles subies par les médias. Cette année, le festival du film d’Antalya a été, si je puis dire, saboté. Les films documentaires ont tous été déprogrammés. La plupart des prix qui soutenaient les productions nationales ont été annulés. Ce n’est pas de bon augure pour le cinéma de Turquie. Mais quand on parle de censure dans le monde artistique, il est nécessaire de préciser car il existe plusieurs types de censure. Les mécanismes de la censure sont moins visibles et plus profonds. La plupart des films qui sont produits en Turquie ne sont jamais projetés alors qu’il y a toujours des films américains à l’affiche. On justifie souvent ces choix par l’argument commercial, mais le refus de montrer ce type de films est une forme de censure indirecte. En Turquie, on peut parler de « censure normalisée ». Si l’on tourne près de 100 films chaque année et que plus de la moitié d’entre eux n’est jamais présentée au public, alors on peut parler sérieusement de censure. Bien que le choix de « ne pas montrer » se relève pas d’une ingérence directe, c’est aussi une forme de censure. D’autre part, je ne pense pas que les artistes soient plus silencieux que les journalistes. Sur quoi se base-t-on quand on affirme cela ? La presse est particulièrement sous pression en ce moment, mais y a-t-il pour autant une mobilisation massive des journalistes et des écrivain-e-s à laquelle les artistes auraient manqué de se joindre ? Il me semble que les artistes sont au contraire plus sensibles à ces questions-là dans l’ensemble. Si je devais qualifier ce que l’on observe, je dirais plutôt qu’il s’agit d’un silence généralisé.
Pour le public intéressé par le cinéma kurde :