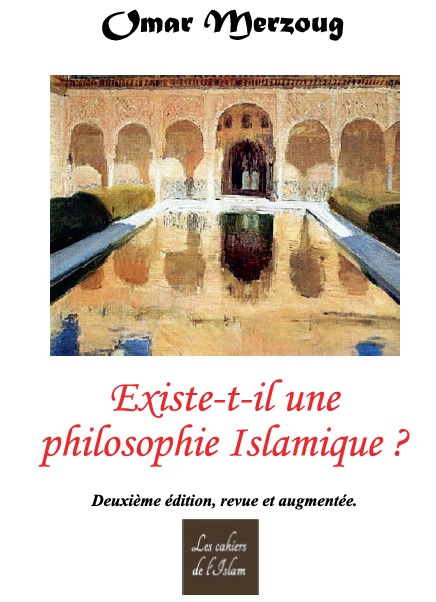Sylvia Chiffoleau, Le voyage à La Mecque. Un pèlerinage mondial en terre d'Islam, Paris, Belin, coll. « Histoire », 2015, 370 p., ISBN : 978-2-7011-9367-0.
Publication en partenariat avec open edition.org
Compte rendu par Florian Besson
Historienne française, chercheuse au CNRS, Sylvia Chiffoleau propose ici une longue étude sur le pèlerinage à La Mecque, l’un des cinq piliers de l’islam et, en tant que tel, l’occasion d’un des plus grands rassemblements humains. Revenant chaque année, codifié dans le temps comme dans l’espace, le hajj lance des dizaines de milliers de musulmans sur les routes. Précisons d’emblée que, malgré ce que le titre pourrait laisser penser, l’ouvrage ne prétend pas retracer l’histoire du pèlerinage à travers les âges : le premier chapitre se contente de retracer brièvement son évolution, du Prophète à nos jours. L’auteur en vient ensuite à ce qui l’intéresse vraiment : la place du pèlerinage dans les empires coloniaux du XIXe et du XXe siècles. Car à cette époque, la majorité des musulmans du monde sont des sujets des grands empires coloniaux, français, hollandais, russe et surtout britannique. Dès lors, le pèlerinage à La Mecque s’impose comme une préoccupation de ces empires. C’est ce que Sylvia Chiffoleau entreprend d’analyser ici, au fil de six chapitres thématiques. Comme elle le justifie dans son introduction, la focale est double. L’auteur se concentre d’abord sur l’aspect collectif, s’intéressant plus à la question du contrôle des foules qu’aux parcours individuels des pèlerins. On trouvera cependant, au fil du texte, de très bonnes pages sur les conditions concrètes du pèlerinage, dans lesquelles l’auteur s’attache à faire revivre des ambiances, des paysages sonores, des conditions de vie. L’attention constante aux différents moyens de transport – des grandes caravanes traversant le désert aux avions contemporains, en passant par la voiture, que Ibn Saoud, nouveau souverain du royaume du Hedjaz (1), impose dans les années 1930 au risque de vexer les puissantes tribus de Bédouins qui contrôlent le désert –, permet de mettre en évidence les évolutions d’un pèlerinage pris dans une modernisation accélérée. La deuxième focale qui guide l’enquête consiste à s’intéresser au pèlerinage comme fait social, politique et économique, en mettant un peu de côté sa dimension spirituelle et culturelle – autrement dit, comme le note l’auteur, de laisser en arrière-plan « le murmure des prières » (p. 16) pour se concentrer sur les bruits des hommes.
Trois points ressortent clairement de cette étude. Le pèlerinage est d’abord l’objet d’un contrôle administratif : les empires coloniaux tentent de mettre en place des filtres, de restreindre le nombre de pèlerins qui peuvent partir. Tickets de bateau, passeports, autorisations écrites, tampons à obtenir aux différentes escales, voire dans certains cas examen final sanctionnant la réalité du pèlerinage : ce que l’auteur appelle « l’ordre colonial » s’empare du pèlerinage pour le faire passer dans sa machine administrative. Pour les colons, l’enjeu recoupe la mission civilisatrice : face à un pèlerinage pensé comme archaïque – d’autant plus que la région du Hedjaz reste longtemps inaccessible aux non-musulmans – et donc mystérieux, il s’agit d’apporter la rationalité de la civilisation. Le long du chemin, des consuls, des fonctionnaires, des agents de renseignement sont sans cesse mobilisés pour assurer la sécurité des pèlerins, mais aussi pour réaffirmer, par leur présence et leurs actions, la puissance et l’autorité des empires coloniaux.
C’est que le pèlerinage est aussi un enjeu politique à part entière : il est extrêmement légitimant, à la fois pour le pèlerin, qui revient couronné du titre glorieux de hajji, et pour les puissances qui l’encadrent et le permettent. Depuis le Moyen Âge jusqu’aux années 1920, l’Égypte et Damas envoient chaque année un somptueux pavillon, le mahmal, qui symbolise le sultan (donc, pendant toute la période contemporaine, le sultan ottoman), lequel s’enorgueillit du titre de « serviteur des deux sanctuaires » (La Mecque et Médine). Avec la disparition de l’empire ottoman après la première guerre mondiale, il revient au nouveau royaume du Hedjaz, bientôt sous la tutelle d’Ibn Saoud, de s’occuper de l'organisation du pèlerinage : ce sont des dizaines de milliers de musulmans, venus du monde entier, qu'il va falloir loger, nourrir, soigner. Les enjeux économiques sont également brûlants à cette époque, et l’auteur sait ressusciter un temps où la principale ressource de l’Arabie Saoudite était le pèlerinage et pas le pétrole. Mais les empires coloniaux sont eux aussi prompts à comprendre que le pèlerinage peut être légitimant pour eux aussi : protéger les pèlerins, voire organiser des pèlerinages officiels en s’occupant des moindres détails, c’est souvent gagner le soutien des musulmans. Au point que, face à une épidémie de peste, les Anglais refusent d’interdire le pèlerinage, par peur d’une révolte des musulmans indiens. Comme l’écrit le journal L’Illustration en 1843, s’occuper de l’organisation du pèlerinage sera le moyen de « retirer de grands avantages pour l’influence morale de notre domination » (cité p. 116). Les pèlerinages officiels s’imposent alors comme des « armes de propagande » (p. 257)... mais les musulmans ne sont pas dupes, préférant souvent partir par leurs propres moyens, voire défier l’autorité coloniale en refusant de se plier à ses modalités. Car le pèlerinage n’est pas univoque : il est aussi perçu par les colons comme un danger. On craint, notamment, une contagion nationaliste, surtout à partir du moment où la route du pèlerinage traverse des pays musulmans indépendants. Il y a là une part de fantasme car, comme le souligne l’auteur, les pèlerins, engagés dans une quête spirituelle, souvent pauvres ou modestes, isolés dans leurs communautés linguistiques, ne nouent que rarement des relations politiques. Mais il est vrai que, comme Sylvia Chiffoleau l’analyse dans son dernier chapitre, le pèlerinage occupe une place centrale dans la construction d’une communauté musulmane, l’Oumma, et donc dans la montée tant du panarabisme que des différents nationalismes.
D’où le troisième aspect : les puissances qui organisent le pèlerinage craignent surtout une véritable contagion. Le pèlerinage s’impose d’emblée au cœur des préoccupations sanitaires : les épidémies de peste, et surtout de choléra, prélèvent un lourd tribut sur les pèlerins et font peur aux empires coloniaux. Ceux-ci mettent alors en place un ensemble de mesures préventives (vaccinations obligatoires, visite médicale sur les navires transportant les pèlerins...) qui culminent dans la mise en place de lazarets, où les pèlerins suspects subissent de longues quarantaines. Se met alors en place, au fil de grandes conférences, une politique sanitaire internationale (2) qui participe énormément de la construction d’un « ordre international » (p. 153) qui est toujours le nôtre aujourd’hui. L’auteur peut ainsi affirmer que « le voyage à La Mecque a pleinement participé à la première mondialisation » (p. 15).
On peut émettre quelques critiques, mais celles-ci sont vraiment mineures. Le plan de l’ouvrage, organisé en chapitres thématiques centrés sur un point précis, qui culmine dans une réflexion très fine sur les liens entre pèlerinage, califat et communauté musulmane, en rend la lecture très aisée. Mais ce découpage conduit aussi, forcément, à plusieurs répétitions, notamment dans les exemples. Les transitions entre les différents chapitres sont aussi, à notre sens, assez abruptes, et auraient gagné à être davantage travaillées. On peut aussi regretter l’absence d’une véritable bibliographie. Le premier chapitre, sur l’histoire du pèlerinage, est assez court et assez frustrant, vu l’ampleur de la période couverte en quelques pages : on aurait aimé en lire plus, mais cela aurait amené l’auteur trop loin de son sujet. Par contre, l’ouvrage aurait pu davantage se concentrer sur les fonctionnaires coloniaux qui sont au cœur du contrôle du pèlerinage : si on peut lire avec plaisir quelques exemples détaillés, comme celui de Thérèse Bartas, épouse d’un médecin employée au lazaret de Tor à la veille de la première guerre mondiale (p. 191-192), on ne trouve pas de véritable étude sur ces agents du pouvoir impérial. Qui sont les médecins qui contrôlent l’état de santé des pèlerins, les consuls qui gèrent les flux de personnes, les capitaines de navire qui s’enrichissent en transportant des pèlerins ? En passant un peu rapidement, selon nous, sur ces personnes, l’auteur livre un récit souvent un trop dépersonnalisé.
Ces critiques, redisons-le, sont tout à fait mineures. L’ouvrage nous semble de toute première qualité, tant par la forme que par le fond. L’un de ses grands mérites est de rendre compte de l’actualité du pèlerinage, pris entre la révolution des transports et la décolonisation, touchant autant aux relations internationales qu’à la géopolitique. Les pages consacrées aux épidémies et à leur contrôle résonnent même d’une surprenante actualité, quand on les lit en pensant à l’épidémie récente d’Ebola et aux craintes de contagion qui s’étaient exprimées à ce moment-là. Enfin, le ton neutre adopté par l’auteur, et maintenu tout au long du livre, tout comme l’attention portée autant aux politiques impériales qu’aux capacités de résistance et de détournement des croyants, sont très bienvenus à un moment où de nombreux livres sur l’Islam ont du mal à ne pas verser dans le débat idéologique. Rien de tel ici, mais une vraie enquête historique, autour d’un pèlerinage finement construit comme objet d’étude.
1 Ibd Saoud a renommé le Hedjaz en lui donnant son propre nom : l’Arabie Saoudite.
2 À noter que Sylvia Chiffoleau rejoint ici ses précédents travaux, portant sur la mise en place d’une politique de santé publique à l’échelle du monde : voir Sylvia Chiffoleau, Genèse de la santé publique internationale. De la peste d’Orient à l’OMS, Paris, 2012.