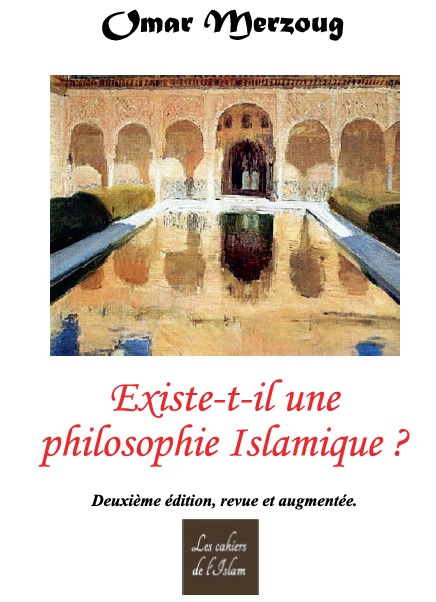Pour tenter de poser avec plus de clarté le problème des rapports entre la foi et la raison, dans le cas de la civilisation musulmane classique, cet article étudie un livre d'apologétique écrit à la fin du IVe/IXe siècle par al-ʻĀmirī. L'intérêt de ce texte est qu'il est écrit par un disciple des philosophes grecs, et dans un milieu où les non-musulmans sont nombreux ; on peut dès lors penser que les arguments qui sont donnés dans cet ouvrage pour défendre l'Islam seront des arguments rationnels. En fait, les arguments sont tantôt rationnels et tantôt dogmatiques, sans que l'auteur du livre semble percevoir la différence. L'étude des textes amène alors à conclure qu'il y a une véritable identification entre le domaine de la foi et celui de la raison, en ce sens que la foi musulmane est en accord total avec une raison islamisée et réduite aux dimensions de cette foi.

Le problème des rapports entre philosophie et théologie, ou plus généralement entre la raison et la foi qui sont à la source de ces deux disciplines, est un problème difficile à poser dans toute sa clarté, dès que l'on sort des perspectives du monde moderne, ou plus précisément du monde occidental moderne. Dans le cas de la civilisation musulmane classique, les textes qui parlent explicitement de ce problème sont assez nombreux, mais souvent difficiles à interpréter, car il faudrait savoir à l'avance ce que leurs auteurs entendent par foi et par raison, ou par religion et philosophie.
Pour tenter d'y voir plus clair, nous avons cherché un texte qui, sans traiter explicitement des rapports entre la foi et la raison, mettrait en oeuvre ces deux instances de telle sorte que l'analyse puisse en faire apparaître les rapports. Notre choix s'est finalement arrêté sur un traité récemment édité au Caire par Ahmad ‘Abd al-Ḥamīd Ġurāb, le Kitāb al-i‘lām bi manāqib al-islām de Muḥammad ibn Yūsuf ʻĀmirī (m. 381/996). Je ne reprendrai pas ici toute l'étude historique faite par M. Ġurāb en introduction à l'édition de son texte (op. cit., pp. 5-63), il suffît d'y renvoyer. Je retiendrai seulement deux points qui me paraissent importants pour la compréhension de l'ouvrage. Le premier c'est que ʻĀmirī, à peu près contemporain de Bāqillānī, vécut principalement dans les provinces de l'est de l'Empire musulman, séjournant à Ray, à Nīsābur, et surtout dans la capitale des Samanides à Buẖārā. C'est même vraisemblablement dans cette dernière ville que notre auteur composa son K. al-i‘lām, puisqu'il est dédié à un certain Abū Nasr qui pourrait être le vizir Abū Nasr b. Abī Zaid (cf. Ġurāb, p. 13 et p. 74). Or, comme nous l'avons déjà montré à propos d'une brève étude sur le Kitāb al-Tauḥīd de Māturīdī [1] la situation prééminente de l'Islam était plus discutée en Transoxiane que dans les provinces centrales du califat. Faisant la liste des adversaires auxquels répond Māturīdī nous avions énuméré : « Les philosophes qui croient à l'éternité de la matière ; les manichéens qui croient en une création qui serait le résultat de mélanges entre divers éléments ; les matérialistes (dahrīya) qui tiennent la même doctrine que les philosophes ; les dualistes ; les zindīq ; les partisans de l'influence, sur la naissance du monde, des astres ou de la nature des choses... Les athées, les sophistes et enfin les Sabéens » [2]. Sans être sûr que tous ces groupes aient vraiment existé en Transoxiane au IVe/Xe siècle, on peut cependant conclure à l'existence d'une contestation de l'Islam qui, dans cette province, lui serait venue de l'extérieur.
Le deuxième point à relever dans les indications bio-bibliographiques rassemblées par M. Ġurāb, c'est le fait que ʻĀmirī peut être rangé parmi les falāsifa. En effet, dans la liste que lui-même nous donne au début de son Kitāb al-amad ‘alā l-abad, il signale déjà qu'il a composé un Šarḥ al-uṣul al-manṭiqīya et des Tafāṣīr al-muṣannafāt al-ṭabīʻīya. Par ailleurs, M. Ġurāb a pu, à travers les manuscrits de certains traités de ʻĀmirī, trouver aussi les titres d'autres traités : Šarḥ Kitāb al-Burhān li Arisṭāṭālīs, Šarḥ Kitāb al-nafs Arisṭāṭālīs, al-Sa'āda wa l-is'ād fī al-sīra al-insānīya, ce dernier livre étant un traité de morale individuelle et sociopolitique dont l'inspiration grecque ne fait pas de doute : dès le début, des citations de Platon, de Porphyre et surtout d'Aristote servent d'introduction aux développements qui les commentent [3]. M. le Pr Badawī, auquel nous sommes redevables de si nombreuses éditions de textes, a eu l'obligeance de me signaler qu'il avait lui-même édité un traité de ʻĀmirī sur Jean Philoppon. Au même titre que les autres falāsifa,ʻĀmirī a donc pris les philosophes grecs comme ses maîtres à penser, étudiant et commentant leurs ouvrages de logique, de psychologie, de morale et de physique.
Pour tenter d'y voir plus clair, nous avons cherché un texte qui, sans traiter explicitement des rapports entre la foi et la raison, mettrait en oeuvre ces deux instances de telle sorte que l'analyse puisse en faire apparaître les rapports. Notre choix s'est finalement arrêté sur un traité récemment édité au Caire par Ahmad ‘Abd al-Ḥamīd Ġurāb, le Kitāb al-i‘lām bi manāqib al-islām de Muḥammad ibn Yūsuf ʻĀmirī (m. 381/996). Je ne reprendrai pas ici toute l'étude historique faite par M. Ġurāb en introduction à l'édition de son texte (op. cit., pp. 5-63), il suffît d'y renvoyer. Je retiendrai seulement deux points qui me paraissent importants pour la compréhension de l'ouvrage. Le premier c'est que ʻĀmirī, à peu près contemporain de Bāqillānī, vécut principalement dans les provinces de l'est de l'Empire musulman, séjournant à Ray, à Nīsābur, et surtout dans la capitale des Samanides à Buẖārā. C'est même vraisemblablement dans cette dernière ville que notre auteur composa son K. al-i‘lām, puisqu'il est dédié à un certain Abū Nasr qui pourrait être le vizir Abū Nasr b. Abī Zaid (cf. Ġurāb, p. 13 et p. 74). Or, comme nous l'avons déjà montré à propos d'une brève étude sur le Kitāb al-Tauḥīd de Māturīdī [1] la situation prééminente de l'Islam était plus discutée en Transoxiane que dans les provinces centrales du califat. Faisant la liste des adversaires auxquels répond Māturīdī nous avions énuméré : « Les philosophes qui croient à l'éternité de la matière ; les manichéens qui croient en une création qui serait le résultat de mélanges entre divers éléments ; les matérialistes (dahrīya) qui tiennent la même doctrine que les philosophes ; les dualistes ; les zindīq ; les partisans de l'influence, sur la naissance du monde, des astres ou de la nature des choses... Les athées, les sophistes et enfin les Sabéens » [2]. Sans être sûr que tous ces groupes aient vraiment existé en Transoxiane au IVe/Xe siècle, on peut cependant conclure à l'existence d'une contestation de l'Islam qui, dans cette province, lui serait venue de l'extérieur.
Le deuxième point à relever dans les indications bio-bibliographiques rassemblées par M. Ġurāb, c'est le fait que ʻĀmirī peut être rangé parmi les falāsifa. En effet, dans la liste que lui-même nous donne au début de son Kitāb al-amad ‘alā l-abad, il signale déjà qu'il a composé un Šarḥ al-uṣul al-manṭiqīya et des Tafāṣīr al-muṣannafāt al-ṭabīʻīya. Par ailleurs, M. Ġurāb a pu, à travers les manuscrits de certains traités de ʻĀmirī, trouver aussi les titres d'autres traités : Šarḥ Kitāb al-Burhān li Arisṭāṭālīs, Šarḥ Kitāb al-nafs Arisṭāṭālīs, al-Sa'āda wa l-is'ād fī al-sīra al-insānīya, ce dernier livre étant un traité de morale individuelle et sociopolitique dont l'inspiration grecque ne fait pas de doute : dès le début, des citations de Platon, de Porphyre et surtout d'Aristote servent d'introduction aux développements qui les commentent [3]. M. le Pr Badawī, auquel nous sommes redevables de si nombreuses éditions de textes, a eu l'obligeance de me signaler qu'il avait lui-même édité un traité de ʻĀmirī sur Jean Philoppon. Au même titre que les autres falāsifa,ʻĀmirī a donc pris les philosophes grecs comme ses maîtres à penser, étudiant et commentant leurs ouvrages de logique, de psychologie, de morale et de physique.
A partir de ces deux indications, ʻĀmirī apparaît donc comme un philosophe qui vit dans une société où le pluralisme religieux est sans doute plus réel qu'ailleurs. Or le livre qui nous est parvenu sous son nom, ce traité qu'il a intitulé al-i‘lām bi manāqib al-islām est de toute évidence une apologie de l'Islam, c'est-à-dire un ouvrage qui ressortit au domaine du Kalām. Par le fait même, l'étude de ce traité apparaît au premier abord comme devant donner, sur la question des rapports entre philosophie et théologie, d'importants éléments de réponse. On peut en effet supposer qu'un disciple déclaré des philosophes grecs, devant présenter des arguments en faveur de l'Islam à une société en partie non musulmane, fera de la théologie à sa façon et explicitera mieux que d'autres le rôle de la raison, en kalām comme en falsafa.
Si, au cours d'une première lecture du Kitāb al-i‘lām, on rassemble tous les arguments présentés par les adversaires de l'Islam, cette première supposition semble se confirmer. En effet, les objections formulées sont assez radicales pour mettre en cause les fondements mêmes de la religion musulmane. Voici d'abord le discours tenu par ceux que 'Āmirī appelle de prétendus intellectuels (al-mutaẓarrifa) : « Ils ont prétendu que, dans aucune religion, il n'y avait de science dont la raison imposât qu'on l'adopte et qu'on s'y tienne. Ces religions ne contiennent en réalité que des cas juridiques et des situations conventionnelles, où chacune d'entre elles puise la part qui lui permet de subvenir à ses besoins matériels et d'écarter les occasions de dilapider ses biens. Si ces religions étaient vraies, elles n'auraient nul besoin de faire appel à ce qui est fixé par révélation (tauqīf) et s'attacheraient à ce qui est rationnel ; et si les religions s'en tenaient là, elles ne seraient divisées ni en sectes multiples ni en partis divers. Ils ont dit aussi que la soumission de l'āme sur les points que la raison n'impose pas est une occupation inutile et sans profit. Par conséquent, celui qui prend conseil de sa raison n'a rien de mieux à faire que de se décider pour ce sur quoi toutes les sectes sont d'accord : la justice, la franchise, la fidélité à tenir parole et à remettre ce qui a été confié, la défense du faible, la consolation de l'affligé. Qu'il fasse de cela sa voie et que tout le reste, sur quoi les communautés se disputent et les opinions entrent en lutte, il le laisse » [4].
Si, au cours d'une première lecture du Kitāb al-i‘lām, on rassemble tous les arguments présentés par les adversaires de l'Islam, cette première supposition semble se confirmer. En effet, les objections formulées sont assez radicales pour mettre en cause les fondements mêmes de la religion musulmane. Voici d'abord le discours tenu par ceux que 'Āmirī appelle de prétendus intellectuels (al-mutaẓarrifa) : « Ils ont prétendu que, dans aucune religion, il n'y avait de science dont la raison imposât qu'on l'adopte et qu'on s'y tienne. Ces religions ne contiennent en réalité que des cas juridiques et des situations conventionnelles, où chacune d'entre elles puise la part qui lui permet de subvenir à ses besoins matériels et d'écarter les occasions de dilapider ses biens. Si ces religions étaient vraies, elles n'auraient nul besoin de faire appel à ce qui est fixé par révélation (tauqīf) et s'attacheraient à ce qui est rationnel ; et si les religions s'en tenaient là, elles ne seraient divisées ni en sectes multiples ni en partis divers. Ils ont dit aussi que la soumission de l'āme sur les points que la raison n'impose pas est une occupation inutile et sans profit. Par conséquent, celui qui prend conseil de sa raison n'a rien de mieux à faire que de se décider pour ce sur quoi toutes les sectes sont d'accord : la justice, la franchise, la fidélité à tenir parole et à remettre ce qui a été confié, la défense du faible, la consolation de l'affligé. Qu'il fasse de cela sa voie et que tout le reste, sur quoi les communautés se disputent et les opinions entrent en lutte, il le laisse » [4].
Plus loin, des attaques anonymes contre l'Islam sont rassemblées sous la forme de quatre arguments :
1. « Si l'Islam était la religion de la vérité, il serait la religion de la miséricorde ; et s'il était la religion de la miséricorde, celui qui prêche l'Islam n'approcherait pas des hommes avec l'épée, ne traiterait pas leurs biens en les mettant au pillage et ne volerait pas leurs enfants pour les emmener en exil. Ce prédicateur appellerait à l'Islam par ses discours, il y conduirait par la force de sa démonstration et se passerait de ces actions qui ressemblent à celles de qui recherche le bien des autres et s'empare des possessions du voisin. »
2. « Comment pouvons-nous penser que l'Islam est, auprès de Dieu, la vraie religion, étant donné ce dont nous sommes témoins ? Les musulmans, en effet, manifestent entre eux de la haine et de l'inimitié, ils divergent dans leurs opinions [5] et se divisent sur la manière de les exprimer. Dans ce domaine, ils sont allés jusqu'à s'entre-tuer, et se mettre à sacrifier les enfants de leurs ennemis, sans compter le dommage qu'ils subissent eux-mêmes en manifestant de la haine à propos des divergences de croyance, si bien que chaque secte craint de l'inimitié des autres ce qu'elle ne craint pas de l'attaque d'un ennemi acharné, décidé à détruire. »
3. « Ce sur quoi s'appuie l'Islam pour se donner des fondements rationnels solides, tous ceux qui ont été appelés à embrasser cette religion y font allusion, c'est ce qui suit. On commence par leur dire : « Ne leur suffît-il pas que nous ayons fait des-cendre sur toi l'Ecriture qui leur est récitée ? » (29/51). — Et puis, disent-ils, nous avons trouvé, dans la suite, que le Coran était extrêmement loin d'être un exposé satisfaisant et qu'il manquait de preuves persuasives, étant donné que, malgré les divergences de leur credo, toutes les sectes y trouvent des preuves pour leurs doc-trines et des appuis pour soutenir leurs prédications. Si donc l'Islam, pour prouver sa vérité, s'appuie sur ce qui a été dit, et si d'autre part la preuve ainsi avancée se pré-sente avec une telle faiblesse, comment dès lors est-il permis à un être rationnel de décider que l'Islam est la meilleure et la plus juste des religions ? »
4. « Nous avons trouvé que celui qui prêche l'Islam affirme la justesse de ce qu'il avance, et la vérité de ce qu'il dit, en prétendant que les livres (saints) révélés avant l'Islam témoignent en sa faveur. Il récite en effet dans le Coran : « Si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge ceux qui récitent l'Ecriture (révélée) avant toi » (10/94). Mais les maîtres dans les Ecritures anciennes proclament que cette annonce de l'Islam ne se trouve pas dans leurs livres. Ou alors, di-sent-ils, montrez-nous les références. Et si vous arguez contre eux en parlant de dissimulation ou d'altération des textes (ils répondent) : il serait vraiment surprenant, de la part de communautés qui se sont dispersées dans tous les pays, qui ont répandu aussi bien dans leurs élites que dans leurs masses le plus beau message dont on puisse attendre l'apparition, de communautés dont chaque membre attendait ce message et suppliait Dieu de le faire venir jusqu'à ce que le temps en advînt et que la preuve en fût apparente, que ces communautés s'en soient, dans leur totalité, détournées et se soient mises d'accord pour le dissimuler. Par ailleurs si un tel état de chose a pu exister, qu'est-ce qui vous garantit que la même chose ne s'est pas produite pour certaines sourates du Coran ? Mais si, au contraire, les Ecritures anciennes sont vides de toute annonce de l'Islam, le moins qu'on puisse dire du Coran, au sujet de ce qu'il attribue aux autres Ecritures, c'est qu'il a inventé cela. Alors le Coran ne peut plus être mis au rang des Témoignages que l'on accepte et par surcroît on ne peut plus se fier à lui pour ce qui concerne la prophétie de Mahomet [6].
A lire ces arguments, on a bien l'impression que 'Āmirī recueille, avec une objectivité qui lui fait honneur, des objections formulées au nom de la raison par des hommes qui n'appartiennent pas à la religion musulmane. En face de ces objections, quelles vont être ses réponses ? Pourra-t-on dire en les analysant que la formation philosophique de 'Āmirī lui a permis de distinguer le plan philosophique, où les seuls arguments rationnels sont valables, du plan théologique, qui suppose la foi en la révélation coranique ? C'est en examinant les développements de l'ouvrage de ʻĀmirī que nous pourrons répondre à ces questions.
Voici tout d'abord la réponse donnée au groupe des « prétendus intellectuels » (mutaẓarrifa), pour qui, en raison des divergences entre religions, seuls de grands principes de morale humaine sont à retenir : « Personne n'est enclin à accepter ces arguments, sinon ceux qui appartiennent à l'un des deux groupes suivants : ou bien celui des gens qui n'ont pas la force d'accorder à la recherche la part qui lui revient et qui alors en viennent, dans leur croyance, à l'hésitation et au doute ; ou bien celui des gens qui s'adonnent aux plaisirs immédiats et qui ne se préoccupent pas des conséquences dernières de leurs actes [7]. Dès les premières lignes de sa réponse, ʻĀmirī paraît refuser le dialogue rationnel en utilisant des arguments ad hominem : si les mutaẓarrifa mettent en question la religion musulmane, et les autres religions, c'est par manque de rationalité. Ou bien ce sont des gens chez qui la raison est, par nature, incapable de présenter des arguments valables ; ou bien ce sont des débauchés en qui la raison a été étouffée par l'attrait du plaisir immédiat ; dans les deux cas, il n'y a pas à discuter avec eux. Il y a là évidemment un argument dogmatique.
Cependant ʻĀmirī ne se contente pas de cette fin de non recevoir, il donne aussi des arguments. Et d'abord, dit-il, « rien n'est plus irrationnel que d'affirmer l'existence d'un créateur réel qui ne porterait ni ordre ni interdiction, qui n'imposerait ni épreuve ni devoir, qui ne proférerait ni promesse ni menace, qui n'offrirait ni espérance ni crainte ; d'un créateur qui, malgré sa sagesse parfaite et sa toute-puissance, aurait abandonné ses serviteurs doués de raison, de telle manière que chacun reste en ce monde un petit nombre d'années soumis à la tristesse et aux soucis, à la fatigue et à la peine, pour disparaître ensuite définitivement » [8]. Selon 'Āmirī, ses adversaires ne sont donc pas des athées, mais des gens qui admettent l'existence d'un Dieu créateur, et c'est à partir de là que l'argumentation est développée : croire en un Dieu créateur, c'est croire en un Dieu rémunérateur et admettre par conséquent que des actions ont été imposées aux hommes. Il y a là, incontestablement, un argument rationnel.
Dans les réponses qui sont données aux autres objections, comme aussi dans les développements consacrés à l'éloge de l'Islam, on retrouve ce même mélange d'arguments théologiques fondés sur la foi en la religion musulmane et d'arguments philosophiques fondés sur la raison humaine. C'est ainsi que, voulant énumérer les différentes religions avec lesquelles il va comparer l'Islam, 'Āmirī fait appel, non pas à son expérience humaine, mais à un verset du Coran (22/17), où il est parlé des croyants (musulmans), des juifs, des sabéens, des chrétiens, des zoroastriens et des polythéistes. Mais en même temps il affirme rationnellement que chacune de ces religions comporte un contenu dogmatique, un culte et une morale, précisant qu'il va entreprendre son étude « en se soumettant, non à l'imitation des Anciens mais aux exigences d'une saine raison » [9]. Dans la suite, les renseignements sur les diverses religions seront puisés par 'Āmirī dans le Coran, et c'est sur la base de ces affirmations dogmatiques qu'il construira ses preuves rationnelles. De même, la réponse faite à la deuxième objection qui fait état des divergences entre musulmans est une réponse rationnelle : « La vérité ne devient pas erreur du fait que les hommes sont en désaccord par rapport à elle, pas plus que l'erreur ne devient vérité par suite de l'accord des hommes à son égard » [10]. Par contre la réponse à l'objection faite à partir de l'emploi de la force pour répandre l'Islam est une réponse dogmatique, car l'auteur distingue un bon emploi de la force qui est le ǧihād pour l'extension de la religion musulmane, d'un mauvais emploi de la force dans les autres cas.
Ce passage continuel du plan rationnel au plan dogmatique nous oblige, en fin de compte, à poser le problème du rapport entre la raison et la foi. 'Āmirī lui-même donne des indications pour répondre à cette question. Parlant au début de son livre des sciences philosophiques, il explique que, dans leurs principes comme dans leurs conséquences, ces sciences parviennent à des énoncés qui sont conformes aux exigences de la raison et qui sont établis sur des preuves valables, puis il ajoute qu'il en est de même pour les sciences religieuses et affirme : « II est bien connu qu'entre ce qui est étayé sur des preuves et que la raison impose, et ce qu'impose la vraie religion, il ne peut y avoir ni incompatibilité ni opposition [11]. Mais que conclure de ce principe ? Suivant le point de vue que l'on prend, on peut en déduire, soit que l'Islam est rationnel, soit que la raison est musulmane.
Cependant ʻĀmirī ne se contente pas de cette fin de non recevoir, il donne aussi des arguments. Et d'abord, dit-il, « rien n'est plus irrationnel que d'affirmer l'existence d'un créateur réel qui ne porterait ni ordre ni interdiction, qui n'imposerait ni épreuve ni devoir, qui ne proférerait ni promesse ni menace, qui n'offrirait ni espérance ni crainte ; d'un créateur qui, malgré sa sagesse parfaite et sa toute-puissance, aurait abandonné ses serviteurs doués de raison, de telle manière que chacun reste en ce monde un petit nombre d'années soumis à la tristesse et aux soucis, à la fatigue et à la peine, pour disparaître ensuite définitivement » [8]. Selon 'Āmirī, ses adversaires ne sont donc pas des athées, mais des gens qui admettent l'existence d'un Dieu créateur, et c'est à partir de là que l'argumentation est développée : croire en un Dieu créateur, c'est croire en un Dieu rémunérateur et admettre par conséquent que des actions ont été imposées aux hommes. Il y a là, incontestablement, un argument rationnel.
Dans les réponses qui sont données aux autres objections, comme aussi dans les développements consacrés à l'éloge de l'Islam, on retrouve ce même mélange d'arguments théologiques fondés sur la foi en la religion musulmane et d'arguments philosophiques fondés sur la raison humaine. C'est ainsi que, voulant énumérer les différentes religions avec lesquelles il va comparer l'Islam, 'Āmirī fait appel, non pas à son expérience humaine, mais à un verset du Coran (22/17), où il est parlé des croyants (musulmans), des juifs, des sabéens, des chrétiens, des zoroastriens et des polythéistes. Mais en même temps il affirme rationnellement que chacune de ces religions comporte un contenu dogmatique, un culte et une morale, précisant qu'il va entreprendre son étude « en se soumettant, non à l'imitation des Anciens mais aux exigences d'une saine raison » [9]. Dans la suite, les renseignements sur les diverses religions seront puisés par 'Āmirī dans le Coran, et c'est sur la base de ces affirmations dogmatiques qu'il construira ses preuves rationnelles. De même, la réponse faite à la deuxième objection qui fait état des divergences entre musulmans est une réponse rationnelle : « La vérité ne devient pas erreur du fait que les hommes sont en désaccord par rapport à elle, pas plus que l'erreur ne devient vérité par suite de l'accord des hommes à son égard » [10]. Par contre la réponse à l'objection faite à partir de l'emploi de la force pour répandre l'Islam est une réponse dogmatique, car l'auteur distingue un bon emploi de la force qui est le ǧihād pour l'extension de la religion musulmane, d'un mauvais emploi de la force dans les autres cas.
Ce passage continuel du plan rationnel au plan dogmatique nous oblige, en fin de compte, à poser le problème du rapport entre la raison et la foi. 'Āmirī lui-même donne des indications pour répondre à cette question. Parlant au début de son livre des sciences philosophiques, il explique que, dans leurs principes comme dans leurs conséquences, ces sciences parviennent à des énoncés qui sont conformes aux exigences de la raison et qui sont établis sur des preuves valables, puis il ajoute qu'il en est de même pour les sciences religieuses et affirme : « II est bien connu qu'entre ce qui est étayé sur des preuves et que la raison impose, et ce qu'impose la vraie religion, il ne peut y avoir ni incompatibilité ni opposition [11]. Mais que conclure de ce principe ? Suivant le point de vue que l'on prend, on peut en déduire, soit que l'Islam est rationnel, soit que la raison est musulmane.
Un autre passage du Kitāb al i‘lām nous permet d'aller plus loin. Il s'agit du début du premier chapitre où, avant de donner une définition de la science, 'Āmirī parle de la foi et de l'incroyance : « La foi est une ferme adhésion, véridique et sûre ; dans l'âme, la foi se rattache à la puissance rationnelle. L'incroyance au contraire est une ferme adhésion, mensongère et incertaine ; dans l'âme, l'incroyance se rattache à la puissance imaginative » [12]. Dans ce texte, nulle ambiguïté ne subsiste : si la foi musulmane est toujours considérée comme rationnelle, puisque la faculté qui en est la source est la raison, inversement, la raison humaine est réduite aux dimensions de la foi musulmane puisque, dès que l'on sort du domaine de cette foi, on est livré à l'imagination qui conduit à l'erreur.
Deux exemples pris dans les développements de 'Āmirī vont montrer comment se fait l'application de ces principes. Dans le premier, voulant montrer l'importance du contenu de la foi, l'auteur écrit : « Un homme peut très bien être connu pour la pureté de ses mœurs, pour sa retenue et la justesse de ses idées, mais si sa foi est infirme, on n'accordera nulle attention à ses vertus ; tout au contraire, on lui déniera l'honnêteté, on le traitera, pour le témoignage en justice, comme un débauché, pour l'héritage, comme un étranger, et pour le mariage, comme un être de basse condition [13].
Ce texte, pour être interprété correctement, doit se référer à ce que 'Āmirī affirme touchant les rapports entre le savoir et l'agir. Pour lui, ainsi qu'il l'écrit, juste avant le passage cité plus haut, « le rapport du savoir à l'agir est semblable à celui qui relie la cause à l'effet, ou le début à l'achèvement ». Cela signifie que les natures mêmes du savoir et de l'agir sont liées entre elles et que par conséquent un mauvais savoir a pour conséquence un agir mauvais. L'homme qui n'a pas la foi musulmane ne peut, par conséquent, accomplir des actions bonnes. Cela signifie que des actions, qu'un homme, avec les lumières de sa raison, jugerait bonnes, sont, pour le musulman, mauvaises, du seul fait qu'elles sont accomplies par un non musulman. La raison du musulman est donc liée au domaine de la foi musulmane, au point que ce qui devrait être jugé bon pour une raison indépendante doit être jugé mauvais par la raison musulmane.
Un autre exemple présente la situation inverse, il s'agit du passage où ʻĀmirī justifie le ǧihād. Bien loin de nier, comme le font beaucoup d'apologètes modernes, que Mahomet ait utilisé la force pour propager sa religion, l'auteur justifie le ǧihād. Il reconnaît que l'utilisation de la force est mauvaise, en disant que si le Prophète avait pu répandre sa religion par la seule persuasion, il l'aurait fait. Mais il affirme en même temps que cette action mauvaise devient bonne, dans le cas où la force est utilisée par un croyant musulman au service de sa foi [14]. L'identification entre le domaine de la foi et celui de la raison se fait donc en ce sens que la foi musulmane est en accord total avec une raison islamisée et réduite aux dimensions de cette foi. On comprend dès lors pourquoi ʻĀmirī passe sans transition et sans explication d'un argument que nous jugeons rationnel à un autre que nous jugeons dogmatique : pour lui il n'y a pas de différence, les deux sortes d'arguments peuvent aussi bien être dites rationnelles que dogmatiques, car elles relèvent d'une raison musulmane comme d'un Islam rationnel.
Mais si cette conclusion est la seule qui permette de donner un sens aux affirmations de ʻĀmirī, elle soulève en même temps un problème qui concerne non plus le contenu de l'ouvrage mais son caractère visiblement apologétique. Nous nous trouvons en effet devant une contradiction apparente. D'une part ʻĀmirī affirme clairement que le domaine de la raison est celui qui est délimité par la religion musulmane, et d'autre part il prend en considération des arguments qui viennent des non-musulmans, c'est-à-dire d'un domaine qui, pour lui, est extérieur et à l'Islam et à la raison.
C'est ici qu'il faut poser la question du public auquel le traité s'adresse. Si l'on part de l'hypothèse d'un public non musulman, non seulement on n'explique pas la contradiction apparente relevée plus haut, mais, de plus, l'ouvrage de ʻĀmirī apparaît comme une tentative manquée. Comment des non-musulmans pourraient-ils être convaincus par une argumentation où le Coran joue un rôle aussi important que la raison, par un discours qui finalement ne sort pas des limites tracées par l'Islam.
Il semble donc plus raisonnable, si l'on veut comprendre le traité de ʻĀmirī, tel qu'il se présente, de le considérer comme adressé à des musulmans. D'une part en effet, c'est seulement ainsi que les contradictions disparaissent, et d'autre part un certain nombre de passages du traité orientent le lecteur dans ce sens. Dès les premières pages, ʻĀmirī, dédiant son livre à son bienfaiteur de Buẖārā, précise l'orientation de ses développements. Il écrit, dit-il, pour renforcer la foi d'un homme qui ne se contente pas des arguments traditionnels mais veut avoir l'évidence « rationnelle » de la supériorité de l'Islam sur toutes les autres religions. Dans la suite, et tout au long de son traité, ʻĀmirī, sous les apparences d'un dialogue avec les non-musulmans, s'adresse en fait à des groupes de croyants dont les opinions lui semblent erronées. Il attaque ainsi des philosophes et des bāṭinites, des ḥašwīya et des mutakallimūn, des nussāk et des muḥaddiṯūn, des imāmites et des ḥanbalites.
Cependant, l'objectivité avec laquelle 'Āmirī rapporte les critiques faites à la religion musulmane oblige à ne pas écarter complètement la première hypothèse ; et s'il y a surtout, dans son traité, une apologie destinée aux musulmans, on y trouve aussi une tentative de dialogue avec les non musulmans. Mais cette tentative, de notre point de vue, n'est pas concluante, du fait que l'auteur ne semble pas avoir eu l'idée d'une raison universelle à l'oeuvre dans différentes cultures.
Une telle attitude peut paraître surprenante de la part d'un commentateur de la philosophie grecque, et en particulier d'Aristote. Comment l'étude de cette philosophie, à peine théiste, et qui contredisait le dogme musulman sur plus d'un point, n'a-t-elle pas amené 'Āmirī à l'idée que la raison débordait, dans son exercice, les cadres de la pensée musulmane ? Il faudrait, pour répondre à cette question, de longs développements. Nous indiquerons seulement ici ce que nous développons plus longuement dans un article sur al-Kindī [15]. Il semble qu'il y ait, à cette attitude des falāsifa, deux motifs différents, l'un objectif et l'autre subjectif. Sur le plan des textes grecs qu'ils avaient à étudier, la confrontation entre deux systèmes hétérogènes de pensée avait été très atténuée, comme l'ont déjà fait remarquer bien des spécialistes, par le fait qu'une tradition philosophique judéo-chrétienne avait déjà opéré une première synthèse dont les résultats, parfois présentés sous des noms d'emprunt, permirent à des musulmans croyants d'assimiler la philosophie grecque sans trop de heurts. Mais subjectivement aussi les falāsifa étaient préparés, par leur formation musulmane, à une telle assimilation. En effet, le Coran, relisant à sa manière les écritures des juifs et des chrétiens, donnait déjà le modèle d'une islamisation du judaïsme et du christianisme qui excluait toute véritable confrontation et tout véritable dialogue [16].
Le traité de 'Āmirī se situe donc dans la ligne des ouvrages de ces philosophes théologiens dont la civilisation musulmane nous présente un grand nombre de types divers. S'il accorde un rôle important à l'exercice de la raison, ce rôle reste déterminé par les normes posées une fois pour toutes par la révélation coranique. Il s'ensuit que, pour lui, le monde extérieur à l'Islam ne peut avoir d'autre rationalité que celle qui est présentée par le Coran. On peut seulement souligner que la situation de 'Āmirī aux frontières du dār al-islām lui permet une plus grande ouverture vis-à-vis des non-musulmans qui l'entourent et qu'il a su écouter et comprendre.
Deux exemples pris dans les développements de 'Āmirī vont montrer comment se fait l'application de ces principes. Dans le premier, voulant montrer l'importance du contenu de la foi, l'auteur écrit : « Un homme peut très bien être connu pour la pureté de ses mœurs, pour sa retenue et la justesse de ses idées, mais si sa foi est infirme, on n'accordera nulle attention à ses vertus ; tout au contraire, on lui déniera l'honnêteté, on le traitera, pour le témoignage en justice, comme un débauché, pour l'héritage, comme un étranger, et pour le mariage, comme un être de basse condition [13].
Ce texte, pour être interprété correctement, doit se référer à ce que 'Āmirī affirme touchant les rapports entre le savoir et l'agir. Pour lui, ainsi qu'il l'écrit, juste avant le passage cité plus haut, « le rapport du savoir à l'agir est semblable à celui qui relie la cause à l'effet, ou le début à l'achèvement ». Cela signifie que les natures mêmes du savoir et de l'agir sont liées entre elles et que par conséquent un mauvais savoir a pour conséquence un agir mauvais. L'homme qui n'a pas la foi musulmane ne peut, par conséquent, accomplir des actions bonnes. Cela signifie que des actions, qu'un homme, avec les lumières de sa raison, jugerait bonnes, sont, pour le musulman, mauvaises, du seul fait qu'elles sont accomplies par un non musulman. La raison du musulman est donc liée au domaine de la foi musulmane, au point que ce qui devrait être jugé bon pour une raison indépendante doit être jugé mauvais par la raison musulmane.
Un autre exemple présente la situation inverse, il s'agit du passage où ʻĀmirī justifie le ǧihād. Bien loin de nier, comme le font beaucoup d'apologètes modernes, que Mahomet ait utilisé la force pour propager sa religion, l'auteur justifie le ǧihād. Il reconnaît que l'utilisation de la force est mauvaise, en disant que si le Prophète avait pu répandre sa religion par la seule persuasion, il l'aurait fait. Mais il affirme en même temps que cette action mauvaise devient bonne, dans le cas où la force est utilisée par un croyant musulman au service de sa foi [14]. L'identification entre le domaine de la foi et celui de la raison se fait donc en ce sens que la foi musulmane est en accord total avec une raison islamisée et réduite aux dimensions de cette foi. On comprend dès lors pourquoi ʻĀmirī passe sans transition et sans explication d'un argument que nous jugeons rationnel à un autre que nous jugeons dogmatique : pour lui il n'y a pas de différence, les deux sortes d'arguments peuvent aussi bien être dites rationnelles que dogmatiques, car elles relèvent d'une raison musulmane comme d'un Islam rationnel.
Mais si cette conclusion est la seule qui permette de donner un sens aux affirmations de ʻĀmirī, elle soulève en même temps un problème qui concerne non plus le contenu de l'ouvrage mais son caractère visiblement apologétique. Nous nous trouvons en effet devant une contradiction apparente. D'une part ʻĀmirī affirme clairement que le domaine de la raison est celui qui est délimité par la religion musulmane, et d'autre part il prend en considération des arguments qui viennent des non-musulmans, c'est-à-dire d'un domaine qui, pour lui, est extérieur et à l'Islam et à la raison.
C'est ici qu'il faut poser la question du public auquel le traité s'adresse. Si l'on part de l'hypothèse d'un public non musulman, non seulement on n'explique pas la contradiction apparente relevée plus haut, mais, de plus, l'ouvrage de ʻĀmirī apparaît comme une tentative manquée. Comment des non-musulmans pourraient-ils être convaincus par une argumentation où le Coran joue un rôle aussi important que la raison, par un discours qui finalement ne sort pas des limites tracées par l'Islam.
Il semble donc plus raisonnable, si l'on veut comprendre le traité de ʻĀmirī, tel qu'il se présente, de le considérer comme adressé à des musulmans. D'une part en effet, c'est seulement ainsi que les contradictions disparaissent, et d'autre part un certain nombre de passages du traité orientent le lecteur dans ce sens. Dès les premières pages, ʻĀmirī, dédiant son livre à son bienfaiteur de Buẖārā, précise l'orientation de ses développements. Il écrit, dit-il, pour renforcer la foi d'un homme qui ne se contente pas des arguments traditionnels mais veut avoir l'évidence « rationnelle » de la supériorité de l'Islam sur toutes les autres religions. Dans la suite, et tout au long de son traité, ʻĀmirī, sous les apparences d'un dialogue avec les non-musulmans, s'adresse en fait à des groupes de croyants dont les opinions lui semblent erronées. Il attaque ainsi des philosophes et des bāṭinites, des ḥašwīya et des mutakallimūn, des nussāk et des muḥaddiṯūn, des imāmites et des ḥanbalites.
Cependant, l'objectivité avec laquelle 'Āmirī rapporte les critiques faites à la religion musulmane oblige à ne pas écarter complètement la première hypothèse ; et s'il y a surtout, dans son traité, une apologie destinée aux musulmans, on y trouve aussi une tentative de dialogue avec les non musulmans. Mais cette tentative, de notre point de vue, n'est pas concluante, du fait que l'auteur ne semble pas avoir eu l'idée d'une raison universelle à l'oeuvre dans différentes cultures.
Une telle attitude peut paraître surprenante de la part d'un commentateur de la philosophie grecque, et en particulier d'Aristote. Comment l'étude de cette philosophie, à peine théiste, et qui contredisait le dogme musulman sur plus d'un point, n'a-t-elle pas amené 'Āmirī à l'idée que la raison débordait, dans son exercice, les cadres de la pensée musulmane ? Il faudrait, pour répondre à cette question, de longs développements. Nous indiquerons seulement ici ce que nous développons plus longuement dans un article sur al-Kindī [15]. Il semble qu'il y ait, à cette attitude des falāsifa, deux motifs différents, l'un objectif et l'autre subjectif. Sur le plan des textes grecs qu'ils avaient à étudier, la confrontation entre deux systèmes hétérogènes de pensée avait été très atténuée, comme l'ont déjà fait remarquer bien des spécialistes, par le fait qu'une tradition philosophique judéo-chrétienne avait déjà opéré une première synthèse dont les résultats, parfois présentés sous des noms d'emprunt, permirent à des musulmans croyants d'assimiler la philosophie grecque sans trop de heurts. Mais subjectivement aussi les falāsifa étaient préparés, par leur formation musulmane, à une telle assimilation. En effet, le Coran, relisant à sa manière les écritures des juifs et des chrétiens, donnait déjà le modèle d'une islamisation du judaïsme et du christianisme qui excluait toute véritable confrontation et tout véritable dialogue [16].
Le traité de 'Āmirī se situe donc dans la ligne des ouvrages de ces philosophes théologiens dont la civilisation musulmane nous présente un grand nombre de types divers. S'il accorde un rôle important à l'exercice de la raison, ce rôle reste déterminé par les normes posées une fois pour toutes par la révélation coranique. Il s'ensuit que, pour lui, le monde extérieur à l'Islam ne peut avoir d'autre rationalité que celle qui est présentée par le Coran. On peut seulement souligner que la situation de 'Āmirī aux frontières du dār al-islām lui permet une plus grande ouverture vis-à-vis des non-musulmans qui l'entourent et qu'il a su écouter et comprendre.
Cet article a déjà été publié dans la Revue de l'histoire des religions, tome 187 n°1, 1975. pp. 57-69.
_____________________________
[1] Récemment édité par M. Fathalla Kholeif (Dar el-Mashreq, Beyrouth, 1970).
[2] Les attributs divins dans la doctrine ďal-Aš'arī, Beyrouth, 1965, p. 426.
[3] As-Sa'ādah wa' l-is'ād, éd. M. Minovi, pp. 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, etc.
[4] I‘lām, p. 101.
[5] Nous lisons ici ārā' et non ahwā'.
[6] I‘lām, pp. 186-187.
[7] I‘lām, p. 102.
[8] Ibid.
[9] I‘lām, p.124.
[10] I‘lām, p.193.
[11] Ibid p.87
[12] I‘lām, p.83.
[13] I‘lām, pp. 125-126.
[14] I‘lām, pp. 189-191.
[15] Mélanges de l'Université Saint-Joseph, t. XLVI, 1970, pp. 451-465.
[16] Dans la même ligne, saint Jean Damascene faisait de l'Islam une hérésie du christianisme.
_____________________________
[1] Récemment édité par M. Fathalla Kholeif (Dar el-Mashreq, Beyrouth, 1970).
[2] Les attributs divins dans la doctrine ďal-Aš'arī, Beyrouth, 1965, p. 426.
[3] As-Sa'ādah wa' l-is'ād, éd. M. Minovi, pp. 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, etc.
[4] I‘lām, p. 101.
[5] Nous lisons ici ārā' et non ahwā'.
[6] I‘lām, pp. 186-187.
[7] I‘lām, p. 102.
[8] Ibid.
[9] I‘lām, p.124.
[10] I‘lām, p.193.
[11] Ibid p.87
[12] I‘lām, p.83.
[13] I‘lām, pp. 125-126.
[14] I‘lām, pp. 189-191.
[15] Mélanges de l'Université Saint-Joseph, t. XLVI, 1970, pp. 451-465.
[16] Dans la même ligne, saint Jean Damascene faisait de l'Islam une hérésie du christianisme.