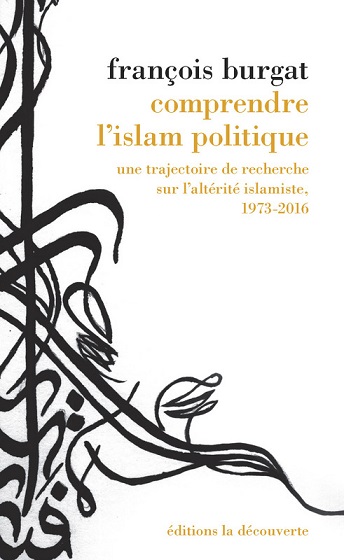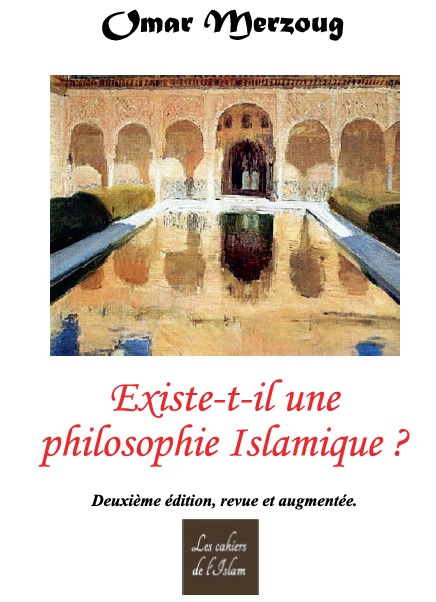«Les crispations “djihadistes” sont souvent exacerbées par des ingérences étrangères»
Après avoir acquis une solide expérience des réalités du Monde arabe à travers de longs séjours et de nombreuses pérégrinations, François Burgat livre, dans « Comprendre l’islam politique » Editions La Découverte, quelques clés explicatives du phénomène auquel il a consacré trois autres grands ouvrages . Son propos à l’encontre de la doxa régnante en ce domaine nous a paru assez original pour que nous éprouvions le désir de prêter l’oreille à ses analyses.
Entretien
Par Omar Merzoug
Cet entretien est publié avec l'aimable autorisation de son auteur.
Cet entretien est publié avec l'aimable autorisation de son auteur.
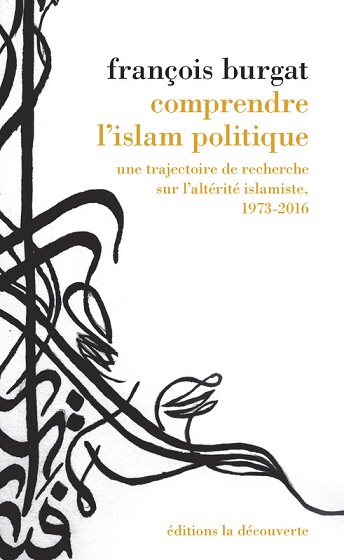
Omar Merzoug : «Comprendre l’islam politique» est un essai assez particulier si on le compare à vos livres précédents. Il est sous-titré « Une trajectoire de recherche sur l’altérité islamiste ». Pourquoi ce style particulier ? Quelle est votre visée dans cet ouvrage ?
Omar Merzoug : «Comprendre l’islam politique» est un essai assez particulier si on le compare à vos livres précédents. Il est sous-titré « Une trajectoire de recherche sur l’altérité islamiste ». Pourquoi ce style particulier ? Quelle est votre visée dans cet ouvrage ?
François Burgat : Même si le livre n’est pas exempt d’une dimension autobiographique, mon objectif principal était ailleurs. Je voulais avant tout, en la mettant à jour, donner une nouvelle présentation de mon approche analytique. Sans me départir d’une problématique qui a très peu évolué depuis que, au début des années 1980, j’ai abordé l’étude des courants islamistes, j’ai voulu contextualiser, dans chacun de mes terrains successifs, la gestation de mes principales hypothèses. Expliquer en quelque sorte, et le cas échéant justifier, comment et pourquoi j’avais progressivement construit mon approche dans ce qu’elle peut avoir aujourd’hui de relativement spécifique.
O.M : Vous vous situez dans le sillage de vos aînés que vous nommez (Maxime Rodinson, Charles-André Julien ou Jacques Berque), en quoi vous distinguez- vous de vos devanciers ? Par les thèses? Par la méthode ?
F.B : J’ai un immense respect pour eux tous. Ils ont nourri ma compréhension de plusieurs facettes essentielles du Monde arabe au cours de la période coloniale et des premières décennies des indépendances. Tous étaient proches de leur terrain et dans une attitude suffisamment empathique pour être vaccinés contre les plus fragiles théorisations essentialistes de certains de leurs successeurs, notamment américains. Cette dérive essentialiste qui affecte bon nombre d’écrits sur “le Monde musulman” a une origine facile à identifier : la propension à enfermer l’Autre dans un petit nombre de “certitudes” culturalistes est banalement, en général, inversement proportionnelle à la qualité de la connaissance sociologique qu’on a de cet Autre. Plus cette connaissance est ténue, plus sera forte la tendance à se réfugier dans le raccourci facile qui consiste à l’enfermer dans l’exégèse de quelques traits de sa religion ou de sa culture. Cela étant dit, peu de mes grands aînés ont abordé la problématique de l’islamisme contemporain. Et ceux qui l’ont fait (notamment Berque vis-à-vis de la gestation des Frères musulmans) l’ont fait en des termes dont j’ai éprouvé le besoin de me démarquer. L’empathie de Berque avec la génération nassériste était telle que les premiers repères de sa perception du courant fondé par Hassan al-Banna étaient à mon sens très restrictifs. Même l’immense Rodinson a commenté les événements du Onze septembre en des termes auxquels je ne pouvais souscrire .
O.M : En faisant part d’une solide conviction, vous écrivez : «Les tensions qui affectent la relation du Monde occidental au Monde musulman ont une origine plus politique qu’idéologique ». Ça mérite un commentaire.
F.B : C’est effectivement cette perspective qui structure l’essentiel de ce que j’ai écrit. Les dominants (c’est-à dire, pour d’évidentes raisons historiques, les Européens et les Américains, mais tout autant les élites arabes au pouvoir) ont un penchant récurrent à nier la dimension politique des différends qui les opposent à ceux qui contestent la légitimité de leur pouvoir ou la validité de leurs politiques. Un de leurs réflexes les mieux partagés lorsqu’ils sont confrontés à un différend politique est non seulement de ne blâmer que l’Autre, mais également d’expliquer la divergence en l’attribuant à un atavisme lié à sa culture ou à sa religion. Cette posture permet à celui qui l’adopte de s’exonérer de toute responsabilité. Eh bien, disons qu’une constante de mon approche a été de redonner toute sa place à la matrice banalement politique des différends qui ont jalonné la relation entre les Européens et le Monde “musulman” de leurs proches voisins du Sud et de l’Est de la Méditerranée. Cette approche a conservé une certaine originalité au Nord de la Méditerranée. Mais elle est considérée comme beaucoup plus banale sur la rive “musulmane” du monde. Je dirais donc que la durée de mes séjours dans le Monde musulman m’a manifestement conduit à rééquilibrer la perception occidentale dominante en y ajoutant un peu de la sensibilité qui prévaut, sinon dans ces sociétés en général, au moins dans les composantes de ces sociétés dont la communication avec nos médias est particulièrement déficiente.

François Burgat. Source inconnue
O.M : Vous avez publié trois ouvrages qui développent l’essentiel de vos propositions, « L’islamisme au Maghreb » (éd. Khartala/ Payot), « L’islamisme en face » et « L’islamisme à l’heure d’Al-Qaida » (éd. La Découverte); à quels résultats aboutissez-vous ?
F.B : En peu de mots je dirai que je me suis avant toute chose efforcé de mettre en évidence la corrélation très directe entre le phénomène ou le “moment” islamiste qui traverse les scènes politiques arabes et la vieille dynamique de décolonisation. C’est pour cela que j’ai proposé de “construire” la poussée islamiste comme une sorte de troisième temps ou de troisième facette, culturelle ou symbolique, de la dynamique indépendantiste, et donc comme la suite ou comme le corollaire des ruptures politiques (les indépendances) et économiques (les nationalisations). Cela m’a permis de faire le tri entre l’ivraie du repli identitaire et le bon grain d’une plus banale affirmation culturelle. Et de montrer ce faisant que - contrairement au credo occidental - (ou même d’une partie au moins des gauches arabes) - ce phénomène ne peut pas être réduit sans nuance au rang d’une pathologie sociale et politique. J’ai rétabli en quelque sorte dans l’analyse du phénomène islamiste la diversité et le caractère évolutif des expressions, et ce faisant un certain relief et une certaine complexité que le registre de discrédit très caricatural sur lequel les islamistes ont longtemps été traités par le regard occidental ne permettait pas de prendre en compte. Il n’est pas question de nier que la remise à distance de tout ou partie de l’héritage occidental du fait du contexte colonial de sa médiation peut générer des postures purement réactives dont certaines peuvent être très légitimement considérées comme pathologiques. Mais la dynamique dite islamiste dans son ensemble ne peut aucunement être réduite à cette dérive. Le fait pour les sociétés de l’ex-périphérie coloniale de rechercher, sur le registre identitaire, à restaurer la légitimité et l’universalité de la culture (islamique) héritée justifie à mon sens une approche moins simplificatrice que celle qui s’est plus ou moins imposée dans les opinions publiques et dans les classes politiques occidentales.
O.M : Vous consacrez tout un chapitre à l’Algérie. Quel rôle a joué votre séjour et votre expérience algérienne dans la cristallisation de votre conscience politique ?
F.B : Pour prendre la mesure de l’importance et de la complexité de la séquence coloniale, s’il faut privilégier un terrain, ce devrait être la relation franco-algérienne. Elle est, à tous égards, très archétypique. C’est la plus longue, la plus totale et bien sûr la plus violente. Dans mon itinéraire personnel, après un certain nombre de prises de contact avec le monde non français puis non européen, l’Algérie a par ailleurs été la première coupure longue (sept ans) avec l’univers familial et national de ce que j’appelle ma culture “héritée”. C’est donc en Algérie que j’ai entrevu d’abord l’importance de la fracture qui sépare jusqu’à ce jour les mémoires respectives. C’est là que j’ai mesuré la difficulté qu’avait eu mon environnement familial et national, notamment éducatif, à me transmettre une vision raisonnablement plurielle ou simplement… réaliste de cette séquence conflictuelle. Je l’exprime en disant que j’ai compris en Algérie que “l’histoire de l’Autre” était bien souvent, avant toute chose, une histoire “autre”. Cette rupture féconde avait également eu lieu lorsque j’avais eu l’occasion d’aller mesurer, sur le terrain du conflit israélo- arabe, la profonde distance qui séparait le credo médiatique et politique dominant dans ma “patrie des droits de l’homme” avec la cruelle réalité que, jusqu’à ce jour, la France, et bien d’autres, laissent se pérenniser. J’ai évidemment appris bien d’autres choses en Algérie. J’ai commencé à y entrevoir la nécessité essentielle de sortir des limites de ma francophonie et amorcé mon long itinéraire - encore inachevé ! - d’acquisition de la langue arabe. J’y ai pris enfin la mesure de la force et de la faiblesse des stratégies développementistes conduites par les Etats pétroliers, ainsi, bien sûr, que les travers inhérents à un certain nombre de régimes autoritaires dans cette région du monde.

Malek Bennabi. Source inconnue. CC BY-SA 4.0
O.M : Vous évoquez Malek Bennabi à qui vous rendez hommage. Quel profit avez-vous tiré de la lecture de ses essais ?
F.B : Les témoignages de Malek Bennabi et notamment ses éclairantes “Mémoires d’un témoin du siècle” contiennent une fascinante formulation et une toute aussi fascinante illustration de ce que j’ai longtemps peiné pour ma part à entrevoir et plus encore à exprimer. Le témoignage de Bennabi couvre, comme il le dit, le spectre long de l’histoire coloniale algérienne puisque sa mémoire englobe les récits de ses ancêtres face à l’irruption militaire étrangère dans sa ville de Constantine jusqu’aux premiers frissons de la guerre de Libération. Il demeure avant tout pour moi l’un de ceux qui ont déconstruit le plus éloquemment les ressorts culturels et symboliques de la domination coloniale. Je vénère notamment cette formule qu’il a eue pour dénoncer les grossières manipulations électorales de la puissance coloniale : “C’est la méthode de ‘ôte ta conscience de là que j’y mette la mienne’”.
O.M : Vous dites que la radicalisation de l’engagement islamiste est avant tout le fruit des ingérences étrangères ? Pourriez-vous éclairer notre lanterne sur ce point.
F.B : J’ai souligné ce qui devrait être une évidence, mais ne l’est toujours pas ! Les crispations “djihadistes” au sens le plus contemporain de ce terme sont systématiquement liées, avant tout, à un profond dysfonctionnement des institutions ayant vocation à assurer la représentation politique au sein des sociétés concernées. Mais l’histoire montre que ces dysfonctionnements sont très régulièrement exacerbés par des ingérences étrangères. Le djihadisme dans sa version contemporaine a vu le jour en Afghanistan en réaction aux ingérences soviétique d’abord, américaine ensuite. Il a pris pied en Irak en 2003 en réaction à l’invasion américaine puis à l’ingérence iranienne. En Syrie, il prospère - sans oublier la stratégie opaque du régime - dans le droit fil de la triple ingérence iranienne encore puis russe et bien sûr occidentale dans le conflit.
O.M : A quoi répond votre décision d’apprendre la langue arabe ? En quoi la connaissance de la langue arabe vous paraît-elle prospective ?
F.B : Pour d’innombrables et très banales raisons ! Mais disons que pour tout être sur terre, la familiarité avec un univers symbolique autre celui de sa culture héritée est extrêmement enrichissante. Or, elle l’est peut-être plus encore pour un occidental pour une raison évidente. Un citoyen du Maghreb ou du Proche Orient a vécu - chez lui - une ouverture forcée aux cultures et religions autres que la sienne. Ce qui n’est pas le cas des citoyens dont les pays ont été un temps en situation d’hégémonie mondiale.
O.M : Vous faites état de divergences fortes avec d’une part Olivier Roy et encore plus profondes avec Gilles Kepel. Quelles sont ces divergences et à quoi tiennent-elles ?
F.B : En résumé, je dirais que ces deux approches, si différentes soient-elles, ont en commun de nous détourner de ce que je considère comme l’essentiel qui est de penser la part de responsabilité de l’environnement dans lequel évoluent ceux qui se “radicalisent”, c’est-à-dire… la “nôtre”, celle des non musulmans dans le théâtre politique occidental ou celle des dominants dans l’arène politique orientale. Roy pense pouvoir affirmer qu’aucun des grands préjudices subis par les sociétés musulmanes, dans le contexte colonial puis dans le cadre ultérieur de l’immigration et des politiques étrangères actuelles, n’a quoi que ce soit à voir avec cette radicalisation. C’est une posture parfaitement irréaliste. Kepel pense que c’est l’idéologie salafiste qui vient entraîner les citoyens français sur la pente de l’action violente. Son approche suppose que l’idéologie radicale produise la radicalisation de l’action politique . Je pense pour ma part à peu près… exactement le contraire ! A savoir que les djihadistes n’optent pour la version binaire et clivante, potentiellement conflictuelle de leur identité religieuse que parce qu’ils ont fait d’une façon ou d’une autre l’objet d’une stigmatisation sociale et/ou politique. Nous ne devrions donc concentrer notre lutte non pas contre “les idéologies radicales” (islamistes aujourd’hui, marxistes ou nationalistes hier) mais bien contre les dysfonctionnements des institutions politiques qui fabriquent ceux qui, dans le vaste “supermarché” des modes d’appropriation en politique de leur identité religieuse choisissent systématiquement la case “radicale”. Kepel inverse donc les effets (la mobilisation, très légitime, contre l’islamophobie) et les causes (les failles du “vivre ensemble” national). Et il cède à la facilité de criminaliser (en les traitant d’”islamogauchistes”) ceux qui veulent traiter ces causes qu’il se montre incapable d’identifier lucidement.
________________________
[1] « L’islamisme au Maghreb » (éd. Khartala/Payot), «L’islamisme en face » et «L’islamisme à l’heure d’Al-Qaida » (éd. La Découverte).
[2] Interrogé par un journaliste du magazine «Le Point» sur les motivations des auteurs des attentats du 11 septembre qui évoque « le choc des civilisations», Maxime Rodinson n’oppose aucune dénégation à cette «formule » controversée même s’il la nuance : «On peut y déceler une origine de cette sorte, déclare-t-i, Il existe une concurrence entre l’Orient et l’Occident. Mais le phénomène est complexe. On ne peut pas affirmer globalement que tel événement ressort de la civilisation et tel autre non ». Les notions d’Orient et d’Occident sont ici prises dans une vision essentialisée. Tout se passe comme si l’Occident et l’Orient étaient des notions univoques, intemporelles, éternellement égales à elles-mêmes, sans perspective d’évolution ni de transformation (Omar Merzoug).
[3]Une violente polémique a opposé, l’année dernière, Oliver Roy, philosophe de formation qui s’est spécialisé dans l’étude de l’islamisme à Gilles Kepel, connu pour ses livres comme « La revanche de Dieu» ou «Jihad». Olivier Roy considère qu’on ne peut parler en toute rigueur de « la radicalisation de l’islam» mais plutôt de «l’islamisation de la radicalité». Autrement dit le fanatisme religieux meurtrier aurait peu de chose à voir avec la religion, mais beaucoup avec une sorte de révolte juvénile touchant une génération entière qui puise dans la religion ses mots d’ordre et ses motifs d’action. A l’inverse, G. Kepel tient le salafi sme pour la clef explicative des actions terroristes. Alors que pour O Roy, le fait religieux est marginal, Kepel en fait la matrice qui rend compte du terrorisme islamiste.
[1] « L’islamisme au Maghreb » (éd. Khartala/Payot), «L’islamisme en face » et «L’islamisme à l’heure d’Al-Qaida » (éd. La Découverte).
[2] Interrogé par un journaliste du magazine «Le Point» sur les motivations des auteurs des attentats du 11 septembre qui évoque « le choc des civilisations», Maxime Rodinson n’oppose aucune dénégation à cette «formule » controversée même s’il la nuance : «On peut y déceler une origine de cette sorte, déclare-t-i, Il existe une concurrence entre l’Orient et l’Occident. Mais le phénomène est complexe. On ne peut pas affirmer globalement que tel événement ressort de la civilisation et tel autre non ». Les notions d’Orient et d’Occident sont ici prises dans une vision essentialisée. Tout se passe comme si l’Occident et l’Orient étaient des notions univoques, intemporelles, éternellement égales à elles-mêmes, sans perspective d’évolution ni de transformation (Omar Merzoug).
[3]Une violente polémique a opposé, l’année dernière, Oliver Roy, philosophe de formation qui s’est spécialisé dans l’étude de l’islamisme à Gilles Kepel, connu pour ses livres comme « La revanche de Dieu» ou «Jihad». Olivier Roy considère qu’on ne peut parler en toute rigueur de « la radicalisation de l’islam» mais plutôt de «l’islamisation de la radicalité». Autrement dit le fanatisme religieux meurtrier aurait peu de chose à voir avec la religion, mais beaucoup avec une sorte de révolte juvénile touchant une génération entière qui puise dans la religion ses mots d’ordre et ses motifs d’action. A l’inverse, G. Kepel tient le salafi sme pour la clef explicative des actions terroristes. Alors que pour O Roy, le fait religieux est marginal, Kepel en fait la matrice qui rend compte du terrorisme islamiste.