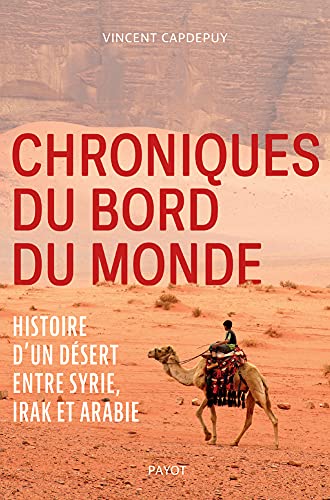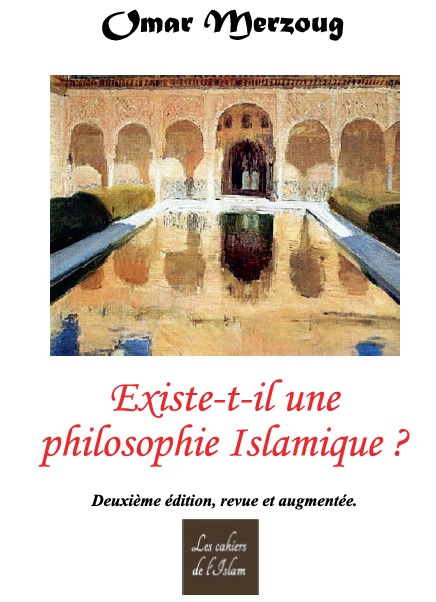On aurait tort de ne pas explorer les blancs des cartes. Placé sous la loupe du géohistorien, un désert comme celui de Syrie peut révéler une richesse insoupçonnée.
Benjamin BADIER
Ancien élève de l'ENS de Lyon et agrégé d'histoire, Benjamin Badier est doctorant à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Sa spécialité est l'histoire du Maghreb contemporain.
Publication en partenariat avec nonfiction.fr .
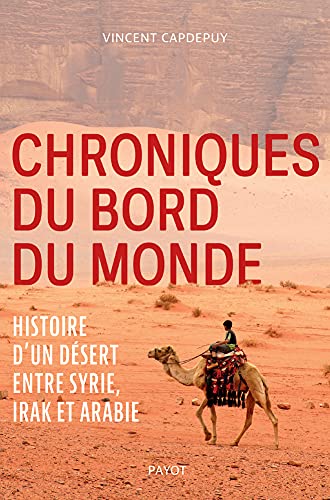
Broché: 480 pages
Editeur : EDITIONS PAYOT & RIVAGES; Illustrated édition (31 mars 2021)
Langue : Français
ISBN-13: 978-2228927918
Editeur : EDITIONS PAYOT & RIVAGES; Illustrated édition (31 mars 2021)
Langue : Français
ISBN-13: 978-2228927918
Par Benjamin BADIER
S’écarter des sentiers battus de l’histoire et de la géographie du Moyen-Orient : c’est ce que proposent les Chroniques du bord du monde. Elles invitent à un voyage à travers l’espace et le temps du désert de Syrie, à l’est de Damas. Spécialiste de l’histoire globale et de l’histoire environnementale, disciple de Christian Grataloup et enseignant dans le secondaire à la Réunion, Vincent Capdepuy nous sert de guide à travers une succession de cinquante courtes chroniques, lointaines héritières d’un travail de thèse. Leur diversité et leur érudition dessinent par touches colorées un paysage fascinant qui, malgré le tableau des usages que les hommes en ont fait et des représentations qu’ils en ont tirées, ne perd rien de son mystère.
Se retirer au désert
L’exploration du désert conduit à un double dépaysement. Le premier, géographique, est une invitation dans un lieu a priori peu fréquenté, mais surtout peu connu et étudié. C’est le désert de Syrie, comme nous le nommons de nos jours, dans des limites que l’auteur s’abstient volontairement de définir avec précision, à cheval entre l’Irak, la Syrie, la Jordanie et l’Arabie aujourd’hui saoudite, entre la Ghouta, l’oasis de Damas, et la badiya (la steppe), coincé entre le Levant et la Mésopotamie. Cet espace, rarement cartographié, n’est pas qu’un inconnu géographique : les historiens l’ont aussi délaissé, puisque « les blancs des cartes sont aussi souvent des blancs de l’histoire » (p.17) . Ce n’est pas la géographie physique qui intéresse Vincent Capdepuy, mais la géographie humaine, et l’appréhension par les générations successives de cet espace aride, de ses anciens lacs, de ses points d’eau et de ses ressources, comme la truffe ou le pétrole. Le Djebel Says, à l’est de Damas, n’est pas qu’un simple volcan : c’est aussi un lieu de ferveur dans les premiers temps de l’islam, comme le prouvent des inscriptions dans sa roche.
Les contours mouvants de ce désert sont au centre de l’exploration. L’approche géohistorique, qui bénéficie de 18 cartes (et de nombreuses photographies en noir et blanc) illustrant l’appropriation de ce désert par les hommes depuis la Préhistoire, déconstruit et recompose les représentations qui ont été projetées sur cet espace. Celui-ci a été pensé, par les populations qui l’habitent, par ceux qui les considèrent à leur marge (la culture arabe urbaine), et par les Européens qui en ont une connaissance plus ou moins précise, souvent moins que plus. L’une des clés de lecture majeures de l’espace est la toponymie, et ses héritages lointains. Si pour Hérodote (Ve siècle) l’Arabie désigne un espace de part et d’autre de l’actuelle mer Rouge, elle est pour Xénophon (IVe siècle) un espace bien plus au Nord. Quant à Ptolémée (IIe siècle de notre ère), il distingue une Arabie heureuse (l’actuel Yémen), une Arabie pétrée (celle des Nabatéens, autour de Petra) et une Arabie déserte. C’est cette dernière, un temps nommée par les géographes européens Hamad, qui correspond aujourd’hui peu ou prou au désert de Syrie, dont le nom est une traduction de l’arabe bâdiya al-shâm.
Les contours mouvants de ce désert sont au centre de l’exploration. L’approche géohistorique, qui bénéficie de 18 cartes (et de nombreuses photographies en noir et blanc) illustrant l’appropriation de ce désert par les hommes depuis la Préhistoire, déconstruit et recompose les représentations qui ont été projetées sur cet espace. Celui-ci a été pensé, par les populations qui l’habitent, par ceux qui les considèrent à leur marge (la culture arabe urbaine), et par les Européens qui en ont une connaissance plus ou moins précise, souvent moins que plus. L’une des clés de lecture majeures de l’espace est la toponymie, et ses héritages lointains. Si pour Hérodote (Ve siècle) l’Arabie désigne un espace de part et d’autre de l’actuelle mer Rouge, elle est pour Xénophon (IVe siècle) un espace bien plus au Nord. Quant à Ptolémée (IIe siècle de notre ère), il distingue une Arabie heureuse (l’actuel Yémen), une Arabie pétrée (celle des Nabatéens, autour de Petra) et une Arabie déserte. C’est cette dernière, un temps nommée par les géographes européens Hamad, qui correspond aujourd’hui peu ou prou au désert de Syrie, dont le nom est une traduction de l’arabe bâdiya al-shâm.
Remonter le temps
Le second dépaysement est chronologique. L’ouvrage ambitionne de couvrir l’histoire de cet espace sur la très longue durée, nécessairement fragmentée par manque de sources : du VIIe millénaire jusqu’à la première moitié du XXe siècle – l’histoire récente de cet espace n’est étrangement pas abordée. Mais il le fait à rebours, en partant de la période contemporaine. Le lecteur est accompagné dans un voyage qui aboutit aux premières traces humaines dans la région, des traces de pas vieilles de 120 000 ans découvertes dans un paléolac du Nefoud (au nord de l’Arabie saoudite). Comme un travail archéologique, ce voyage permet d’écarter progressivement les différentes couches historiques pour découvrir des vestiges effacés et insoupçonnés.
Bien que ce choix antéchronologique conduise à effacer la trame démonstrative de l’ouvrage, ainsi que les grandes évolutions qui structurent l’histoire de cet espace, la méthode du récit à rebours a une autre vertu qui la justifie : celle de déconstruire les perceptions de l’espace en remontant le temps. Une fois les automobiles disparues, le désert redevient un territoire dangereux et difficile à traverser. Les regards les plus récents s’effacent, laissent place à d’autres regards auxquels ils étaient superposés, font apparaitre des regards oubliés. Depuis la Palmyre visitée par les Européens au XIXe siècle, en plein cœur de ce désert de Syrie, les chroniques remontent au village bédouin construit au même endroit dans les ruines du Temple de Bêl, et de là à la ville gréco-romaine et à la cité de Tadmor évoquée par la Bible – et qui est toujours le nom arabe de la ville. Des villes disparues resurgissent, telle Mari qui a commencé son déclin au XVIIIe siècle avant notre ère, après avoir été saccagée par le roi Hammurabi de Babylone.
Les évidences s’estompent, et avec elle toute essentialisation de la vie au désert. Les frontières, si contemporaines et si arbitraires, qui pourtant peuvent nous paraître évidentes, disparaissent après quelques chroniques. L’islamité de cet espace n’a plus rien d’une évidence, et les palais omeyades du désert, comme les bains du Qusayr ‘amra et leurs magnifiques fresques, construits en un temps où l’aridité était moins prégnante, ont beaucoup à apprendre sur les premiers temps de l’islam. Les civilisations sont enjambées, ce qui contraint à jongler avec les langues et les étymologies. Des éléments de continuité sont également révélés, comme les kites (cerfs-volants en anglais), ces immenses pièges à gibier en pierre dont l’usage, encore attesté au XXe siècle, remonterait au IVe millénaire.
Bien que ce choix antéchronologique conduise à effacer la trame démonstrative de l’ouvrage, ainsi que les grandes évolutions qui structurent l’histoire de cet espace, la méthode du récit à rebours a une autre vertu qui la justifie : celle de déconstruire les perceptions de l’espace en remontant le temps. Une fois les automobiles disparues, le désert redevient un territoire dangereux et difficile à traverser. Les regards les plus récents s’effacent, laissent place à d’autres regards auxquels ils étaient superposés, font apparaitre des regards oubliés. Depuis la Palmyre visitée par les Européens au XIXe siècle, en plein cœur de ce désert de Syrie, les chroniques remontent au village bédouin construit au même endroit dans les ruines du Temple de Bêl, et de là à la ville gréco-romaine et à la cité de Tadmor évoquée par la Bible – et qui est toujours le nom arabe de la ville. Des villes disparues resurgissent, telle Mari qui a commencé son déclin au XVIIIe siècle avant notre ère, après avoir été saccagée par le roi Hammurabi de Babylone.
Les évidences s’estompent, et avec elle toute essentialisation de la vie au désert. Les frontières, si contemporaines et si arbitraires, qui pourtant peuvent nous paraître évidentes, disparaissent après quelques chroniques. L’islamité de cet espace n’a plus rien d’une évidence, et les palais omeyades du désert, comme les bains du Qusayr ‘amra et leurs magnifiques fresques, construits en un temps où l’aridité était moins prégnante, ont beaucoup à apprendre sur les premiers temps de l’islam. Les civilisations sont enjambées, ce qui contraint à jongler avec les langues et les étymologies. Des éléments de continuité sont également révélés, comme les kites (cerfs-volants en anglais), ces immenses pièges à gibier en pierre dont l’usage, encore attesté au XXe siècle, remonterait au IVe millénaire.
Habitants et usagers du désert
Qui vit dans ce désert et le parcourt ? Des populations très variées, plus difficiles que d’autres à saisir. Pour beaucoup nomades, elles laissent peu de traces, et encore moins d’écrits puisque leurs cultures sont majoritairement orales. Vincent Capdepuy reconnait qu’il est impossible de construire une « histoire à parts égales » dans le cas de ces habitants du désert qui évoluent « au bord du monde ». Ces Chroniques font donc la part belle aux récits occidentaux : des aventuriers et scientifiques de l’époque contemporaine, qui eux aussi ont quadrillé cet espace, aux Croisés, qui ont souvent emprunté les stéréotypes que les Arabes eux-mêmes avaient de ces populations.
Les habitants du désert se laissent difficilement enfermer dans des termes ou des catégories. Rares sont les noms, aussi variables que les toponymes, qui semblent leur correspondre. Sont-ils des Bédouins, des Arabes, des Saracènes – ou Sarrasins ? Ce dernier terme est d’usage très ancien dans les écrits occidentaux, avant même l’apparition de l’islam, et n’a bien sûr aucune pertinence locale. Toujours péjoratif, il a longtemps été préféré, y compris dans les récits des Croisades, à « Bédouins » ou « Arabes ». Du côté des auteurs arabes, le terme « Bédouin », c’est-à-dire celui qui vit dans la badiya, est lui-même très rare jusqu’à la période contemporaine, du moins à l’écrit ; lui est préféré… a‘râb, qui dès le Coran désigne une catégorie de la population, celle qui nomadise, et non un peuple à part entière. Dans les langues européennes, le terme Bédouin s’est imposé, peut-être par transmission orale. Pour autant, il ne faudrait pas attribuer aux Bédouins une unité et une cohérence historique qu’ils n’ont pas. Ces sociétés complexes, faites avant toute de petits pouvoirs éclatés et tribaux, ont leur histoire, bien qu’elle ait souvent été oubliée. Qui sont par exemple ces « Sleybs », catégorie particulière de nomades, aujourd’hui disparus et sur lesquels peu de témoignages existent, si ce n’est pour dire qu’ils vivent à la marge de la marge et constituent en quelque sorte les « Bédouins des Bédouins » ?
Ces populations du désert représentent pour tous ceux qui en parlent une altérité forte. Sous la plume du philosophe médiéval Ibn Khaldoun, la badâwa s’oppose à la hadara, deux termes que l’on peut traduire, très imparfaitement, par bédouinisme et civilisation. À l’époque contemporaine, leur nomadisme est considéré comme un anachronisme incompatible avec la modernité, et les autorités des nouveaux États tentent de la circonscrire. Mais les Bédouins n’en continuent pas moins de fasciner, et véhiculent une image stéréotypée de liberté et d’insoumission parfois violente que les Arabes ont transmises aux Européens.
Les habitants du désert se laissent difficilement enfermer dans des termes ou des catégories. Rares sont les noms, aussi variables que les toponymes, qui semblent leur correspondre. Sont-ils des Bédouins, des Arabes, des Saracènes – ou Sarrasins ? Ce dernier terme est d’usage très ancien dans les écrits occidentaux, avant même l’apparition de l’islam, et n’a bien sûr aucune pertinence locale. Toujours péjoratif, il a longtemps été préféré, y compris dans les récits des Croisades, à « Bédouins » ou « Arabes ». Du côté des auteurs arabes, le terme « Bédouin », c’est-à-dire celui qui vit dans la badiya, est lui-même très rare jusqu’à la période contemporaine, du moins à l’écrit ; lui est préféré… a‘râb, qui dès le Coran désigne une catégorie de la population, celle qui nomadise, et non un peuple à part entière. Dans les langues européennes, le terme Bédouin s’est imposé, peut-être par transmission orale. Pour autant, il ne faudrait pas attribuer aux Bédouins une unité et une cohérence historique qu’ils n’ont pas. Ces sociétés complexes, faites avant toute de petits pouvoirs éclatés et tribaux, ont leur histoire, bien qu’elle ait souvent été oubliée. Qui sont par exemple ces « Sleybs », catégorie particulière de nomades, aujourd’hui disparus et sur lesquels peu de témoignages existent, si ce n’est pour dire qu’ils vivent à la marge de la marge et constituent en quelque sorte les « Bédouins des Bédouins » ?
Ces populations du désert représentent pour tous ceux qui en parlent une altérité forte. Sous la plume du philosophe médiéval Ibn Khaldoun, la badâwa s’oppose à la hadara, deux termes que l’on peut traduire, très imparfaitement, par bédouinisme et civilisation. À l’époque contemporaine, leur nomadisme est considéré comme un anachronisme incompatible avec la modernité, et les autorités des nouveaux États tentent de la circonscrire. Mais les Bédouins n’en continuent pas moins de fasciner, et véhiculent une image stéréotypée de liberté et d’insoumission parfois violente que les Arabes ont transmises aux Européens.