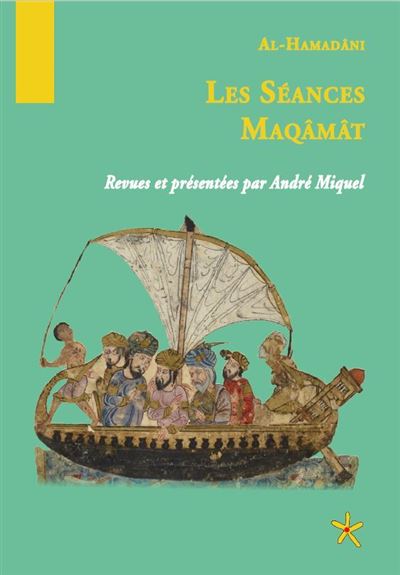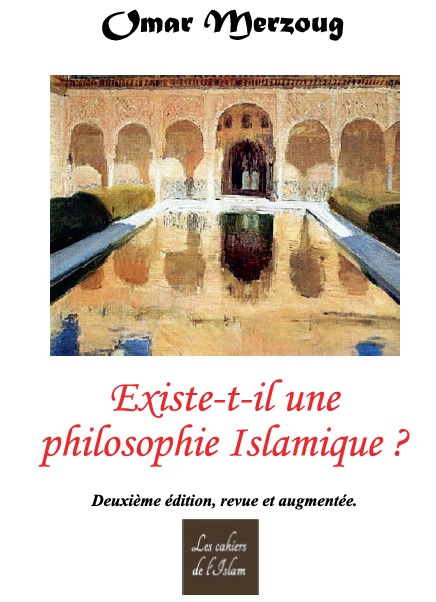Les Séances Maqâmât Les Maqâmât ou Séances sont un genre littéraire classique du X° siècle du Proche Orient. Ce sont des saynètes enlevées ou le narrateur dialogue avec un vagabond bohème, fripon mais sage pour s’éduquer en se divertissant. Al-Hamadâni est l’auteur de ces histoires piquantes superbement illustrées par Al-Wasiti considéré comme le premier artiste arabe au XIII° siècle.
C’est un tableau complet de la vie arabe du Moyen- âge revu et préfacé par le dernier géant spécialiste de ce monde, André Miquel et soutenu par la Bibliothèque Nationale de France. L'ensemble réuni n'avait jamais été présenté en français.
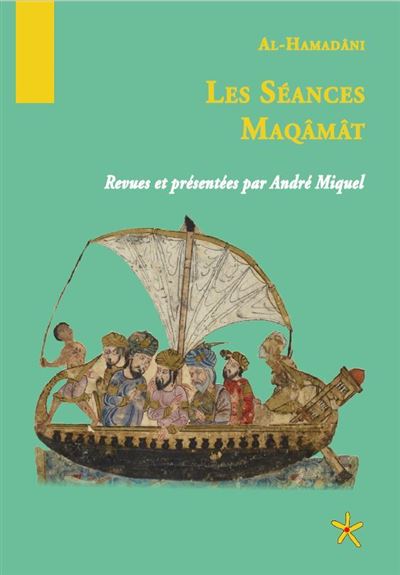
Broché: 109 pages
Editeur : Orients Editions ; 1er édition (20 novembre 2020)
Langue : Français
ISBN-13: 979-1093315195
Editeur : Orients Editions ; 1er édition (20 novembre 2020)
Langue : Français
ISBN-13: 979-1093315195
Sur L'auteur
André Miquel est normalien, professeur honoraire et administrateur du Collège de France, et ancien administrateur général de la Bibliothèque Nationale de France. Il est connu pour sa traduction des Mille et Unes nuits. Il est sans doute le plus grand arabisant actuel. Les Séances, Maqâmât est son troisième livre aux éditions Orients.
Préface d’André Miquel
En ce tournant du premier millénaire de notre ère, là-bas, vers l’Orient arabo-musulman, la chose n’est pas simple pour qui aspire à faire œuvre littéraire. Va pour la poésie, si l’on en a reçu le don. Mais en prose ? Le champ, immense, est déjà occupé : sans parler de ce qui touche à la religion, voici l’histoire, universelle ou locale, les biographies, la géographie, les traités de théologie, grammaire ou rhétorique, les encyclopédies enfin, inspirées des règles de ce qui constitue la culture générale du temps, l’adab de l’honnête homme capable de se tenir dans le monde, de s’y exprimer correctement et d’y faire la preuve de connaissances nécessaires, à mi-chemin entre une ignorance impardonnable et les propos d’un spécialiste qui apparaitraient vite comme le signe d’une évidente cuistrerie. La règle de l’adab tiendrait ainsi en trois formules : un savoir-faire, un savoir-dire, un savoir-savoir.
Que reste-t-il, et où puiser ? Certes pas dans une autobiographie qui serait considérée comme une prétention insupportable : la seule tolérance, ici, va au poète, encore lui, au nom d’une folie, tout à fait claire ou passagère, en tout cas pardonnable comme telle. La prose, elle, n’admet l’écrivain que s’il est dépositaire d’un savoir à délivrer, selon les cas, en strict transmetteur, ou commentateur, s’il en a les moyens : rien, en tout cas, qui s’affiche comme la part imprescriptible et unique d’un moi.
Que reste-t-il, décidément, et où puiser ? La réponse est à chercher dans ce que nous appellerions aujourd’hui enquête ou reportage. Mais de quel côté ? Certainement pas – ou alors par pur hasard et rarement – chez les habitants des campagnes, que l’on ne connait alors qu’à travers les nécessités de l’approvisionnement ou l’impôt, ni dans la steppe nomade, dont on n’a retenu que la vieille poésie.
La source, il faut la chercher ailleurs, dans les villes, les grandes villes. Le pouvoir du calife de Bagdad, déjà compromis avec sa mise sous tutelle par les prétoriens turcs, se retrouve plus ébranlé encore par l’apparition, au sommet de l’État, d’une dynastie iranienne, les Bûyides, qui renvoient le chef suprême du monde arabo-musulman à une autorité spirituelle et symbolique. Les Iraniens ne font ainsi qu’accentuer un processus d’éclatement de l’empire largement entamé, avant même leur arrivée, par la proclamation d’États indépendants ou théoriquement vassaux, de l’Espagne à l’Égypte, la Syrie et l’Iran même, où d’autres dynasties contestent le pouvoir bûyide.
Ainsi émergent ou se confirment, à côté de Bagdad et sans parler de la lointaine Cordoue, des villes dépositaires d’un pouvoir politique et fortifiées dans leur rôle de centres économiques et culturels, telles Le Caire, Damas, Alep, Balkh ou Nîshâpûr. On pourrait croire, à lire le nom de ces deux dernières, que l’heure de l’Iran a sonné du côté culturel autant que politique, mais pas tout à fait encore : l’arabe continue à maintenir une suprématie que nul ou presque ne lui conteste, et d’abord par nombre d’Iraniens eux-mêmes, soucieux de jouer leur jeu dans les échanges et débats intellectuels, par l’usage d’une langue confirmée comme celle du monde musulman tout entier, à commencer par ces grandes villes qui en sont le cœur.
La chose est donc claire : à qui veut écrire en prose, hors des champs traditionnels évoqués en commençant, c’est du côté de la ville qu’il faudra chercher l’inspiration, dans le spectacle des comportements, caractères ou classes sociales, le tout illustré, à l’occasion, par tel personnage particulièrement significatif, et le tout aussi d’une façon suffisamment originale, écriture en tête, afin d’attirer l’attention d’un prince ou autre mécène qui vous recevra en son salon.
Ainsi se tisse la toile de fond de ce que l’on appellera la maqâma, la ‘’séance’’ où se retrouvent les habitués des lieux, friands de bonnes histoires, mais lesquelles ? Aux IXè-Xè siècles, des auteurs et notamment le plus célèbre, Jâhiz, nous ouvrent ici quelques perspectives, par des recueils où passent, à côté des avares et des esclaves-chanteuses, deux personnages-clés de la future maqâma : le truand plus ou moins repenti et le mendiant, vrai ou faux ascète, l’un et l’autre s’imposant par la démonstration de ce bien-dire qui est l’une des règles de l’adab, et dont ils vont faire la preuve dans le cercle choisi où les a appelés un renom qui courait déjà les rues.
Il ne manquait plus à la maqâma qu’un véritable fondateur, celui qui marquerait de son empreinte et un genre et son style. Il s’appelait Hamadhânî, du nom de sa ville natale, Hamadhân, l’ancienne Ecbatane, au plein coeur de l’Iran. D’origine arabe, mais faisant montre très tôt d’aptitudes remarquables en persan autant qu’en sa langue même, il va vivre une quarantaine d’années de part et d’autre de l’an mil. A vingt-deux ans, il quitte Hamadhân en quête de protecteurs, pour ar-Rayy, près de l’actuelle Téhéran, puis Jurjân, sur les rivages sud-est de la mer Caspienne, Nishâpûr, qui voit l’épanouissement de sa carrière, puis d’autres villes où princes et gouverneurs le fêtent et l’enrichissent, Herât enfin, jusqu’à ce jour de février 1008 où, sentant sa fin proche, il s’en remet à Dieu sur ces simples mots : « Me voici ! » Il venait de marquer, avec ses Séances, l’une des dates majeures de la littérature arabe, au moment même où l’Iran, sur ses terres et en sa langue propres, signait son entrée dans le patrimoine universel avec Firdôsî et son Livre des Rois, une épopée de plus de soixante mille vers.
Que reste-t-il, et où puiser ? Certes pas dans une autobiographie qui serait considérée comme une prétention insupportable : la seule tolérance, ici, va au poète, encore lui, au nom d’une folie, tout à fait claire ou passagère, en tout cas pardonnable comme telle. La prose, elle, n’admet l’écrivain que s’il est dépositaire d’un savoir à délivrer, selon les cas, en strict transmetteur, ou commentateur, s’il en a les moyens : rien, en tout cas, qui s’affiche comme la part imprescriptible et unique d’un moi.
Que reste-t-il, décidément, et où puiser ? La réponse est à chercher dans ce que nous appellerions aujourd’hui enquête ou reportage. Mais de quel côté ? Certainement pas – ou alors par pur hasard et rarement – chez les habitants des campagnes, que l’on ne connait alors qu’à travers les nécessités de l’approvisionnement ou l’impôt, ni dans la steppe nomade, dont on n’a retenu que la vieille poésie.
La source, il faut la chercher ailleurs, dans les villes, les grandes villes. Le pouvoir du calife de Bagdad, déjà compromis avec sa mise sous tutelle par les prétoriens turcs, se retrouve plus ébranlé encore par l’apparition, au sommet de l’État, d’une dynastie iranienne, les Bûyides, qui renvoient le chef suprême du monde arabo-musulman à une autorité spirituelle et symbolique. Les Iraniens ne font ainsi qu’accentuer un processus d’éclatement de l’empire largement entamé, avant même leur arrivée, par la proclamation d’États indépendants ou théoriquement vassaux, de l’Espagne à l’Égypte, la Syrie et l’Iran même, où d’autres dynasties contestent le pouvoir bûyide.
Ainsi émergent ou se confirment, à côté de Bagdad et sans parler de la lointaine Cordoue, des villes dépositaires d’un pouvoir politique et fortifiées dans leur rôle de centres économiques et culturels, telles Le Caire, Damas, Alep, Balkh ou Nîshâpûr. On pourrait croire, à lire le nom de ces deux dernières, que l’heure de l’Iran a sonné du côté culturel autant que politique, mais pas tout à fait encore : l’arabe continue à maintenir une suprématie que nul ou presque ne lui conteste, et d’abord par nombre d’Iraniens eux-mêmes, soucieux de jouer leur jeu dans les échanges et débats intellectuels, par l’usage d’une langue confirmée comme celle du monde musulman tout entier, à commencer par ces grandes villes qui en sont le cœur.
La chose est donc claire : à qui veut écrire en prose, hors des champs traditionnels évoqués en commençant, c’est du côté de la ville qu’il faudra chercher l’inspiration, dans le spectacle des comportements, caractères ou classes sociales, le tout illustré, à l’occasion, par tel personnage particulièrement significatif, et le tout aussi d’une façon suffisamment originale, écriture en tête, afin d’attirer l’attention d’un prince ou autre mécène qui vous recevra en son salon.
Ainsi se tisse la toile de fond de ce que l’on appellera la maqâma, la ‘’séance’’ où se retrouvent les habitués des lieux, friands de bonnes histoires, mais lesquelles ? Aux IXè-Xè siècles, des auteurs et notamment le plus célèbre, Jâhiz, nous ouvrent ici quelques perspectives, par des recueils où passent, à côté des avares et des esclaves-chanteuses, deux personnages-clés de la future maqâma : le truand plus ou moins repenti et le mendiant, vrai ou faux ascète, l’un et l’autre s’imposant par la démonstration de ce bien-dire qui est l’une des règles de l’adab, et dont ils vont faire la preuve dans le cercle choisi où les a appelés un renom qui courait déjà les rues.
Il ne manquait plus à la maqâma qu’un véritable fondateur, celui qui marquerait de son empreinte et un genre et son style. Il s’appelait Hamadhânî, du nom de sa ville natale, Hamadhân, l’ancienne Ecbatane, au plein coeur de l’Iran. D’origine arabe, mais faisant montre très tôt d’aptitudes remarquables en persan autant qu’en sa langue même, il va vivre une quarantaine d’années de part et d’autre de l’an mil. A vingt-deux ans, il quitte Hamadhân en quête de protecteurs, pour ar-Rayy, près de l’actuelle Téhéran, puis Jurjân, sur les rivages sud-est de la mer Caspienne, Nishâpûr, qui voit l’épanouissement de sa carrière, puis d’autres villes où princes et gouverneurs le fêtent et l’enrichissent, Herât enfin, jusqu’à ce jour de février 1008 où, sentant sa fin proche, il s’en remet à Dieu sur ces simples mots : « Me voici ! » Il venait de marquer, avec ses Séances, l’une des dates majeures de la littérature arabe, au moment même où l’Iran, sur ses terres et en sa langue propres, signait son entrée dans le patrimoine universel avec Firdôsî et son Livre des Rois, une épopée de plus de soixante mille vers.
Sur les quelque quatre cents Séances de Hamadhânî, cinquante-deux seulement nous sont parvenues : trop peu au regard de l’œuvre, et assez cependant pour nous en permettre une juste idée. Le texte des Séances est dit par un narrateur, Îsâ Ibn Hishâm, dont Hamadhânî, assistant à ce genre de réunions, ne ferait que rapporter les propos : on aura deviné que c’est lui-même qui a écrit le texte qu’il prétend avoir entendu et recueilli. Encore n’est-ce pas tout, car Îsâ se fait volontiers transmetteur lui-même des actes et propos d’un autre personnage, Abû l-Fath al-Iskandarî, faux mendiant affilié à la truanderie, et parfaite machine à duper tous les représentants d’excès ou de ridicules, bourgeois en tête.
Îsâ ou Abû l-Fath, au bout du compte, peu importe : c’est Hamadhânî, toujours, qui parle et signe ces récits d’un style appelé à faire date : l’adab y dicte la règle d’un savoir tout à la fois assez large et maîtrisé pour être reçu et communiqué à son tour, ce qui impose, toujours dans le même esprit, un bien-dire synonyme d’élégance non moins surveillée que le contenu. D’où le recours aux métaphores et autres images, sans parler de passages en poésie ou prose rythmée et rimée, la première étant là comme pour confirmer de son prestige le statut d’un écrit élevé à la hauteur d’une littérature, et l’autre comme un hommage au texte, fondateur ici comme en toute chose, du Coran qui en avait ouvert la voie : une voie que l’on ne suivra qu’avec mesure, et par respect, dirait-on, pour la forme du texte divin, autant que pour son message même, d’une maqâma à l’autre.
Hamadhânî a-t-il eu des successeurs ? Sans doute, si l’on s’en rapporte à la forme même de la maqâma, mais quant au contenu, il tourne résolument à des thèmes religieux avec, entre autres, le théologien Ghazalî (mort en 1111). Quant à l’art d’écrire, on regardera vers une autre célébrité, Harîrî (m. en 1122), qui se dit lui-même imitateur de Hamadhânî. Avec lui, l’art de la recherche stylistique dépasse, d’un certain point de vue, celui du maître, mais si le mérite du disciple reste incontestable, il fixe aussi l’extrême limite d’un genre derrière lequel, décidément, le sujet s’efface au profit du dire.
Les faits sont là, en tout cas : si la maqâma pousse de nombreux prolongements, jusqu’en Espagne et en plusieurs langues, persan, syriaque ou hébreu, ces rameaux-là n’en témoignent pas moins d’un essoufflement que seul le talent d’un Harîrî pouvait encore arriver à masquer. Et lorsque, au tournant des XIXe-XXe siècles, l’Egyptien Muwaylihî remémore, d’une plume au reste remarquable, le souvenir du héros de Hamadhânî avec son Récit de Îsâ Ibn Hishâm inspiré cette fois de situations et personnages de son époque à lui, une autre page est déjà ouverte avec les traductions des œuvres étrangères, qui suscitent, dans les lettres arabes, l’éclosion de ces nouveaux genres qui ont nom roman ou nouvelle. Hamadhânî était salué comme la merveille de son temps, mais les temps avaient changé.
Cette préface s’inspire largement de celle qui ouvre la traduction d’un choix de Séances par Régis Blachère et Pierre Masnou (Paris, Klincksieck, 1957). Les notes de cette traduction ont été réduites au minimum indispensable pour l’éclaircissement éventuel du texte. Celui-ci par ailleurs n’a été modifié que rarement, dans le même souci d’une meilleure compréhension.
Îsâ ou Abû l-Fath, au bout du compte, peu importe : c’est Hamadhânî, toujours, qui parle et signe ces récits d’un style appelé à faire date : l’adab y dicte la règle d’un savoir tout à la fois assez large et maîtrisé pour être reçu et communiqué à son tour, ce qui impose, toujours dans le même esprit, un bien-dire synonyme d’élégance non moins surveillée que le contenu. D’où le recours aux métaphores et autres images, sans parler de passages en poésie ou prose rythmée et rimée, la première étant là comme pour confirmer de son prestige le statut d’un écrit élevé à la hauteur d’une littérature, et l’autre comme un hommage au texte, fondateur ici comme en toute chose, du Coran qui en avait ouvert la voie : une voie que l’on ne suivra qu’avec mesure, et par respect, dirait-on, pour la forme du texte divin, autant que pour son message même, d’une maqâma à l’autre.
Hamadhânî a-t-il eu des successeurs ? Sans doute, si l’on s’en rapporte à la forme même de la maqâma, mais quant au contenu, il tourne résolument à des thèmes religieux avec, entre autres, le théologien Ghazalî (mort en 1111). Quant à l’art d’écrire, on regardera vers une autre célébrité, Harîrî (m. en 1122), qui se dit lui-même imitateur de Hamadhânî. Avec lui, l’art de la recherche stylistique dépasse, d’un certain point de vue, celui du maître, mais si le mérite du disciple reste incontestable, il fixe aussi l’extrême limite d’un genre derrière lequel, décidément, le sujet s’efface au profit du dire.
Les faits sont là, en tout cas : si la maqâma pousse de nombreux prolongements, jusqu’en Espagne et en plusieurs langues, persan, syriaque ou hébreu, ces rameaux-là n’en témoignent pas moins d’un essoufflement que seul le talent d’un Harîrî pouvait encore arriver à masquer. Et lorsque, au tournant des XIXe-XXe siècles, l’Egyptien Muwaylihî remémore, d’une plume au reste remarquable, le souvenir du héros de Hamadhânî avec son Récit de Îsâ Ibn Hishâm inspiré cette fois de situations et personnages de son époque à lui, une autre page est déjà ouverte avec les traductions des œuvres étrangères, qui suscitent, dans les lettres arabes, l’éclosion de ces nouveaux genres qui ont nom roman ou nouvelle. Hamadhânî était salué comme la merveille de son temps, mais les temps avaient changé.
Cette préface s’inspire largement de celle qui ouvre la traduction d’un choix de Séances par Régis Blachère et Pierre Masnou (Paris, Klincksieck, 1957). Les notes de cette traduction ont été réduites au minimum indispensable pour l’éclaircissement éventuel du texte. Celui-ci par ailleurs n’a été modifié que rarement, dans le même souci d’une meilleure compréhension.