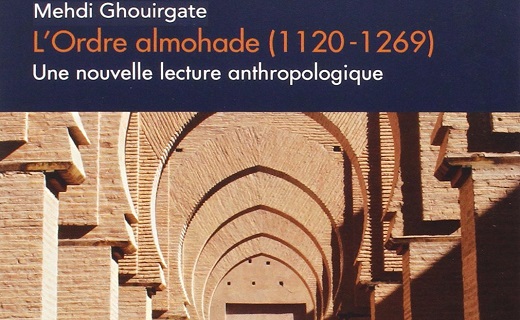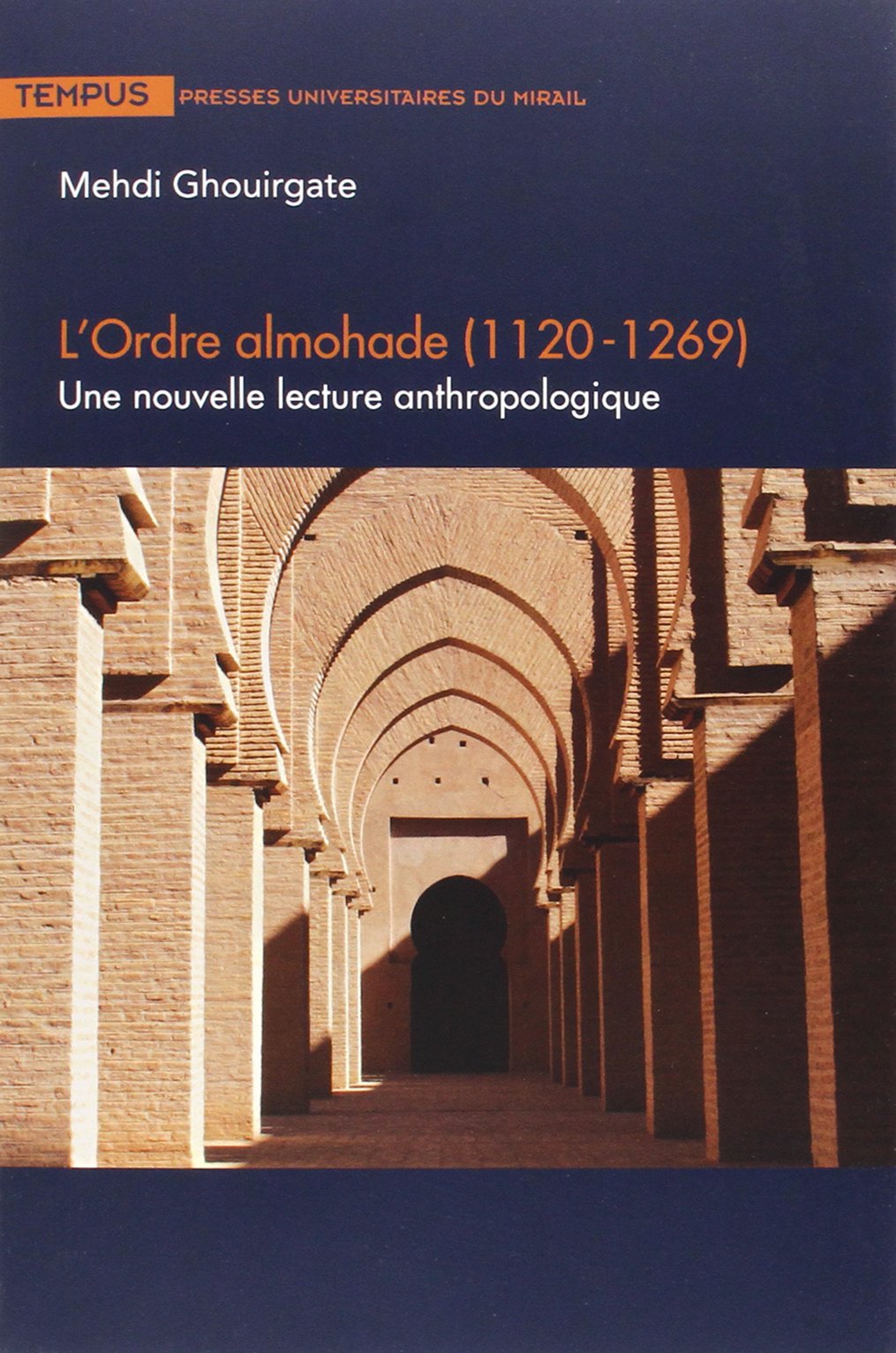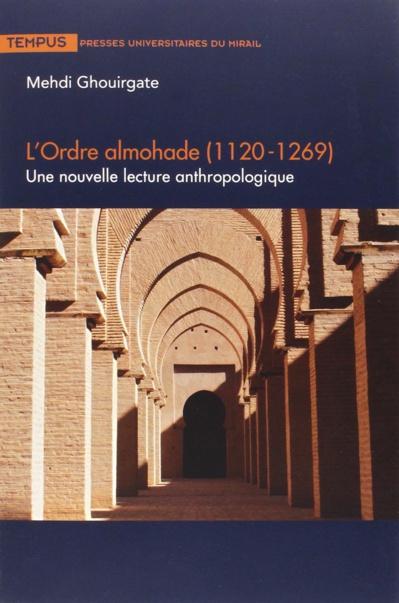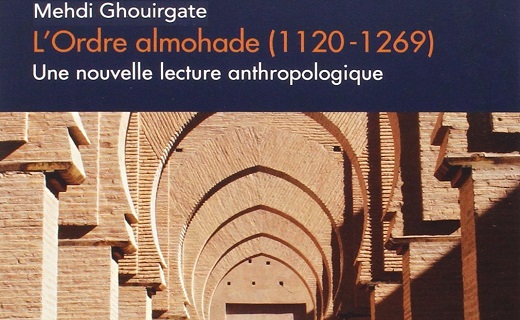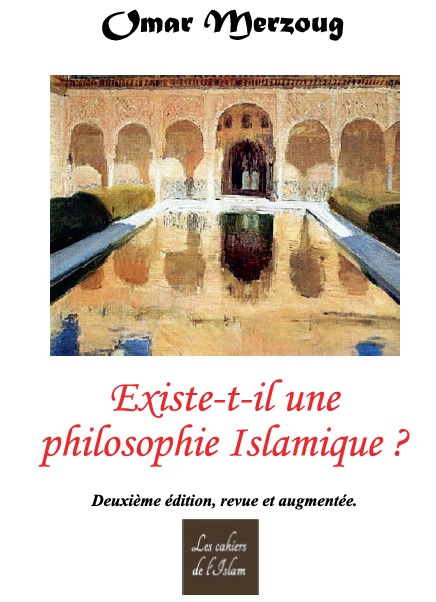Écrit avec élégance, nourri par une grande curiosité intellectuelle, L’Ordre almohade témoigne de l’intérêt d’une démarche historique comparatiste, ouverte sur les sciences sociales, pour comprendre les sociétés maghrébines. Cet ouvrage marquera sans aucun doute l’historiographie de la question almohade comme celle du Maghreb médiéval, mais ouvrira aussi des portes à quiconque s’intéresse à l’imaginaire politique et à sa mise en scène.
Cyrille Aillet
Université Lyon 2, CIHAM-UMR 5648, IUF.
Cette recension a déjà fait l'objet d'une publication dans la Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée , 141 | juin 2017 sous licence Creative Commons (BY NC SA).
Broché: 509 pages
Editeur : Presses Universitaires du Mirail (28 novembre 2014)
Collection : Studies in Comparative Religion
Langue : Français
ISBN-13: 978-2810702817
Editeur : Presses Universitaires du Mirail (28 novembre 2014)
Collection : Studies in Comparative Religion
Langue : Français
ISBN-13: 978-2810702817
Par Cyrille Aillet
Issu d’une thèse de doctorat réalisée sous la direction de Philippe Sénac, L’Ordre almohade participe au renouvellement récent, d’ailleurs toujours en cours, de l’histoire de cette dynastie berbère qui sut unifier politiquement et culturellement l’Occident islamique autour d’un projet califal inédit. Dans l’introduction, l’auteur rend justice à une historiographie foisonnante en éclairant en particulier les enjeux nationaux qu’elle revêt au Maroc. Cependant, parler d’une « hégémonie » espagnole (p. 25) peut sembler maladroit, dans la mesure où les réalisations des années 1990-2000, notamment la somme – d’ailleurs coéditée par Patrice Cressier – de Los Almohades: problemas y perspectivas (2005), sont le fruit de collaborations résolument internationales. Plus marquante sans doute que les appartenances nationales des chercheurs, l’évolution des approches et des thématiques aurait peut-être mérité de plus amples développements. La démarche de l’auteur, qui se place dans le sillage d’une histoire inspirée par l’anthropologie, n’en est pas moins pertinente : écrire une histoire des Almohades depuis le Maghreb, et non à partir du seul tropisme andalou, tout en répudiant la vision encore tenace d’un monde figé dans l’immobilisme et dans l’altérité. Profondément imprégnée par la sémantique des sociétés maghrébines et berbères, la geste almohade n’en puise pas moins ses prétentions à l’universalité dans les références communes de l’imaginaire politique islamique. Mehdi Ghouirgate prend donc le parti, salutaire, d’aborder la galerie des grandes figures du mouvement, parmi lesquelles il retient surtout le Mahdī Ibn Tūmart et les trois premiers califes, comme autant de portraits édifiants composés au moins partiellement à partir des plus prestigieuses « réminiscences » du passé de l’Islam. « L’ordre almohade » transparaît à travers l’écriture, mais également dans la gestuelle du prince et l’organisation du cérémonial, ainsi que dans les manifestations les plus ostensibles de l’autorité, telles que les dons, l’évergétisme, ou l’exercice parfois sanglant de la justice... L’auteur ne se limite pas à une sémiotique du récit, il s’intéresse surtout aux pratiques concrètes de l’État, c’est-à-dire pour l’essentiel aux représentations du souverain en acte et aux moments solennels qui scandent son existence. Derrière cette mise en scène, il n’ignore pas que se cachent des enjeux concrets, à savoir le maintien de l’autorité, l’étouffement des dissensions et le contrôle des populations. Toutes perspectives qui pourront sembler familières aux spécialistes du Moyen Âge occidental, mais qui mettent plus de temps à s’imposer dans le champ des études historiques sur le Maghreb. Le Maroc semble cependant avoir été mieux servi en la matière, et l’apport méthodologique de travaux comme ceux de Jocelyne Dakhlia ou de Serge Gubert, dont l’auteur est par ailleurs familier, aurait pu être souligné dans le préambule. Il n’en reste pas moins que ce livre est une mine pour qui s’intéresse à l’histoire des sociétés maghrébines médiévales, dans leurs aspects les plus solennels comme dans le fourmillement de la vie quotidienne. Car l’un des grands atouts de l’auteur est de donner tout leur sens non seulement aux textes arabes (qu’il examine en croisant les traditions maghrébines, andalouses et orientales), mais aussi aux nombreux termes et noms berbères qu’ils contiennent, ainsi qu’aux phrases entières qui proviennent de cet univers linguistique intimement lié à l’arabe au Maghreb. Il éclaire ainsi de manière parfois surprenante et novatrice l’histoire intime d’un pouvoir que l’on a parfois artificiellement arraché à son contexte linguistique d’origine. De même que les historiens pressés ignorent souvent la teneur littéraire des textes qu’ils utilisent à des fins documentaires, les spécialistes du Maghreb passent souvent à côté de cet entrelacement linguistique.
Divisé en neuf chapitres, l’ouvrage débute par une enquête sur le « précédent almoravide » qui, bien qu’il ait été désigné comme un anti-modèle par les Almohades, leur a également servi de « substrat » politique, en réalité. La démarche de l’auteur consiste à déchiffrer les configurations politiques qui permettent à l’État de se construire dans un milieu fondamentalement tribal et « acéphale », c’est-à-dire gouverné pour l’essentiel par les populations elles-mêmes, rétives à accepter toute forme de hiérarchie imposée de l’extérieur. Dans une longue discussion (pp. 72-102), il revient d’ailleurs avec précision sur le thème de la « rupture » almohade : largement mise en avant par le « dispositif propagandiste » de la dynastie, elle ne peut occulter le fait que le pouvoir almohade s’est largement glissé dans les structures établies par ses adversaires, choisissant par exemple de s’installer à Marrakech. Dans les deux mouvements, la daʻwa religieuse et le charisme de l’imam servent de ciment à une société segmentaire, de même que l’instauration d’une structure de commandement bicéphale (l’imam et son émir, ou calife) associe étroitement l’œuvre de conquête et de renforcement de l’État au prosélytisme religieux. De leurs origines sahariennes, les Almoravides conservent un insigne de distinction, le voile facial ou lithām, mais c’est à la sémantique des grands pouvoirs méditerranéens (notamment andalou) qu’ils empruntent leurs marques de prestige : cérémonies officielles, acquisition d’esclaves, adoption de vêtements d’apparat et de bannières spécifiques, usage de la maqṣūra dans les mosquées, organisation de banquets, « éclat des supplices » infligés aux rebelles, faste des ensembles palatins… Tout en identifiant les insignes d’autorité sur lesquels il s’appuiera dans la suite de sa recherche, l’auteur rompt avec la réputation de frugalité des Almoravides pour intégrer cette image à une dialectique plus complexe de construction de l’État. La référence à la théorie khaldounienne semble ici sous-jacente, ce qui aurait peut-être mérité une confrontation plus explicite avec ce modèle extrêmement structuré d’explication du politique.
Commence ensuite un cheminement à travers les principaux rites du régime, à commencer par l’intronisation (ch. II). Le lecteur sera agréablement surpris de débuter cette lecture par un plat, l’asmās, peut-être un type de couscous, qu’Ibn Tūmart partage avec ses compagnons dans leur première demeure, Igīlīz des Hargha, pour sceller leur union. C’est là un bon exemple de la fraîcheur et de l’agilité d’esprit de l’auteur, qui mène d’abord une enquête lexicographique pour identifier ce mets, puis va chercher dans la description du maʻrūf, dédié par les populations du Haut Atlas occidental à leur saint local, des clefs d’explication de la description d’al-Baydhaq au xiie siècle. Après avoir évoqué le rôle matriciel des origines, dont il aurait pu étudier de manière plus systématique les rapports avec la geste prophétique, l’auteur expose ensuite la conception almohade du serment d’allégeance. Celui-ci se déroulait d’abord en public (bayʻa ʻāmma), dans différents lieux de la capitale et en compagnie des « Almohades de rang inférieur » et de la population, puis en « privé » (bayʻa khāṣṣa), en présence des élites mu’minides et almohades. Les gestes, les phases, les paroles et les sons (notamment de tambours), ainsi que les échanges de dons qui constituent ces deux moments forts du rituel politique sont minutieusement déchiffrés.
Grand moment d’une enquête qui sait se montrer gourmande, le ch. III aborde à nouveau la signification politique et sociale des banquets dans la construction de l’image d’un « souverain nourricier ». De gigantesques agapes, où coulent parfois de véritables « rivières » de jus de raisin cuit, sont offertes pour célébrer les victoires ou souder les troupes avant le départ pour la guerre, créant une temporalité politique autre que celle des fêtes religieuses. Tandis que le saint distribue sa baraka aux fidèles, le souverain est campé en père nourricier, et une « maison des hôtes » est dédiée à l’hospitalité dans le palais de Marrakesh. Belles pages, également, celles qui décrivent l’inventivité des cuisines califales, d’où sortent des recettes spécifiquement associées à l’élite almohade, riches en épices, en couleurs ou en viandes, comme le fameux tharīd, « mets de rois et de vizirs » (p. 176). Mais surtout, la force de ce détour par l’histoire de l’alimentation est de souligner l’opposition entre le paradigme de la « cuisine des saints », maigre, frugale et élémentaire, et celui de la « cuisine royale » qui manifeste la générosité du souverain, pourtant fréquemment accusé de prédation par les milieux soufis.
Un bref chapitre porte ensuite sur les dons de vêtements d’apparat, prérogative du pouvoir califal depuis les Abbassides, et sur le costume comme marqueur des préséances (ch. IV). Puis l’auteur aborde l’un de ses thèmes les plus novateurs : la promotion, au moins partielle, du berbère comme langue officielle sous les Almohades (ch. V). Reprenant à Jack Goody cette expression, il estime que les mu’minides évoluent au départ dans un milieu à « literacy restreinte, où la langue écrite n’est pas la langue vernaculaire ». L’omniscience attribuée à Ibn Tūmart n’aurait que plus de portée dans une société où l’écrit et le ʻilm seraient aussi rares que prestigieux, et où le prosélytisme almohade se rattacherait à un effort d’islamisation en profondeur des populations. Dans le cadre de cette politique d’instruction, le recours au berbère est bien attesté, notamment pour l’apprentissage du tawḥīd et pour certains discours officiels, parfois délivrés dans les deux langues. Peut-on cependant parler d’une véritable « institutionnalisation » du berbère des Maṣmūda alors que celui-ci semble plutôt réservé à l’élite gouvernante, qui entretient ainsi sa cohésion et sa distinction comme le faisaient par exemple les élites militaires turques au Proche Orient ? Cette question n’enlève rien, toutefois, à l’apport que représente cet ouvrage pour notre connaissance des usages politiques de la langue au Maghreb médiéval. Par ailleurs, l’ensemble de la démonstration prouve bien que l’on ne peut saisir les subtilités du langage symbolique almohade sans recourir au domaine culturel berbère.
L’enquête comprend aussi un chapitre remarquable sur le châtiment comme manifestation de la souveraineté (ch. VI). Le traitement du corps du supplicié, sa mutilation, sa crémation post-mortem ou son exposition jusqu’à la décomposition totale, apparaissaient comme une destruction symbolique bien plus terrible que la seule privation de vie. L’exposition des corps ou des têtes des suppliciés aux portes des palais ou de la ville de Marrakesh constituait l’épilogue de cette politique de terreur, visant à annihiler ou décourager toute révolte.
La guerre constituait pour ces souverains l’autre grand théâtre de majesté (ch. VII). Les califes almohades gardaient de leurs origines mythifiés des habitudes d’itinérance car, au moins occasionnellement, ils parcouraient leurs territoires et accompagnaient les grandes expéditions, sans participer aux combats. Le souverain ne se déplaçait pas, en temps de paix comme de guerre, sans une escorte armée dont l’ordonnancement impeccable traduisait les préséances et la structure même de l’État. Cette sāqa, « arrière-garde » en vérité première sur le plan de la dignité, comprenait les tambours et les drapeaux des Almohades, qui précédaient le cortège des cheikhs almohades et des membres de l’aristocratie mu’minide. Le calife fermait la marche, suivi par les Corans de ʻUthmān et du Mahdī Ibn Tūmart. Un soin particulier était réservé au campement du calife, l’afrāg, dont le centre était occupé par la tente du souverain, de couleur rouge, et dont l’agencement reproduisait la structure du palais de Marrakech.
Le chapitre suivant (VIII) est consacré à la nouvelle « cité aulique » construite à Marrakech, le « pays de Dieu » en berbère. Il aurait peut-être été préférable pour le lecteur que l’ouvrage commençât par une présentation de la topographie de la ville sous les Almohades, ce qui lui aurait permis de se repérer plus aisément. La réflexion se concentre tout d’abord sur la politique de remaniement urbanistique des Almohades, qui firent construire leur Grande mosquée (la Kutubiyya) sur l’emplacement d’un palais almoravide et détruisirent le premier édifice au profit d’un second, strictement identique et continu, mais orienté davantage vers le sud, conformément aux traditions omeyyades. L’auteur recueille aussi les traditions concernant le mécanisme inventé par les ingénieurs au service de ʻAbd al-Mu’min : lorsque le calife entrait dans la Grande mosquée par un passage réservé, la maqṣūra se mettait en place ; lorsqu’il quittait les lieux, le minbar apparaissait à droite du miḥrāb et l’imam pouvait y monter. Le cérémonial aulique, qui se déroulait jusqu’aux années 1180 dans l’ancienne résidence palatine de Qaṣr al-Ḥajar, remplacée ensuite par la Qaṣba, fait également l’objet d’une recherche approfondie. L’auteur éclaire tout d’abord l’importance symbolique du « seuil » du palais (sudda) dans le protocole avant d’étudier le déroulement de la fête du Sacrifice, qu’il compare aux rituels qui accompagnaient les entrées et les sorties du calife. Puis il tente d’identifier le rôle précis des ḥājib-s almohades, en montrant que cette fonction était remplie à titre temporaire par les vizirs, pour les besoins du protocole et seulement à l’extérieur du palais. Au sein du palais, il s’agissait d’une charge permanente, confiée à d’anciens esclaves, parfois reconnus comme des vizirs de rang inférieur. Faisant écho aux travaux de Paula Sanders sur le Caire fatimide, l’auteur souligne ensuite l’importance des esplanades et des places du palais (asārāg en berbère) pour la scénographie politique. Le chapitre se clôt par une évocation des jardins, image d’un eden terrestre, et des ménageries, habituelles dans les palais islamiques.
Le dernier chapitre (IX) aborde en toute logique la mort du calife et le « culte des ancêtres ». C’est l’occasion d’une belle analyse de la mise en scène de l’agonie et du « testament » du souverain, en l’occurrence al-Manṣūr (m. 1199). Malgré la minceur des témoignages, l’auteur s’attache ensuite à décrire les « funérailles royales », assez discrètes chez les Almohades qui répugnaient à tout ce qui pouvait s’apparenter au culte des saints. En revanche, Tinmal, où se trouvaient les sépultures du Mahdī et des trois premiers califes, faisait l’objet d’un pèlerinage aux sources du mouvement, et d’un culte populaire qui survécut jusqu’au xive siècle à la chute de la dynastie. Le lieu d’inhumation des autres califes, qui ne fait l’objet d’aucune divulgation dans les sources, était probablement situé, comme pour les Omeyyades, dans une rawḍa proche de la Grande mosquée.
Écrit avec élégance, nourri par une grande curiosité intellectuelle, L’Ordre almohade témoigne de l’intérêt d’une démarche historique comparatiste, ouverte sur les sciences sociales, pour comprendre les sociétés maghrébines. Cet ouvrage marquera sans aucun doute l’historiographie de la question almohade comme celle du Maghreb médiéval, mais ouvrira aussi des portes à quiconque s’intéresse à l’imaginaire politique et à sa mise en scène.
Divisé en neuf chapitres, l’ouvrage débute par une enquête sur le « précédent almoravide » qui, bien qu’il ait été désigné comme un anti-modèle par les Almohades, leur a également servi de « substrat » politique, en réalité. La démarche de l’auteur consiste à déchiffrer les configurations politiques qui permettent à l’État de se construire dans un milieu fondamentalement tribal et « acéphale », c’est-à-dire gouverné pour l’essentiel par les populations elles-mêmes, rétives à accepter toute forme de hiérarchie imposée de l’extérieur. Dans une longue discussion (pp. 72-102), il revient d’ailleurs avec précision sur le thème de la « rupture » almohade : largement mise en avant par le « dispositif propagandiste » de la dynastie, elle ne peut occulter le fait que le pouvoir almohade s’est largement glissé dans les structures établies par ses adversaires, choisissant par exemple de s’installer à Marrakech. Dans les deux mouvements, la daʻwa religieuse et le charisme de l’imam servent de ciment à une société segmentaire, de même que l’instauration d’une structure de commandement bicéphale (l’imam et son émir, ou calife) associe étroitement l’œuvre de conquête et de renforcement de l’État au prosélytisme religieux. De leurs origines sahariennes, les Almoravides conservent un insigne de distinction, le voile facial ou lithām, mais c’est à la sémantique des grands pouvoirs méditerranéens (notamment andalou) qu’ils empruntent leurs marques de prestige : cérémonies officielles, acquisition d’esclaves, adoption de vêtements d’apparat et de bannières spécifiques, usage de la maqṣūra dans les mosquées, organisation de banquets, « éclat des supplices » infligés aux rebelles, faste des ensembles palatins… Tout en identifiant les insignes d’autorité sur lesquels il s’appuiera dans la suite de sa recherche, l’auteur rompt avec la réputation de frugalité des Almoravides pour intégrer cette image à une dialectique plus complexe de construction de l’État. La référence à la théorie khaldounienne semble ici sous-jacente, ce qui aurait peut-être mérité une confrontation plus explicite avec ce modèle extrêmement structuré d’explication du politique.
Commence ensuite un cheminement à travers les principaux rites du régime, à commencer par l’intronisation (ch. II). Le lecteur sera agréablement surpris de débuter cette lecture par un plat, l’asmās, peut-être un type de couscous, qu’Ibn Tūmart partage avec ses compagnons dans leur première demeure, Igīlīz des Hargha, pour sceller leur union. C’est là un bon exemple de la fraîcheur et de l’agilité d’esprit de l’auteur, qui mène d’abord une enquête lexicographique pour identifier ce mets, puis va chercher dans la description du maʻrūf, dédié par les populations du Haut Atlas occidental à leur saint local, des clefs d’explication de la description d’al-Baydhaq au xiie siècle. Après avoir évoqué le rôle matriciel des origines, dont il aurait pu étudier de manière plus systématique les rapports avec la geste prophétique, l’auteur expose ensuite la conception almohade du serment d’allégeance. Celui-ci se déroulait d’abord en public (bayʻa ʻāmma), dans différents lieux de la capitale et en compagnie des « Almohades de rang inférieur » et de la population, puis en « privé » (bayʻa khāṣṣa), en présence des élites mu’minides et almohades. Les gestes, les phases, les paroles et les sons (notamment de tambours), ainsi que les échanges de dons qui constituent ces deux moments forts du rituel politique sont minutieusement déchiffrés.
Grand moment d’une enquête qui sait se montrer gourmande, le ch. III aborde à nouveau la signification politique et sociale des banquets dans la construction de l’image d’un « souverain nourricier ». De gigantesques agapes, où coulent parfois de véritables « rivières » de jus de raisin cuit, sont offertes pour célébrer les victoires ou souder les troupes avant le départ pour la guerre, créant une temporalité politique autre que celle des fêtes religieuses. Tandis que le saint distribue sa baraka aux fidèles, le souverain est campé en père nourricier, et une « maison des hôtes » est dédiée à l’hospitalité dans le palais de Marrakesh. Belles pages, également, celles qui décrivent l’inventivité des cuisines califales, d’où sortent des recettes spécifiquement associées à l’élite almohade, riches en épices, en couleurs ou en viandes, comme le fameux tharīd, « mets de rois et de vizirs » (p. 176). Mais surtout, la force de ce détour par l’histoire de l’alimentation est de souligner l’opposition entre le paradigme de la « cuisine des saints », maigre, frugale et élémentaire, et celui de la « cuisine royale » qui manifeste la générosité du souverain, pourtant fréquemment accusé de prédation par les milieux soufis.
Un bref chapitre porte ensuite sur les dons de vêtements d’apparat, prérogative du pouvoir califal depuis les Abbassides, et sur le costume comme marqueur des préséances (ch. IV). Puis l’auteur aborde l’un de ses thèmes les plus novateurs : la promotion, au moins partielle, du berbère comme langue officielle sous les Almohades (ch. V). Reprenant à Jack Goody cette expression, il estime que les mu’minides évoluent au départ dans un milieu à « literacy restreinte, où la langue écrite n’est pas la langue vernaculaire ». L’omniscience attribuée à Ibn Tūmart n’aurait que plus de portée dans une société où l’écrit et le ʻilm seraient aussi rares que prestigieux, et où le prosélytisme almohade se rattacherait à un effort d’islamisation en profondeur des populations. Dans le cadre de cette politique d’instruction, le recours au berbère est bien attesté, notamment pour l’apprentissage du tawḥīd et pour certains discours officiels, parfois délivrés dans les deux langues. Peut-on cependant parler d’une véritable « institutionnalisation » du berbère des Maṣmūda alors que celui-ci semble plutôt réservé à l’élite gouvernante, qui entretient ainsi sa cohésion et sa distinction comme le faisaient par exemple les élites militaires turques au Proche Orient ? Cette question n’enlève rien, toutefois, à l’apport que représente cet ouvrage pour notre connaissance des usages politiques de la langue au Maghreb médiéval. Par ailleurs, l’ensemble de la démonstration prouve bien que l’on ne peut saisir les subtilités du langage symbolique almohade sans recourir au domaine culturel berbère.
L’enquête comprend aussi un chapitre remarquable sur le châtiment comme manifestation de la souveraineté (ch. VI). Le traitement du corps du supplicié, sa mutilation, sa crémation post-mortem ou son exposition jusqu’à la décomposition totale, apparaissaient comme une destruction symbolique bien plus terrible que la seule privation de vie. L’exposition des corps ou des têtes des suppliciés aux portes des palais ou de la ville de Marrakesh constituait l’épilogue de cette politique de terreur, visant à annihiler ou décourager toute révolte.
La guerre constituait pour ces souverains l’autre grand théâtre de majesté (ch. VII). Les califes almohades gardaient de leurs origines mythifiés des habitudes d’itinérance car, au moins occasionnellement, ils parcouraient leurs territoires et accompagnaient les grandes expéditions, sans participer aux combats. Le souverain ne se déplaçait pas, en temps de paix comme de guerre, sans une escorte armée dont l’ordonnancement impeccable traduisait les préséances et la structure même de l’État. Cette sāqa, « arrière-garde » en vérité première sur le plan de la dignité, comprenait les tambours et les drapeaux des Almohades, qui précédaient le cortège des cheikhs almohades et des membres de l’aristocratie mu’minide. Le calife fermait la marche, suivi par les Corans de ʻUthmān et du Mahdī Ibn Tūmart. Un soin particulier était réservé au campement du calife, l’afrāg, dont le centre était occupé par la tente du souverain, de couleur rouge, et dont l’agencement reproduisait la structure du palais de Marrakech.
Le chapitre suivant (VIII) est consacré à la nouvelle « cité aulique » construite à Marrakech, le « pays de Dieu » en berbère. Il aurait peut-être été préférable pour le lecteur que l’ouvrage commençât par une présentation de la topographie de la ville sous les Almohades, ce qui lui aurait permis de se repérer plus aisément. La réflexion se concentre tout d’abord sur la politique de remaniement urbanistique des Almohades, qui firent construire leur Grande mosquée (la Kutubiyya) sur l’emplacement d’un palais almoravide et détruisirent le premier édifice au profit d’un second, strictement identique et continu, mais orienté davantage vers le sud, conformément aux traditions omeyyades. L’auteur recueille aussi les traditions concernant le mécanisme inventé par les ingénieurs au service de ʻAbd al-Mu’min : lorsque le calife entrait dans la Grande mosquée par un passage réservé, la maqṣūra se mettait en place ; lorsqu’il quittait les lieux, le minbar apparaissait à droite du miḥrāb et l’imam pouvait y monter. Le cérémonial aulique, qui se déroulait jusqu’aux années 1180 dans l’ancienne résidence palatine de Qaṣr al-Ḥajar, remplacée ensuite par la Qaṣba, fait également l’objet d’une recherche approfondie. L’auteur éclaire tout d’abord l’importance symbolique du « seuil » du palais (sudda) dans le protocole avant d’étudier le déroulement de la fête du Sacrifice, qu’il compare aux rituels qui accompagnaient les entrées et les sorties du calife. Puis il tente d’identifier le rôle précis des ḥājib-s almohades, en montrant que cette fonction était remplie à titre temporaire par les vizirs, pour les besoins du protocole et seulement à l’extérieur du palais. Au sein du palais, il s’agissait d’une charge permanente, confiée à d’anciens esclaves, parfois reconnus comme des vizirs de rang inférieur. Faisant écho aux travaux de Paula Sanders sur le Caire fatimide, l’auteur souligne ensuite l’importance des esplanades et des places du palais (asārāg en berbère) pour la scénographie politique. Le chapitre se clôt par une évocation des jardins, image d’un eden terrestre, et des ménageries, habituelles dans les palais islamiques.
Le dernier chapitre (IX) aborde en toute logique la mort du calife et le « culte des ancêtres ». C’est l’occasion d’une belle analyse de la mise en scène de l’agonie et du « testament » du souverain, en l’occurrence al-Manṣūr (m. 1199). Malgré la minceur des témoignages, l’auteur s’attache ensuite à décrire les « funérailles royales », assez discrètes chez les Almohades qui répugnaient à tout ce qui pouvait s’apparenter au culte des saints. En revanche, Tinmal, où se trouvaient les sépultures du Mahdī et des trois premiers califes, faisait l’objet d’un pèlerinage aux sources du mouvement, et d’un culte populaire qui survécut jusqu’au xive siècle à la chute de la dynastie. Le lieu d’inhumation des autres califes, qui ne fait l’objet d’aucune divulgation dans les sources, était probablement situé, comme pour les Omeyyades, dans une rawḍa proche de la Grande mosquée.
Écrit avec élégance, nourri par une grande curiosité intellectuelle, L’Ordre almohade témoigne de l’intérêt d’une démarche historique comparatiste, ouverte sur les sciences sociales, pour comprendre les sociétés maghrébines. Cet ouvrage marquera sans aucun doute l’historiographie de la question almohade comme celle du Maghreb médiéval, mais ouvrira aussi des portes à quiconque s’intéresse à l’imaginaire politique et à sa mise en scène.