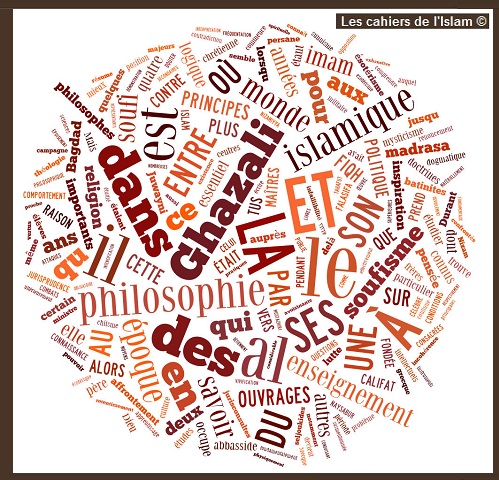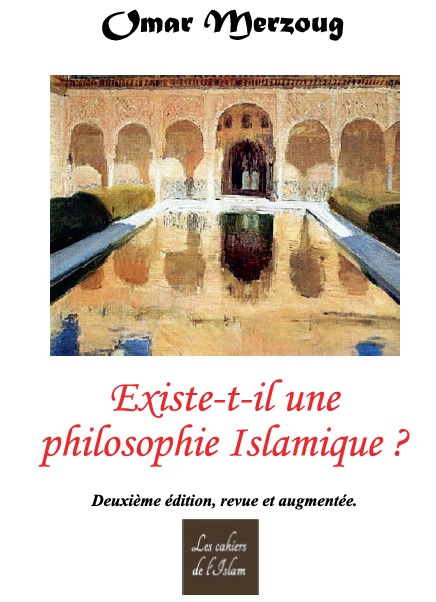Le texte suivant est tiré de Perspectives : revue trimestrielle d’éducation comparée, Paris, UNESCO : Bureau international d’éducation, vol. XXIII, n° 3-4, 1993, p. 531-555.
L'auteur : Nabil Nofal (Égypte), coordonnateur de l’Unité régionale d’innovation éducative dans les États arabes (EIPDAS/UNESCO). A enseigné les sciences de l’éducation dan s plusieurs universités arabes avant de devenir expert en administration, planification et économie de l’éducation pour l’UNESCO. Auteur de nombreuses publications et de traductions sur l’éducation et la culture.
L'auteur : Nabil Nofal (Égypte), coordonnateur de l’Unité régionale d’innovation éducative dans les États arabes (EIPDAS/UNESCO). A enseigné les sciences de l’éducation dan s plusieurs universités arabes avant de devenir expert en administration, planification et économie de l’éducation pour l’UNESCO. Auteur de nombreuses publications et de traductions sur l’éducation et la culture.
Jusqu’à une époque fort récente, la pensée islamique représentée par al-Ghazali constituait le courant dominant dans la théorie et la pratique de l’islam (sunnite en particulier). Ce géant de la pensée, au savoir encyclopédique, a influé sur la pensée islamique et défini sa pratique pendant près de neuf siècles. Il représentait « l’islam pacifique ».
Depuis une trentaine d’années, un nouveau courant, celui de « l’islam combattant », a vu le jour, s’est développé rapidement et a entrepris de s’imposer dans le monde islamique. Certains y voient une renaissance et d’autres une menace, non seulement pour le monde islamique mais pour le monde entier, un facteur de déstabilisation qui ramène l’islam et les musulmans quatorze siècles en arrière. Ce nouveau courant trouve ses sources intellectuelles dans les enseignements d’Abou al-Ala al-Mawdudi, de Sayid Qotb et de Ruhallah Khomeini, et de leurs disciples rigoristes disséminés dans de nombreux pays. Il préconise la rédemption de la société, l’élimination par la force des régimes en place, la prise du pouvoir et un changement radical de la vie sociale. Réfractaires, voire hostiles, à la civilisation moderne, ses adeptes voient dans l’islam — tel qu’il était pensé et pratiqué il y a de nombreux siècle — la solution à tous les problèmes politiques, économiques, sociaux, culturels et éducatifs dont souffre le monde arabo-islamique, sinon toute la planète. La lutte entre la pensée d’al-Ghazali et celle d’al-Mawdudi continue, et elle constitue sans doute un des principaux facteurs appelés à façonner l’avenir du monde arabo-islamique.
Quelle que soit l’issue de cette lutte, al-Ghazali demeure l’un des plus grands philosophes (bien qu’il s’en soit lui-même défendu) et penseurs de l’éducation dans l’histoire du monde islamique. Sa vie — élève assoiffé de savoir, puis enseignant dispensant le savoir, puis savant développant le savoir — illustre bien ce qu’était la vie des étudiants, des enseignants et des savants dans le monde islamique au Moyen Âge.
Depuis une trentaine d’années, un nouveau courant, celui de « l’islam combattant », a vu le jour, s’est développé rapidement et a entrepris de s’imposer dans le monde islamique. Certains y voient une renaissance et d’autres une menace, non seulement pour le monde islamique mais pour le monde entier, un facteur de déstabilisation qui ramène l’islam et les musulmans quatorze siècles en arrière. Ce nouveau courant trouve ses sources intellectuelles dans les enseignements d’Abou al-Ala al-Mawdudi, de Sayid Qotb et de Ruhallah Khomeini, et de leurs disciples rigoristes disséminés dans de nombreux pays. Il préconise la rédemption de la société, l’élimination par la force des régimes en place, la prise du pouvoir et un changement radical de la vie sociale. Réfractaires, voire hostiles, à la civilisation moderne, ses adeptes voient dans l’islam — tel qu’il était pensé et pratiqué il y a de nombreux siècle — la solution à tous les problèmes politiques, économiques, sociaux, culturels et éducatifs dont souffre le monde arabo-islamique, sinon toute la planète. La lutte entre la pensée d’al-Ghazali et celle d’al-Mawdudi continue, et elle constitue sans doute un des principaux facteurs appelés à façonner l’avenir du monde arabo-islamique.
Quelle que soit l’issue de cette lutte, al-Ghazali demeure l’un des plus grands philosophes (bien qu’il s’en soit lui-même défendu) et penseurs de l’éducation dans l’histoire du monde islamique. Sa vie — élève assoiffé de savoir, puis enseignant dispensant le savoir, puis savant développant le savoir — illustre bien ce qu’était la vie des étudiants, des enseignants et des savants dans le monde islamique au Moyen Âge.
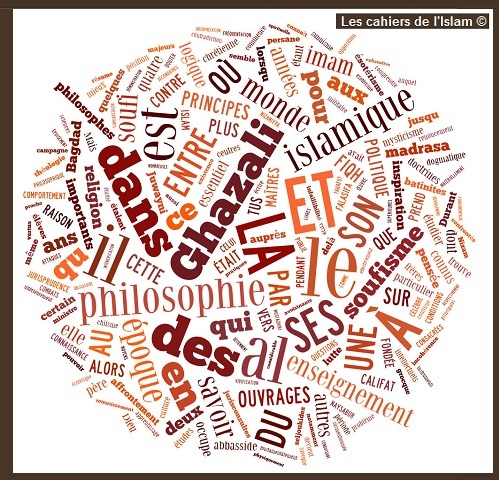
La vie d’al-Ghazali [2]
Al-Ghazali est né en 450 de l’Hégire, soit 1058 de l’ère chrétienne, dans la ville de Tus (Khorassan) ou dans un des villages avoisinants, au sein d’une famille persane de condition modeste, dont certains membres étaient connus pour leur savoir et leur penchant pour le mysticisme soufi. Al-Ghazali était encore jeune lorsque son père mourut, après avoir chargé un de ses amis soufis de s’occuper de l’éducation de ses deux fils. L’ami en question s’acquitta de cette mission jusqu’à épuisement des fonds légués par le père et conseilla aux deux frères de s’inscrire dans une madrasa [3] où les élèves suivaient des cours et étaient pris en charge matériellement. Al-Ghazali aurait commencé, vers l’âge de sept ans, par étudier l’arabe et le persan, le Coran et les principes de religion. A la madrasa, il entra dans le cycle des études secondaires et supérieures comportant le fiqh (jurisprudence islamique) et l’exégèse (tafsir) du texte coranique et des hadith (propos du Prophète) (voir glossaire en fin d’article).
Vers l’âge de 15 ans, al-Ghazali s’installa à Jurjan (centre florissant du savoir à l’époque, situé à 160 km environ de Tus) pour étudier le fiqh auprès de l’imam Al-Ismayli. Ce type de « voyage à la recherche du savoir » en vue de suivre l’enseignement des maîtres réputés du moment, était une des traditions éducatives de l’islam. Il revint l’année suivante à Tus, où il demeura trois années, consacrées à mémoriser et mieux comprendre ce qu’il avait transcrit de l’enseignement de ses maîtres et à poursuivre l’étude du fiqh. Il se rendit ensuite à Naysabur (Nishapur), où il étudia le fiqh, la théologie dogmatique (kalam) et la logique, ainsi que, semble-t-il, des éléments de philosophie, auprès de l’imam Al-Juwayni, le jurisconsulte de rite chaféite le plus célèbre de l’époque. Al-Ghazali avait alors 23 ans. Durant les cinq années qui suivirent, il fut l’élève et l’assistant de l’imam al-Juwayni, et commença à publier quelques ouvrages et à étudier le soufisme auprès d’un autre cheikh, al-Farmadhi.
La mort d’al-Juwayni (478 H/1085) voit s’achever la période d’apprentissage d’al-Ghazali — qui a alors 28 ans — et débuter celle de l’immersion dans la politique et de la fréquentation des allées du pouvoir. Il se rend au « camp » du ministre seljoukide Nizam al-Mulk, où il mène pendant six années la vie des « juristes de cour », faite de combats politiques, de joutes savantes et d’écriture, jusqu’à ce qu’il soit nommé professeur à la madrasa Nizamiya de Bagdad, l’un des centres de savoir et d’enseignement (sorte d’université) les plus importants et les plus connus dans l’Orient islamique à l’époque. Durant les quatre années où il occupe ce poste, il publie un certain nombre d’ouvrages sur le fiqh — qu’il enseigne — la logique et le kalam, les plus importants étant le Mustazhiri et Al-Iqtisad fil-I’tiqad [le juste milieu dans la croyance], deux ouvrages de jurisprudence à caractère politique.
Al-Ghazali prend part à trois affrontements politiques et intellectuels majeurs qui secouent le monde islamique à cette époque, à savoir la lutte entre la philosophie et la religion (entre la culture islamique et la culture grecque) — il prend position pour la religion contre la philosophie ; la lutte entre le sunnisme et le chiisme — il prend position pour le califat abbasside contre les batinites ; la lutte entre l’inspiration et la raison et entre le fiqh et le mysticisme.
Durant la période où il enseigne à la Nizamiyya de Bagdad, al-Ghazali étudie longuement la philosophie (celle des Grecs, Aristote, Platon et Plotin en particulier, et la philosophie islamique, notamment Ibn Sina [Avicenne] et al-Farabi) afin de mieux la réfuter. Le problème essentiel auquel il est confronté est celui de concilier la philosophie et la religion, et il le résout en ces termes : la philosophie est dans le vrai dans la mesure où elle est conforme aux principes de la religion (de l’islam) et dans l’erreur lorsqu’elle est en contradiction avec ces principes. En prélude à ses attaques contre la philosophie, al-Ghazali écrit un ouvrage, Maqasid al-Falasifa [Les intentions des philosophes ], dans lequel il expose l’essentiel de la pensée philosophique connue à son époque suivi de son célèbre ouvrage, Tahafut al-Falasifa [ L’incohérence des philosophes]. Il résume son opposition à la philosophie en vingt questions touchant l’homme, le monde et Dieu. Pour al-Ghazali, le monde est une création récente, les corps rejoignent les âmes dans l’au-delà et Dieu connaît les particuliers comme il connaît l’universel.
Le Tahafut al-Falasifa [L’incohérence des philosophes] a eu un retentissement considérable dans le monde arabo-islamique, et jusque dans l’Europe chrétienne ; cette œuvre et son auteur ont été un des facteurs du déclin de la pensée philosophique grecque dans le monde islamique, en dépit des quelques tentatives de défense de la philosophie par Ibn Ruchd (Averroès) et d’autres [4]. Avec l’intensification de l’affrontement militaire et intellectuel entre le sunnisme et le chiisme, entre le califat abbasside, d’une part, et l’État fatimide et ses partisans et alliés dans le Machreq, de l’autre, al-Ghazali est mobilisé dans ce combat, et il publie effectivement une série d’ouvrages à ce sujet, le plus important étant Les vices de l’ésotérisme et les vertus de l’exotérisme.
L’ésotérisme des batinites repose sur deux principes fondamentaux : l’infaillibilité de l’imam, source obligatoire du savoir, et l’interprétation ésotérique de la chari’a (la loi révélée de l’islam)par l’imam et ses représentants. Al-Ghazali concentre ses attaques sur le premier principe, celui de l’infaillibilité de l’imam, son but étant de défendre le califat abbasside et de justifier son existence, fut-elle symbolique (le califat se trouve alors en situation d’extrême faiblesse), d’assouplir les conditions d’accession à l’imamat et de conférer une légitimité aux sultans seljoukides, qui détiennent alors le véritable pouvoir militaire et politique, problème juridico-politique auquel ont aussi été confrontés d’autres fuqaha (jurisconsultes) musulmans, al-Mawardi en particulier. Mais la campagne d’al-Ghazali contre les batinites n’est pas couronnée du même succès que sa campagne contre les philosophes.
Vers 1095/488 H, al-Ghazali, alors âgé trente-huit ans, traverse une crise spirituelle qui dure à peu près six mois et que l’on peut résumer à un affrontement violent entre la raison et l’âme, entre le monde d’ici-bas et celui de l’au-delà. Il commence par douter des doctrines et clans existants (c’est-à-dire de la connaissance), puis se met à douter des instruments de la connaissance. Cette crise l’affecte physiquement au point qu’il perd l’usage de la parole et devient donc incapable d’enseigner, et elle ne prend fin que lorsqu’il renonce à ses fonctions, à sa fortune et à sa célébrité, après avoir atteint la vérité grâce à la lumière jetée par Dieu dans son cœur.
Al-Ghazali résume les doctrines dominantes à son époque à quatre doctrines principales : la théologie dogmatique, fondée sur la logique et la raison ; l’ésotérisme, fondé sur l’initiation ; la philosophie, fondée sur la logique et la démonstration ; le soufisme, fondé sur le dévoilement et le témoignage. De même, les moyens de parvenir à la connaissance se ramènent à : les sens, la raison et l’inspiration. Il finit par choisir le soufisme et l’inspiration et, convaincu que l’unité du monde et de l’au-delà était difficile, voire impossible, il prétexte un pèlerinage à la Mecque pour quitter Bagdad et se rendre à Damas [5].
Les influences soufis sont nombreuses et fortes dans la vie d’al-Ghazali. Il vit à l’époque où le soufisme se propage : son père était proche du soufisme, son tuteur est soufi, son frère le devient à un âge précoce, ses maîtres penchent vers le soufisme, le ministre Nizam al-Mulk est proche des soufis et al-Ghazali lui-même a étudié le soufisme. Mais le soufisme n’est pas qu’un savoir théorique étudié dans les livres ou enseigné par des maîtres, c’est aussi une action, une pratique et un comportement, dont les principes de base sont, notamment, le renoncement au monde d’ici-bas, la solitude et l’errance. C’est ce que fait al-Ghazali qui, pendant près de deux ans, mène une vie d’ermite entre Damas, Jérusalem et La Mecque. C’est à cette époque qu’il commence à écrire le plus important de ses livres, Ihya’ ‘Ulum al-Din [Vivification des sciences de la foi] — qu’il termine peut-être ultérieurement. Divisée en quatre parties, consacrées respectivement aux pratiques du culte, aux coutumes sociales, aux vices causes de perdition et aux vertus conduisant au salut, cette oeuvre n’apporte rien de fondamentalement nouveau, mais on trouve dans ses quatre volumes et ses quelque 1.500 pages l’essentiel de la pensée islamique religieuse du Moyen Age, sous une forme à la fois exhaustive, claire et simple qui explique la place unique qu’elle occupe dans l’histoire de la pensée islamique.
Al-Ghazali regagne Bagdad en 1097/490 H et continue à vivre comme un soufi dans le ribat6 d’Abou Saïd de Naysabur, qui se trouve en face de la madrasa Nizamiyya. Il reprend pendant un certain temps l’enseignement, qu’il consacre essentiellement à la d’ Ihya’ ‘Ulum al-Din [Vivification des sciences de la foi], puis se rend à Tus, sa ville natale, où, continuant à vivre en soufi et à écrire, il achève semble-t-il son œuvre majeure susmentionnée et produit d’autres ouvrages dont l’inspiration mystique est manifeste [6].
En 1104/498 H, al-Ghazali reprend ses fonctions à la madrasa Nizamiyya de Naysabur, à la demande du ministre seldjoukide Fakhr al-Mulk, après quelque dix années d’absence. Il continue néanmoins à vivre la vie des soufis et à écrire. En 503 H7, il quitte Naysabur et regagne à nouveau Tus, sa ville natale, où il poursuit la vie de renoncement des soufis et l’enseignement. Près de sa maison, il fait construire un khangah (sorte d’ermitage soufi) où il écrit à cette époque Minhaj Al-’Abidin [La voie de la dévotion]8, qui semble être une description de sa vie et de celle de ses élèves : renoncement au monde d’ici-bas, solitude et éducation de l’âme. C’est ainsi qu’il coule le reste de ses jours, jusqu’à sa mort en 111/505 H.
Vers l’âge de 15 ans, al-Ghazali s’installa à Jurjan (centre florissant du savoir à l’époque, situé à 160 km environ de Tus) pour étudier le fiqh auprès de l’imam Al-Ismayli. Ce type de « voyage à la recherche du savoir » en vue de suivre l’enseignement des maîtres réputés du moment, était une des traditions éducatives de l’islam. Il revint l’année suivante à Tus, où il demeura trois années, consacrées à mémoriser et mieux comprendre ce qu’il avait transcrit de l’enseignement de ses maîtres et à poursuivre l’étude du fiqh. Il se rendit ensuite à Naysabur (Nishapur), où il étudia le fiqh, la théologie dogmatique (kalam) et la logique, ainsi que, semble-t-il, des éléments de philosophie, auprès de l’imam Al-Juwayni, le jurisconsulte de rite chaféite le plus célèbre de l’époque. Al-Ghazali avait alors 23 ans. Durant les cinq années qui suivirent, il fut l’élève et l’assistant de l’imam al-Juwayni, et commença à publier quelques ouvrages et à étudier le soufisme auprès d’un autre cheikh, al-Farmadhi.
La mort d’al-Juwayni (478 H/1085) voit s’achever la période d’apprentissage d’al-Ghazali — qui a alors 28 ans — et débuter celle de l’immersion dans la politique et de la fréquentation des allées du pouvoir. Il se rend au « camp » du ministre seljoukide Nizam al-Mulk, où il mène pendant six années la vie des « juristes de cour », faite de combats politiques, de joutes savantes et d’écriture, jusqu’à ce qu’il soit nommé professeur à la madrasa Nizamiya de Bagdad, l’un des centres de savoir et d’enseignement (sorte d’université) les plus importants et les plus connus dans l’Orient islamique à l’époque. Durant les quatre années où il occupe ce poste, il publie un certain nombre d’ouvrages sur le fiqh — qu’il enseigne — la logique et le kalam, les plus importants étant le Mustazhiri et Al-Iqtisad fil-I’tiqad [le juste milieu dans la croyance], deux ouvrages de jurisprudence à caractère politique.
Al-Ghazali prend part à trois affrontements politiques et intellectuels majeurs qui secouent le monde islamique à cette époque, à savoir la lutte entre la philosophie et la religion (entre la culture islamique et la culture grecque) — il prend position pour la religion contre la philosophie ; la lutte entre le sunnisme et le chiisme — il prend position pour le califat abbasside contre les batinites ; la lutte entre l’inspiration et la raison et entre le fiqh et le mysticisme.
Durant la période où il enseigne à la Nizamiyya de Bagdad, al-Ghazali étudie longuement la philosophie (celle des Grecs, Aristote, Platon et Plotin en particulier, et la philosophie islamique, notamment Ibn Sina [Avicenne] et al-Farabi) afin de mieux la réfuter. Le problème essentiel auquel il est confronté est celui de concilier la philosophie et la religion, et il le résout en ces termes : la philosophie est dans le vrai dans la mesure où elle est conforme aux principes de la religion (de l’islam) et dans l’erreur lorsqu’elle est en contradiction avec ces principes. En prélude à ses attaques contre la philosophie, al-Ghazali écrit un ouvrage, Maqasid al-Falasifa [Les intentions des philosophes ], dans lequel il expose l’essentiel de la pensée philosophique connue à son époque suivi de son célèbre ouvrage, Tahafut al-Falasifa [ L’incohérence des philosophes]. Il résume son opposition à la philosophie en vingt questions touchant l’homme, le monde et Dieu. Pour al-Ghazali, le monde est une création récente, les corps rejoignent les âmes dans l’au-delà et Dieu connaît les particuliers comme il connaît l’universel.
Le Tahafut al-Falasifa [L’incohérence des philosophes] a eu un retentissement considérable dans le monde arabo-islamique, et jusque dans l’Europe chrétienne ; cette œuvre et son auteur ont été un des facteurs du déclin de la pensée philosophique grecque dans le monde islamique, en dépit des quelques tentatives de défense de la philosophie par Ibn Ruchd (Averroès) et d’autres [4]. Avec l’intensification de l’affrontement militaire et intellectuel entre le sunnisme et le chiisme, entre le califat abbasside, d’une part, et l’État fatimide et ses partisans et alliés dans le Machreq, de l’autre, al-Ghazali est mobilisé dans ce combat, et il publie effectivement une série d’ouvrages à ce sujet, le plus important étant Les vices de l’ésotérisme et les vertus de l’exotérisme.
L’ésotérisme des batinites repose sur deux principes fondamentaux : l’infaillibilité de l’imam, source obligatoire du savoir, et l’interprétation ésotérique de la chari’a (la loi révélée de l’islam)par l’imam et ses représentants. Al-Ghazali concentre ses attaques sur le premier principe, celui de l’infaillibilité de l’imam, son but étant de défendre le califat abbasside et de justifier son existence, fut-elle symbolique (le califat se trouve alors en situation d’extrême faiblesse), d’assouplir les conditions d’accession à l’imamat et de conférer une légitimité aux sultans seljoukides, qui détiennent alors le véritable pouvoir militaire et politique, problème juridico-politique auquel ont aussi été confrontés d’autres fuqaha (jurisconsultes) musulmans, al-Mawardi en particulier. Mais la campagne d’al-Ghazali contre les batinites n’est pas couronnée du même succès que sa campagne contre les philosophes.
Vers 1095/488 H, al-Ghazali, alors âgé trente-huit ans, traverse une crise spirituelle qui dure à peu près six mois et que l’on peut résumer à un affrontement violent entre la raison et l’âme, entre le monde d’ici-bas et celui de l’au-delà. Il commence par douter des doctrines et clans existants (c’est-à-dire de la connaissance), puis se met à douter des instruments de la connaissance. Cette crise l’affecte physiquement au point qu’il perd l’usage de la parole et devient donc incapable d’enseigner, et elle ne prend fin que lorsqu’il renonce à ses fonctions, à sa fortune et à sa célébrité, après avoir atteint la vérité grâce à la lumière jetée par Dieu dans son cœur.
Al-Ghazali résume les doctrines dominantes à son époque à quatre doctrines principales : la théologie dogmatique, fondée sur la logique et la raison ; l’ésotérisme, fondé sur l’initiation ; la philosophie, fondée sur la logique et la démonstration ; le soufisme, fondé sur le dévoilement et le témoignage. De même, les moyens de parvenir à la connaissance se ramènent à : les sens, la raison et l’inspiration. Il finit par choisir le soufisme et l’inspiration et, convaincu que l’unité du monde et de l’au-delà était difficile, voire impossible, il prétexte un pèlerinage à la Mecque pour quitter Bagdad et se rendre à Damas [5].
Les influences soufis sont nombreuses et fortes dans la vie d’al-Ghazali. Il vit à l’époque où le soufisme se propage : son père était proche du soufisme, son tuteur est soufi, son frère le devient à un âge précoce, ses maîtres penchent vers le soufisme, le ministre Nizam al-Mulk est proche des soufis et al-Ghazali lui-même a étudié le soufisme. Mais le soufisme n’est pas qu’un savoir théorique étudié dans les livres ou enseigné par des maîtres, c’est aussi une action, une pratique et un comportement, dont les principes de base sont, notamment, le renoncement au monde d’ici-bas, la solitude et l’errance. C’est ce que fait al-Ghazali qui, pendant près de deux ans, mène une vie d’ermite entre Damas, Jérusalem et La Mecque. C’est à cette époque qu’il commence à écrire le plus important de ses livres, Ihya’ ‘Ulum al-Din [Vivification des sciences de la foi] — qu’il termine peut-être ultérieurement. Divisée en quatre parties, consacrées respectivement aux pratiques du culte, aux coutumes sociales, aux vices causes de perdition et aux vertus conduisant au salut, cette oeuvre n’apporte rien de fondamentalement nouveau, mais on trouve dans ses quatre volumes et ses quelque 1.500 pages l’essentiel de la pensée islamique religieuse du Moyen Age, sous une forme à la fois exhaustive, claire et simple qui explique la place unique qu’elle occupe dans l’histoire de la pensée islamique.
Al-Ghazali regagne Bagdad en 1097/490 H et continue à vivre comme un soufi dans le ribat6 d’Abou Saïd de Naysabur, qui se trouve en face de la madrasa Nizamiyya. Il reprend pendant un certain temps l’enseignement, qu’il consacre essentiellement à la d’ Ihya’ ‘Ulum al-Din [Vivification des sciences de la foi], puis se rend à Tus, sa ville natale, où, continuant à vivre en soufi et à écrire, il achève semble-t-il son œuvre majeure susmentionnée et produit d’autres ouvrages dont l’inspiration mystique est manifeste [6].
En 1104/498 H, al-Ghazali reprend ses fonctions à la madrasa Nizamiyya de Naysabur, à la demande du ministre seldjoukide Fakhr al-Mulk, après quelque dix années d’absence. Il continue néanmoins à vivre la vie des soufis et à écrire. En 503 H7, il quitte Naysabur et regagne à nouveau Tus, sa ville natale, où il poursuit la vie de renoncement des soufis et l’enseignement. Près de sa maison, il fait construire un khangah (sorte d’ermitage soufi) où il écrit à cette époque Minhaj Al-’Abidin [La voie de la dévotion]8, qui semble être une description de sa vie et de celle de ses élèves : renoncement au monde d’ici-bas, solitude et éducation de l’âme. C’est ainsi qu’il coule le reste de ses jours, jusqu’à sa mort en 111/505 H.
La philosophie d’al-Ghazali
La philosophie d’al-Ghazali, comme la philosophie islamique de manière générale, tourne essentiellement autour du concept de Dieu et de ses rapports avec ses créations (le monde et l’homme). Certes, al-Ghazali commence par suivre le courant de pensée islamique du fiqh et, plus précisément, celui de la théologie dogmatique ash’arite, dans sa description de l’identité et des attributs de Dieu, et des attributs de Dieu, et le courant soufi dans la définition de la relation entre Dieu et l’être humain, mais il va plus loin en proposant une idée neuve de l’identité de Dieu, de ses attributs et de son action [9].
Al-Ghazali est en accord avec les jurisconsultes et les théologiens quant à l’unicité et l’éternité de Dieu, un dieu sans substance ni forme, qui ne ressemble à aucune chose et auquel aucune chose ne ressemble, un dieu omniprésent, omniscient et omnipotent, un dieu doué de vie, de volonté, d’ouïe, de vue et de parole. Mais le dieu d’al-Ghazali est différent en ce que l’univers et ses composantes, et les actes des hommes, sont soumis à sa forte emprise et à son intervention directe et constante, et que les concepts propres à la justice des hommes ne sauraient lui être appliqués. Il diffère aussi par la prise en considération du bien des créatures. A l’instar de nombreux jurisconsultes et philosophes, al-Ghazali distingue deux mondes, celui-ci, qui est éphémère, et l’autre qui est éternel. Le premier, celui de l’existence matérielle, est une existence provisoire, soumise à la volonté de Dieu ; il n’est pas régi par un ensemble de lois scientifiques, qui sont en réalité une partie de ce monde, mais dominé, régi et dirigé par l’intervention directe et constante de Dieu (refus de la causalité). Dieu n’est pas seulement le créateur de l’univers, de ses caractéristiques et de ses lois (ou cause de l’existence), il est aussi la cause de tout événement qui y survient, insignifiant ou important, passé, présent ou à venir [10].
C’est dans cet univers que vit l’être humain, créature faite d’une âme immortelle et d’un corps éphémère. L’être humain n’est ni bon ni mauvais par nature, encore que sa disposition naturelle soit plus proche du bien que du mal. Il se meut, en outre, dans un espace restreint, où les contraintes l’emportent sur les possibilités de choix. Il est moins fait pour le monde d’ici bas, où il souffre, que pour l’autre, auquel il doit aspirer et vers lequel il doit faire tendre ses efforts [11]. La société, formée d’êtres humains, n’es pas et ne saurait être vertueuse pour al-Ghazali.
C’est une société où le mal l’emporte sur le bien, au point que l’être humain a plus intérêt à l’éviter plutôt qu’à y vivre. La société ne peut aller qu’en empirant. L’individu y a ses droits et ses devoirs, mais son existence est insignifiant à côté de l’existence et de la puissance du groupe. C’est aussi une société stratifiée, composée d’une élite pensante et dirigeante et d’une masse, qui a entièrement abandonné son sort aux mains de cette élite. Les questions de la religion et de la doctrine sont du ressort des savants et les affaires de ce monde et de l’État sont aux mains des dirigeants. Le peuple, lui, n’a qu’à obéir. Enfin, la société est entièrement soumise à l’autorité de Dieu et à ses injonctions, son seul but étant la religion et de donner aux êtres humains la possibilité de vénérer Dieu [12]. Conscience et savoir sont les traits distinctifs majeurs de l’être humain, lequel puise sa connaissance à deux sources, l’une humaine, qui lui permet de découvrir le monde matériel où il vit, au moyen de ces outils limités que sont la perception et la raison, et l’autre divine, qui lui permet de connaître le monde de l’au-delà, par la révélation et l’inspiration. Ces deux types de connaissance ne sauraient être mis sur un pied d’égalité, du point de vue de leur source comme de leur méthode ou de leur degré de vérité. Le vrai savoir ne peut venir que du dévoilement, une fois l’âme réformée et purifiée par l’éducation de l’esprit et du corps, et en conséquence prête à enregistrer ce qui est gravé dans la mémoire. Il s’agit d’un savoir dont le vecteur n’est ni la
parole ni l’écrit, un savoir qui investit l’âme dans la mesure où celle-ci est pure et prête à le recevoir. Et plus l’âme acquiert ce savoir, plus elle connaît Dieu et s’en rapproche, et plus le bonheur de l’être humain est grand [13].
Selon al-Ghazali, l’individu vertueux est celui qui renonce à ce monde pour tendre vers l’au-delà, qui préfère la solitude à la fréquentation de ses semblables, le dénuement à la richesse et la faim à la satiété. C’est l’abandon à Dieu et non le goût du combat qui dicte son comportement et il est plus enclin à faire preuve de patience que d’agressivité [14]. Curieusement, au moment même où l’image de l’homme vertueux commençait à évoluer en Europe, le « moine chevalier » supplantant le moine errant, le vêtement de l’homme vertueux changeait aussi dans l’Orient arabe, avec la différence que l’armure du cavalier combattant laissait la place aux haillons du soufi. Et alors que Pierre l’Ermite ameutait les masses européennes et les mobilisait pour les croisades, al-Ghazali exhortait les Arabes à se soumettre aux souverains et à se détourner de la société. C’est ainsi que le penseur et le philosophe contribuent à façonner la société et à modifier le cours de l’histoire.
Al-Ghazali est en accord avec les jurisconsultes et les théologiens quant à l’unicité et l’éternité de Dieu, un dieu sans substance ni forme, qui ne ressemble à aucune chose et auquel aucune chose ne ressemble, un dieu omniprésent, omniscient et omnipotent, un dieu doué de vie, de volonté, d’ouïe, de vue et de parole. Mais le dieu d’al-Ghazali est différent en ce que l’univers et ses composantes, et les actes des hommes, sont soumis à sa forte emprise et à son intervention directe et constante, et que les concepts propres à la justice des hommes ne sauraient lui être appliqués. Il diffère aussi par la prise en considération du bien des créatures. A l’instar de nombreux jurisconsultes et philosophes, al-Ghazali distingue deux mondes, celui-ci, qui est éphémère, et l’autre qui est éternel. Le premier, celui de l’existence matérielle, est une existence provisoire, soumise à la volonté de Dieu ; il n’est pas régi par un ensemble de lois scientifiques, qui sont en réalité une partie de ce monde, mais dominé, régi et dirigé par l’intervention directe et constante de Dieu (refus de la causalité). Dieu n’est pas seulement le créateur de l’univers, de ses caractéristiques et de ses lois (ou cause de l’existence), il est aussi la cause de tout événement qui y survient, insignifiant ou important, passé, présent ou à venir [10].
C’est dans cet univers que vit l’être humain, créature faite d’une âme immortelle et d’un corps éphémère. L’être humain n’est ni bon ni mauvais par nature, encore que sa disposition naturelle soit plus proche du bien que du mal. Il se meut, en outre, dans un espace restreint, où les contraintes l’emportent sur les possibilités de choix. Il est moins fait pour le monde d’ici bas, où il souffre, que pour l’autre, auquel il doit aspirer et vers lequel il doit faire tendre ses efforts [11]. La société, formée d’êtres humains, n’es pas et ne saurait être vertueuse pour al-Ghazali.
C’est une société où le mal l’emporte sur le bien, au point que l’être humain a plus intérêt à l’éviter plutôt qu’à y vivre. La société ne peut aller qu’en empirant. L’individu y a ses droits et ses devoirs, mais son existence est insignifiant à côté de l’existence et de la puissance du groupe. C’est aussi une société stratifiée, composée d’une élite pensante et dirigeante et d’une masse, qui a entièrement abandonné son sort aux mains de cette élite. Les questions de la religion et de la doctrine sont du ressort des savants et les affaires de ce monde et de l’État sont aux mains des dirigeants. Le peuple, lui, n’a qu’à obéir. Enfin, la société est entièrement soumise à l’autorité de Dieu et à ses injonctions, son seul but étant la religion et de donner aux êtres humains la possibilité de vénérer Dieu [12]. Conscience et savoir sont les traits distinctifs majeurs de l’être humain, lequel puise sa connaissance à deux sources, l’une humaine, qui lui permet de découvrir le monde matériel où il vit, au moyen de ces outils limités que sont la perception et la raison, et l’autre divine, qui lui permet de connaître le monde de l’au-delà, par la révélation et l’inspiration. Ces deux types de connaissance ne sauraient être mis sur un pied d’égalité, du point de vue de leur source comme de leur méthode ou de leur degré de vérité. Le vrai savoir ne peut venir que du dévoilement, une fois l’âme réformée et purifiée par l’éducation de l’esprit et du corps, et en conséquence prête à enregistrer ce qui est gravé dans la mémoire. Il s’agit d’un savoir dont le vecteur n’est ni la
parole ni l’écrit, un savoir qui investit l’âme dans la mesure où celle-ci est pure et prête à le recevoir. Et plus l’âme acquiert ce savoir, plus elle connaît Dieu et s’en rapproche, et plus le bonheur de l’être humain est grand [13].
Selon al-Ghazali, l’individu vertueux est celui qui renonce à ce monde pour tendre vers l’au-delà, qui préfère la solitude à la fréquentation de ses semblables, le dénuement à la richesse et la faim à la satiété. C’est l’abandon à Dieu et non le goût du combat qui dicte son comportement et il est plus enclin à faire preuve de patience que d’agressivité [14]. Curieusement, au moment même où l’image de l’homme vertueux commençait à évoluer en Europe, le « moine chevalier » supplantant le moine errant, le vêtement de l’homme vertueux changeait aussi dans l’Orient arabe, avec la différence que l’armure du cavalier combattant laissait la place aux haillons du soufi. Et alors que Pierre l’Ermite ameutait les masses européennes et les mobilisait pour les croisades, al-Ghazali exhortait les Arabes à se soumettre aux souverains et à se détourner de la société. C’est ainsi que le penseur et le philosophe contribuent à façonner la société et à modifier le cours de l’histoire.
Les buts et le principe de l’éducation
La philosophie de l’éducation d’al-Ghazali représente l’apogée de la pensée éducative islamique, et s’y manifeste le penchant évident d’al-Ghazali pour la conciliation et la synthèse des diverses doctrines, en l’occurrence la synthèse des pensées éducative, juridique, philosophique et mystique. Al-Ghazali n’était pas, au premier chef, un « philosophe de l’éducation » (bien qu’il ait enseigné au début de sa vie) ; mais c’était un philosophe de la religion et de la morale. Après avoir achevé d’édifier son système philosophique et avoir commencé à le mettre en pratique, al- Ghazali s’est trouvé amené à s’intéresser à l’éducation et l’enseignement, tout comme cela avait été le cas pour les grands philosophes qui l’avaient précédé. La philosophie d’al-Ghazali exprime l’esprit de son époque plus qu’elle ne répond à ses défis, et sa pensée en matière d’éducation, à l’instar de sa philosophie, donne la préférence à la continuité et à la stabilité plutôt qu’au changement et à l’innovation. Al-Ghazali attache une grande importance au processus éducatif ; il considère que ce processus relève de la responsabilité de la société, laquelle assigne cette tâche aux pères et aux maîtres. Car l’enfant est confié aux parents, auxquels il incombe de l’élever et de l’éduquer.
Pour al-Ghazali la société a pour fonction d’appliquer la loi divine, la charia, et le but de l’être humain est d’atteindre le bonheur auprès de Dieu. En conséquence, l’objectif de l’éducation est de réformer l’être humain de telle sorte qu’il se conforme aux enseignements de la religion et gagne ainsi son salut et son bonheur dans l’au-delà éternel. Les autres objectifs terrestres — richesse, position sociale, pouvoir, voire amour du savoir — sont des leurres car ils se rapportent au monde d’ici-bas [15]. L’être humain qui vient au monde est une page vierge ; sa personnalité, ses caractéristiques et son comportement sont ensuite façonnés par sa vie en société et ses rapports avec son environnement. La famille où il naît lui apprend la langue, les coutumes, les traditions et la religion, sans qu’il puisse en combattre l’influence, d’où la grande responsabilité éducative qui incombe aux parents. A eux revient le mérite de sa droiture, ou la honte de ses erreurs. Ils sont coresponsables de tous ses actes, avant que les enseignants ne viennent aussi assumer leur part de responsabilité [16].
Al-Ghazali insiste sur l’importance de l’enfance dans la formation de l’individu. C’est au cours de cette phase que l’éducation peut, si elle est bien menée, façonner une bonne personnalité et préparer à une vie droite ou, si elle est mal conduite, vicier la personnalité de l’enfant et rendre difficile son retour sur le droit chemin. Il faut donc bien comprendre les caractéristiques de cette phase, afin que les échanges avec l’enfant soient efficaces et salutaires [17].
Il importe donc que les garçons aillent au maktab (école primaire) à un âge précoce, lorsque l’apprentissage ressemble à la gravure dans la pierre. Ceux qui sont chargés, à l’école, de l’éducation du garçon doivent également connaître l’évolution de ses motivations et de ses pôles d’intérêt d’une phase à l’autre : goût du mouvement, des jeux et du divertissement, puis goût de la parure et des apparences (dans l’enfance et l’adolescence), puis intérêt pour les femmes et la sexualité (au moment de la puberté), puis goût de l’autorité et du pouvoir (après 20 ans) et, enfin, joie de la connaissance de Dieu (à l’approche de la quarantaine). Il est bon que les éducateurs tirent parti de ces changements pour susciter chez l’élève le désir d’aller à l’école : ils se serviront par exemple du jeu de ballon, puis de la parure et des vêtements, puis du pouvoir, puis de l’intérêt pour l’au-delà [18].
Dans le cycle primaire, le garçon apprend le Coran et les dits des compagnons du Prophète : il doit être préservé des poésies érotiques et de la fréquentation des hommes de lettres, qui introduit les germes de la corruption dans l’âme des garçons. L’école doit habituer le jeune garçon à obéir à ses parents, à son maître et à ses aînés et à bien se conduire avec ses camarades de classe. Elle doit lui apprendre à ne jamais se vanter devant ses condisciples de la fortune de ses parents ou de ce qu’il peut lui-même posséder (nourriture, vêtements, fournitures), et l’habituer au contraire à la modestie, à la générosité et au tact. Il doit être mis en garde contre les dangers inhérents à l’influence du groupe sur sa personnalité, comme il faut lui conseiller de veiller à ce que ses amis possèdent toujours les cinq qualités suivantes : l’intelligence, la bonne moralité, la droiture, le désintéressement et la franchise [19]. L’éducation ne consiste pas simplement à former l’esprit et à le remplir d’informations : elle doit englober tous les aspects — intellectuel, religieux, moral et physique — de la personnalité de l’apprenant. Elle ne s’arrête pas à l’enseignement théorique mais s’étend à la pratique effective. Le véritable apprentissage est celui qui agit sur le comportement, celui qui fait que l’apprenant met ce qu’il apprend en pratique [20].
Les responsables de l’éducation du garçon doivent concentrer leur attention sur l’éducation religieuse en lui inculquant d’abord les principes et les fondements de la religion. Quand il atteint l’âge de sept ans, il doit être tenu de faire ses ablutions rituelles et ses prières, ainsi que quelques jours de jeûne durant le mois de Ramadan jusqu’à ce qu’il soit suffisamment fort pour accomplir le jeûne complet. Il faut lui interdire de porter des vêtements de soie et des bijoux, que la religion réprouve, et lui enseigner tous les interdits de la loi divine qu’il est tenu de connaître. Il faut le mettre en garde contre le vol, l’absorption de nourritures interdites, la
perfidie, le mensonge, les paroles obscènes et tous les défauts propres aux garçons. Le garçon n’est naturellement pas encore en mesure, à cet âge, de comprendre parfaitement ce qu’on lui apprend et ce qu’on l’oblige à pratiquer, et il n’y a rien d’anormal à cela. La compréhension viendra plus tard. Al-Ghazali est parfois plus soufi qu’éducateur, par exemple lorsqu’il conseille de couper l’enfant du monde et de ses tentations, afin qu’il y renonce, et de l’habituer à l’ascétisme, au dénuement et à la modestie [21].
Mais l’éducateur reprend vite le dessus, lorsque al-Ghazali estime que l’on doit autoriser le garçon, une fois sorti de l’école, à pratiquer des jeux agréables qui le délassent des fatigues de l’étude et l’affranchissent des contraintes qui lui sont imposées, sans pour autant qu’il se fatigue en jouant ou se surmène. Lui interdire le jeu et lui imposer d’apprendre sans répit ne peut qu’éteindre son cœur et étouffer son intelligence, le remplir d’amertume et le dégoûter de l’étude au point qu’il recourt à des subterfuges pour y échapper [22]. Le garçon qui obéit à son éducateur fait montre d’excellence morale et intellectuelle et progresse dans ses études, doit être honoré et loué en public, à titre d’encouragement et afin que les autres soient incités à l’imiter. Si le garçon commet une faute et en a manifestement conscience, l’éducateur doit passer sous silence cette erreur que l’enfant a reconnue et qu’il est résolu à ne plus commettre. En cas de récidive, l’éducateur doit le réprimander en tête-à-tête, sans excès. S’il arrive que le maître punisse l’élève en lui infligeant un châtiment corporel, celui-ci doit être léger et inspiré par le souci d’éduquer et non de faire mal [23]. L’enseignant doit tenir compte des différences de personnalité et de capacités des élèves et adapter son comportement en conséquence. Il ne doit pas pousser l’élève au-delà de ses capacités ni tenter de lui inculquer plus de savoir qu’il n’est à même d’assimiler, faute de quoi il risque d’aboutir au contraire du résultat recherché. A l’inverse, il ne doit pas empêcher l’élève intelligent de dépasser le niveau de ses condisciples. S’il agissait autrement, il serait comme celui qui nourrit un nouveau-né d’une viande qu’il ne peut ni absorber ni digérer et dont il ne peut tirer profit, ou celui qui veut que l’adulte dans la force de l’âge se nourrisse du lait maternel de son enfance. Donner une alimentation appropriée, c’est faire vivre et gaver quelqu’un d’aliments non appropriés, ne peut mener qu’à un désastre [24].
Occulté par ses emprunts directs aux philosophes ou leur influence (Ibn Maskawi, en particulier), al-Ghazali juriste et soufi revient sur le devant de la scène lorsqu’il parle des principes généraux de l’éducation, notamment des arts et de l’éducation artistique. Bien qu’il commence par définir le beau et le bien comme la perception de chaque chose dans sa globalité, il succombe vite au soufisme et condamne l’écoute de la musique et du chant, non pour eux-mêmes mais parce qu’ils sont associés aux lieux où l’on boit du vin. Ne trouvent grâce à ses yeux que les chants religieux ou épiques ou ceux que l’on chante à l’occasion de réjouissances licites (fêtes, banquets, etc.), car elles divertissent l’esprit, réconfortent le cœur et aident à continuer d’œuvrer pour ce monde et pour l’au-delà. Mais musique et chants sont comme des médicaments, il faut en user avec modération et ne pas dépasser la dose prescrite. Il en va de même pour la danse, qu’il est licite de pratiquer ou de regarder dans l’espace qui lui est propre, si tant est qu’elle n’éveille pas le désir et n’incite pas au péché.
Al-Ghazali condamne catégoriquement la peinture et le dessin, faisant en cela sienne la réprobation des jurisconsultes, ceux du début de l’islam en particulier, à l’égard de la représentation des êtres humains et des animaux, considérée comme liée au culte des idoles et des icônes. Aussi préconise-t-il de supprimer les images ou de les altérer et conseille-t-il de ne pas avoir pour métier la gravure, l’orfèvrerie et l’ornementation. Quant à la poésie, al-Ghazali conseille de ne pas perdre son temps à cette activité, bien que ni sa composition ni sa récitation ne soient interdites. Al-Ghazali adopte donc une attitude sévère, qui est celle des jurisconsultes les plus rigoristes. Il divise les arts en ceux qui sont licites, ceux qui sont répréhensibles et ceux qui sont interdits, jugeant licite ce qui a rapport à la religion ou suscite la ferveur religieuse et tendant à considérer comme répréhensible ou interdit, ce qui vise à divertir ou distraire. Au fond, peu importe, car al-Ghazali fait peu de cas des arts et de l’éducation artistique, encore qu’il serait injuste de faire abstraction des critères et idées de son époque pour le juger à la seule aune de nos critères et de nos concepts [25].
Al-Ghazali préconise le mariage dès l’apparition des pulsions sexuelles et la maturité, mais il insiste aussi sur le fait que le mariage et la création d’une famille constituent une lourde responsabilité, que l’on ne saurait assumer sans s’y être préparé. A celui qui ne peut se marier, al-Ghazali conseille de s’efforcer de policer et de maîtriser son âme et de dompter ses désirs par le jeûne et les exercices spirituels [26].
Pour al-Ghazali la société a pour fonction d’appliquer la loi divine, la charia, et le but de l’être humain est d’atteindre le bonheur auprès de Dieu. En conséquence, l’objectif de l’éducation est de réformer l’être humain de telle sorte qu’il se conforme aux enseignements de la religion et gagne ainsi son salut et son bonheur dans l’au-delà éternel. Les autres objectifs terrestres — richesse, position sociale, pouvoir, voire amour du savoir — sont des leurres car ils se rapportent au monde d’ici-bas [15]. L’être humain qui vient au monde est une page vierge ; sa personnalité, ses caractéristiques et son comportement sont ensuite façonnés par sa vie en société et ses rapports avec son environnement. La famille où il naît lui apprend la langue, les coutumes, les traditions et la religion, sans qu’il puisse en combattre l’influence, d’où la grande responsabilité éducative qui incombe aux parents. A eux revient le mérite de sa droiture, ou la honte de ses erreurs. Ils sont coresponsables de tous ses actes, avant que les enseignants ne viennent aussi assumer leur part de responsabilité [16].
Al-Ghazali insiste sur l’importance de l’enfance dans la formation de l’individu. C’est au cours de cette phase que l’éducation peut, si elle est bien menée, façonner une bonne personnalité et préparer à une vie droite ou, si elle est mal conduite, vicier la personnalité de l’enfant et rendre difficile son retour sur le droit chemin. Il faut donc bien comprendre les caractéristiques de cette phase, afin que les échanges avec l’enfant soient efficaces et salutaires [17].
Il importe donc que les garçons aillent au maktab (école primaire) à un âge précoce, lorsque l’apprentissage ressemble à la gravure dans la pierre. Ceux qui sont chargés, à l’école, de l’éducation du garçon doivent également connaître l’évolution de ses motivations et de ses pôles d’intérêt d’une phase à l’autre : goût du mouvement, des jeux et du divertissement, puis goût de la parure et des apparences (dans l’enfance et l’adolescence), puis intérêt pour les femmes et la sexualité (au moment de la puberté), puis goût de l’autorité et du pouvoir (après 20 ans) et, enfin, joie de la connaissance de Dieu (à l’approche de la quarantaine). Il est bon que les éducateurs tirent parti de ces changements pour susciter chez l’élève le désir d’aller à l’école : ils se serviront par exemple du jeu de ballon, puis de la parure et des vêtements, puis du pouvoir, puis de l’intérêt pour l’au-delà [18].
Dans le cycle primaire, le garçon apprend le Coran et les dits des compagnons du Prophète : il doit être préservé des poésies érotiques et de la fréquentation des hommes de lettres, qui introduit les germes de la corruption dans l’âme des garçons. L’école doit habituer le jeune garçon à obéir à ses parents, à son maître et à ses aînés et à bien se conduire avec ses camarades de classe. Elle doit lui apprendre à ne jamais se vanter devant ses condisciples de la fortune de ses parents ou de ce qu’il peut lui-même posséder (nourriture, vêtements, fournitures), et l’habituer au contraire à la modestie, à la générosité et au tact. Il doit être mis en garde contre les dangers inhérents à l’influence du groupe sur sa personnalité, comme il faut lui conseiller de veiller à ce que ses amis possèdent toujours les cinq qualités suivantes : l’intelligence, la bonne moralité, la droiture, le désintéressement et la franchise [19]. L’éducation ne consiste pas simplement à former l’esprit et à le remplir d’informations : elle doit englober tous les aspects — intellectuel, religieux, moral et physique — de la personnalité de l’apprenant. Elle ne s’arrête pas à l’enseignement théorique mais s’étend à la pratique effective. Le véritable apprentissage est celui qui agit sur le comportement, celui qui fait que l’apprenant met ce qu’il apprend en pratique [20].
Les responsables de l’éducation du garçon doivent concentrer leur attention sur l’éducation religieuse en lui inculquant d’abord les principes et les fondements de la religion. Quand il atteint l’âge de sept ans, il doit être tenu de faire ses ablutions rituelles et ses prières, ainsi que quelques jours de jeûne durant le mois de Ramadan jusqu’à ce qu’il soit suffisamment fort pour accomplir le jeûne complet. Il faut lui interdire de porter des vêtements de soie et des bijoux, que la religion réprouve, et lui enseigner tous les interdits de la loi divine qu’il est tenu de connaître. Il faut le mettre en garde contre le vol, l’absorption de nourritures interdites, la
perfidie, le mensonge, les paroles obscènes et tous les défauts propres aux garçons. Le garçon n’est naturellement pas encore en mesure, à cet âge, de comprendre parfaitement ce qu’on lui apprend et ce qu’on l’oblige à pratiquer, et il n’y a rien d’anormal à cela. La compréhension viendra plus tard. Al-Ghazali est parfois plus soufi qu’éducateur, par exemple lorsqu’il conseille de couper l’enfant du monde et de ses tentations, afin qu’il y renonce, et de l’habituer à l’ascétisme, au dénuement et à la modestie [21].
Mais l’éducateur reprend vite le dessus, lorsque al-Ghazali estime que l’on doit autoriser le garçon, une fois sorti de l’école, à pratiquer des jeux agréables qui le délassent des fatigues de l’étude et l’affranchissent des contraintes qui lui sont imposées, sans pour autant qu’il se fatigue en jouant ou se surmène. Lui interdire le jeu et lui imposer d’apprendre sans répit ne peut qu’éteindre son cœur et étouffer son intelligence, le remplir d’amertume et le dégoûter de l’étude au point qu’il recourt à des subterfuges pour y échapper [22]. Le garçon qui obéit à son éducateur fait montre d’excellence morale et intellectuelle et progresse dans ses études, doit être honoré et loué en public, à titre d’encouragement et afin que les autres soient incités à l’imiter. Si le garçon commet une faute et en a manifestement conscience, l’éducateur doit passer sous silence cette erreur que l’enfant a reconnue et qu’il est résolu à ne plus commettre. En cas de récidive, l’éducateur doit le réprimander en tête-à-tête, sans excès. S’il arrive que le maître punisse l’élève en lui infligeant un châtiment corporel, celui-ci doit être léger et inspiré par le souci d’éduquer et non de faire mal [23]. L’enseignant doit tenir compte des différences de personnalité et de capacités des élèves et adapter son comportement en conséquence. Il ne doit pas pousser l’élève au-delà de ses capacités ni tenter de lui inculquer plus de savoir qu’il n’est à même d’assimiler, faute de quoi il risque d’aboutir au contraire du résultat recherché. A l’inverse, il ne doit pas empêcher l’élève intelligent de dépasser le niveau de ses condisciples. S’il agissait autrement, il serait comme celui qui nourrit un nouveau-né d’une viande qu’il ne peut ni absorber ni digérer et dont il ne peut tirer profit, ou celui qui veut que l’adulte dans la force de l’âge se nourrisse du lait maternel de son enfance. Donner une alimentation appropriée, c’est faire vivre et gaver quelqu’un d’aliments non appropriés, ne peut mener qu’à un désastre [24].
Occulté par ses emprunts directs aux philosophes ou leur influence (Ibn Maskawi, en particulier), al-Ghazali juriste et soufi revient sur le devant de la scène lorsqu’il parle des principes généraux de l’éducation, notamment des arts et de l’éducation artistique. Bien qu’il commence par définir le beau et le bien comme la perception de chaque chose dans sa globalité, il succombe vite au soufisme et condamne l’écoute de la musique et du chant, non pour eux-mêmes mais parce qu’ils sont associés aux lieux où l’on boit du vin. Ne trouvent grâce à ses yeux que les chants religieux ou épiques ou ceux que l’on chante à l’occasion de réjouissances licites (fêtes, banquets, etc.), car elles divertissent l’esprit, réconfortent le cœur et aident à continuer d’œuvrer pour ce monde et pour l’au-delà. Mais musique et chants sont comme des médicaments, il faut en user avec modération et ne pas dépasser la dose prescrite. Il en va de même pour la danse, qu’il est licite de pratiquer ou de regarder dans l’espace qui lui est propre, si tant est qu’elle n’éveille pas le désir et n’incite pas au péché.
Al-Ghazali condamne catégoriquement la peinture et le dessin, faisant en cela sienne la réprobation des jurisconsultes, ceux du début de l’islam en particulier, à l’égard de la représentation des êtres humains et des animaux, considérée comme liée au culte des idoles et des icônes. Aussi préconise-t-il de supprimer les images ou de les altérer et conseille-t-il de ne pas avoir pour métier la gravure, l’orfèvrerie et l’ornementation. Quant à la poésie, al-Ghazali conseille de ne pas perdre son temps à cette activité, bien que ni sa composition ni sa récitation ne soient interdites. Al-Ghazali adopte donc une attitude sévère, qui est celle des jurisconsultes les plus rigoristes. Il divise les arts en ceux qui sont licites, ceux qui sont répréhensibles et ceux qui sont interdits, jugeant licite ce qui a rapport à la religion ou suscite la ferveur religieuse et tendant à considérer comme répréhensible ou interdit, ce qui vise à divertir ou distraire. Au fond, peu importe, car al-Ghazali fait peu de cas des arts et de l’éducation artistique, encore qu’il serait injuste de faire abstraction des critères et idées de son époque pour le juger à la seule aune de nos critères et de nos concepts [25].
Al-Ghazali préconise le mariage dès l’apparition des pulsions sexuelles et la maturité, mais il insiste aussi sur le fait que le mariage et la création d’une famille constituent une lourde responsabilité, que l’on ne saurait assumer sans s’y être préparé. A celui qui ne peut se marier, al-Ghazali conseille de s’efforcer de policer et de maîtriser son âme et de dompter ses désirs par le jeûne et les exercices spirituels [26].
Le concept de la science et les méthodes de l’enseignement
Avec l’émergence de la religion nouvelle (l’islam) et de la civilisation qui l’a accompagnée est apparue toute une série de disciplines d’ordre religieux et linguistique dont l’objet était le Coran, les hadith, le fiqh, la langue, les hauts faits et les campagnes militaires du Prophète, etc., ce que l’on a appelé les « sciences des Arabes ». Avec l’essor de la civilisation arabo-islamique, ses contacts et son interaction avec les autres civilisations et ses emprunts à celles-ci, est apparu un autre ensemble de disciplines — médecine, astronomie, chimie, mathématiques, philosophie ou logique — que l’on a appelé « sciences des étrangers ». De ces sciences, originales ou empruntées, est né et s’est rapidement développé un mouvement scientifique florissant, vite perturbé cependant par le conflit entre les sciences religieuses et les sciences de la philosophie et de la nature, entre les jurisconsultes et les philosophes.
Al-Ghazali, et son ouvrage Tahafut al-Falasifa [L’incohérence des philosophes], ont constitué un élément de ce conflit, qui s’est achevé par la victoire des jurisconsultes (et du soufisme) sur les philosophes et les savants. Mais les sciences religieuses sont sorties de ce combat exsangues, épuisées, d’autant qu’elles avaient dû fermer la porte à tout effort d’interprétation et instaurer le primat de l’imitation. C’est ainsi que la civilisation et la science arabes sortirent de l’ère de la création, de l’innovation et de l’imagination pour entrer dans celle de la reproduction, de l’imitation et de la compilation. Al-Ghazali, en tant que savant et en tant qu’enseignant, s’est intéressé à la problématique de la science : à ses concepts, à ses méthodes, à sa taxinomie et à ses objectifs [27]. La seule science vraie est pour lui la connaissance de Dieu, de ses livres et de ses messagers, du royaume de la terre et des cieux et de la loi de son Prophète, donc une « science religieuse », même si elle comprend l’étude de quelques aspects du monde d’ici-bas. Quant aux sciences profanes — la médecine, l’arithmétique, etc. — ce ne sont que des techniques (sina’a) [28].
La science a pour but d’aider l’être humain à réaliser sa plénitude et à parvenir au bonheur véritable — le bonheur dans l’au-delà — en se rapprochant de Dieu jusqu’à voir son visage [29]. L’intérêt de la science réside dans ses bienfaits et sa véridicité, si bien que les sciences religieuses sont supérieures aux sciences profanes, parce qu’elles servent à réussir la vie éternelle et non la vie terrestre éphémère, et parce qu’elles sont plus véridiques. Il ne faut pas en déduire qu’il faille ignorer entièrement les sciences profanes, qui ont aussi leur utilité, dans la mesure où la société en a besoin. C’est le cas de la médecine et des sciences du langage par
exemple [30]. Les philosophes et les savants musulmans — al-Kindi, al-Farabi, Ibn al-Nadim, Ibn Sina (Avicenne) et d’autres — avaient la passion du classement des sciences, subissant en cela l’influence des philosophes grecs, Aristote en particulier, mais la classification d’al-Ghazali est plus élaborée. Il distingue les sciences selon leur « nature », les divisant en sciences théoriques (théologie et sciences de la religion) et sciences pratiques (morale, économie domestique, politique) [31]. Il distingue aussi les sciences selon leur « origine », les divisant en sciences doctrinales, empruntées aux prophètes (unicité de Dieu, exégèse, rites, traditions, morale), et sciences rationnelles, produites par l’esprit humain (mathématiques, sciences médicales, théologie, etc.) [32].
Au yeux d’al-Ghazali, il n’y a pas de contradiction entre les sciences doctrinales et les sciences rationnelles, en ce sens que les divergences que certains décèlent entre les prescriptions de la Loi divine et les exigences de la raison sont dues selon lui au fait que celui qui cherche n’est pas capable de parvenir à la vérité ou a une mauvaise compréhension de la réalité de la Loi divine ou du jugement de la raison. En fait, les deux types de sciences se complètent et l’on ne saurait se contenter de l’une ou de l’autre uniquement. Le problème tient essentiellement au fait qu’il est dans la plupart des cas difficile, voire impossible, de les étudier et de les comprendre ensemble. Il s’agit de deux voies différentes, et qui s’intéresse à l’une ne peut que négliger l’autre [33].
Al-Ghazali classe enfin les sciences selon leur « finalité » (le but de la science), les divisant en sciences des rapports sociaux (régissant le comportement des êtres humains et leurs actes — les sciences des rites et des traditions) et sciences du dévoilement (ayant pour but d’appréhender la réalité des choses et leur essence), qui sont abstraites et ne peuvent être qu’un dévoilement, une lumière qui jaillit dans le coeur quand celui-ci est purifié, sciences que ni la parole ni l’écrit ne peuvent transmettre. Tel est le savoir suprême, la forme la plus vraie de la connaissance [34]. Le XIe siècle de l’ère chrétienne (Ve siècle de l’Hégire) a vu le triomphe des sciences de la religion sur la philosophie et les sciences de la nature, et les violents assauts d’al-Ghazali contre la philosophie ont été un des facteurs de l’affaiblissement de celle-ci dans l’Orient islamique.
Al-Ghazali distingue six branches dans le savoir des philosophes : mathématiques, logique, sciences naturelles, métaphysique, politique et morale. Ni les mathématiques, ni la logique ni les sciences naturelles ne sont incompatibles avec la religion ; aussi leur étude est-elle licite, si tant est que celui qui les étudie s’abstient de passer ensuite à la métaphysique et autres disciplines nuisibles. La métaphysique, quant à elle, est le savoir le plus dangereux, le plus incompatible avec la religion. La politique et la morale, enfin, ne sont pas incompatibles avec les sciences et les préceptes de la religion, le problème étant, là encore, que celui qui les étudie s’engage sur la pente glissante qui mène à l’étude d’autres savoirs réprouvés [35]. Curieusement, les attaques d’al-Ghazali contre la philosophie et les sciences de la nature, et sa contribution au déclin de ces dernières, ne l’ont pas empêché d’être aussi à l’origine de leur retour en tant que disciplines d’enseignement à Al-Azhar à la fin du XIXe siècle, en ce sens que le cheikh de cette université, Mohamed Al-Anbabi (1305 H/1878) a excipé de l’analyse d’al-Ghazali selon laquelle les sciences naturelles ne sont pas en contradiction avec la religion, ce qui rend leur enseignement licite [36].
Dans le monde islamique, le système éducatif comportait deux niveaux bien distincts, le primaire et le supérieur, et l’on aurait grand-peine à distinguer un niveau intermédiaire. L’enseignement primaire était dispensé dans les écoles en ce qui concerne la masse ou par des précepteurs dans le cas de l’élite, alors que l’enseignement supérieur avait pour cadre les divers établissements d’études islamiques (mosquées, madaris, maisons de la science et de la sagesse, ermitages soufis, confréries, hospices, etc.). Dans le primaire, le programme avait un caractère religieux très prononcé, et portait essentiellement sur l’étude du Coran et des préceptes de la religion, l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, ainsi que, parfois, des éléments de poésie et de grammaire, des récits et du calcul, une certaine importance étant aussi accordée à l’éducation morale. Dans le supérieur, le programme d’enseignement était, au début de l’islam, exclusivement religieux et portait sur l’exégèse, les hadith, le fiqh, le kalam et tout ce qui peut aider à assimiler ces savoirs, comme la linguistique, la littérature et la poésie, ainsi que sur des branches de la connaissance qui sont développées en marge des sciences religieuses, comme les récits, les campagnes militaires du prophète et l’histoire. Le développement de la civilisation islamique et l’assimilation par celle-ci de la science grecque ont donné naissance, à côté du programme d’enseignement islamique, à un nouveau programme d’enseignement où l’on étudiait la philosophie et les sciences de la nature (mathématiques, logique, médecine, astronomie, sciences naturelles, etc.). La synthèse de ces deux ensembles de savoirs n’était guère aisée, et rares étaient les étudiants et les savants capables de la réaliser. Du fait du déclin de la philosophie et des sciences naturelles, et de la virulence des attaques menées contre elles, ces disciplines ont peu à peu disparu des programmes d’enseignement à partir du XIXe siècle de l’ère chrétienne (Ve siècle de l’Hégire) et n’ont retrouvé leur droit de cité qu’au début du XIXe siècle, mais essentiellement dans des établissements scientifiques indépendants . Il convient de préciser que dans la civilisation arabo-islamique, les méthodes d’enseignement, loin d’être immuables et rigides, étaient caractérisées par la souplesse et par la liberté qu’avait l’élève de choisir les matières qu’il voulait étudier et les maîtres avec lesquels il allait les étudier.
Al-Ghazali définit deux ensembles bien distincts dans les programmes d’enseignement : d’une part, les sciences obligatoires, que tout le monde est tenu d’étudier, à savoir les sciences de la religion et les sciences complémentaires ou connexes comme la langue et la littérature, et, d’autre part, les sciences facultatives, dont l’étude est fonction des goûts et des capacités de l’élève. Ces dernières se divisent à leur tour en deux groupes : d’une part, les sciences révélées, au nombre de quatre, à savoir : les sources (le Livre, la sunna, le consensus (ijma) et les enseignements des compagnons du Prophète) ; le droit appliqué (jurisprudence et morale) ; les moyens (linguistique et grammaire) ; et les accessoires (lecture, exégèse, principes de la jurisprudence, chronique et généalogie) ; et d’autre part les sciences non révélées (médecine, mathématiques, poésie et histoire) [37]. Dans le choix des matières d’enseignement, le critère déterminant doit être l’utilité pour l’élève et la société, d’où la préférence donnée aux matières religieuses, qui aident à réussir la vie éternelle du Ciel, celle de l’au-delà, et non celle, éphémère, d’ici-bas. Al-Ghazali précise sa conception du contenu et des méthodes de l’enseignement lorsqu’il répartit comme suit les matières entre lesquelles les étudiants ont à choisir :
Il conseille de commencer par les sciences fondamentales : Coran, puis sunna, puis tafsir (exégèse) et les études coraniques. Viennent ensuite les sciences appliquées : fiqh, (jurisprudence), puis les sources du fiqh, etc. [39]. Al-Ghazali distingue ensuite dans chaque science trois niveaux, élémentaire, moyen et avancé (primaire, intermédiaire et supérieur), et précise les ouvrages qui peuvent être étudiés à chacun de ces niveaux et pour chacune des matières enseignées. Telle que la conçoit al-Ghazali, l’éducation n’est pas un simple processus par lequel l’enseignant transmet à l’élève des connaissances que ce dernier assimile ou non, sans aller plus loin. Il s’agit au contraire d’une « interaction » qui a des effets sur le maître comme sur l’élève, et leur est profitable à l’un comme à l’autre, le premier en étant récompensé de la bonne action qu’il accomplit en éduquant autrui et le second en acquérant des connaissances. Al-Ghazali attache une extrême importance au climat dans lequel se déroule le processus éducatif et à la qualité des relations qui doivent s’y établir, ce en quoi il continue et approfondit la tradition éducative islamique. Il voit dans l’enseignant un exemple, un modèle, et non un simple porteur ou transmetteur de savoir. Le travail du maître, loin de se limiter à l’enseignement d’une matière déterminée, embrasse tous les aspects de la personnalité et de la vie de l’élève, et ce dernier a le devoir de considérer le maître comme un père auquel il doit obéissance et respect [40].
Entre autres principes qui régissent le processus éducatif, al-Ghazali insiste sur le lien entre l’enseignement et les situations concrètes, et le besoin d’informations et de compétences, un savoir ou savoir-faire ne devant être enseigné que si le besoin s’en fait sentir, afin qu’il réponde à une demande et soit fonctionnel41 ; l’idée que l’enseignement ne peut avoir de véritable impact que s’il passe par la pratique effective, puisqu’il a pour but de créer des habitudes comportementales et non pas simplement d’inculquer un savoir [42] ; une conception proche de celle de la « perfection dans l’apprentissage », al-Ghazali recommandant au maître de ne pas passer d’un sujet à un autre ou d’une matière à une autre avant que l’élève ne maîtrise parfaitement le premier sujet ou la première matière : l’idée de « complémentarité des sciences », le maître se voyant conseiller de prêter attention aux relations entre les sciences; enfin, l’idée de progressivité et de patience dans l’enseignement [43].
En matière d’éducation religieuse, al-Ghazali préconise l’initiation précoce aux préceptes de la religion par la dictée, la mémorisation et l’imitation (mémorisation et pratique), sans qu’il soit besoin, au début, de compréhension. Vient ensuite l’étape d’explication, de compréhension et de pratique consciente [44]. Là encore, al-Ghazali reste fidèle à la tradition éducative islamique, qui commence par la mémorisation du Coran sans que celui-ci soit expliqué, l’inculcation des préceptes de la religion avant que ceux-ci ne soient clarifiés et la mise en pratique avant que celle-ci ne soit le fruit de la conviction.
Al-Ghazali, et son ouvrage Tahafut al-Falasifa [L’incohérence des philosophes], ont constitué un élément de ce conflit, qui s’est achevé par la victoire des jurisconsultes (et du soufisme) sur les philosophes et les savants. Mais les sciences religieuses sont sorties de ce combat exsangues, épuisées, d’autant qu’elles avaient dû fermer la porte à tout effort d’interprétation et instaurer le primat de l’imitation. C’est ainsi que la civilisation et la science arabes sortirent de l’ère de la création, de l’innovation et de l’imagination pour entrer dans celle de la reproduction, de l’imitation et de la compilation. Al-Ghazali, en tant que savant et en tant qu’enseignant, s’est intéressé à la problématique de la science : à ses concepts, à ses méthodes, à sa taxinomie et à ses objectifs [27]. La seule science vraie est pour lui la connaissance de Dieu, de ses livres et de ses messagers, du royaume de la terre et des cieux et de la loi de son Prophète, donc une « science religieuse », même si elle comprend l’étude de quelques aspects du monde d’ici-bas. Quant aux sciences profanes — la médecine, l’arithmétique, etc. — ce ne sont que des techniques (sina’a) [28].
La science a pour but d’aider l’être humain à réaliser sa plénitude et à parvenir au bonheur véritable — le bonheur dans l’au-delà — en se rapprochant de Dieu jusqu’à voir son visage [29]. L’intérêt de la science réside dans ses bienfaits et sa véridicité, si bien que les sciences religieuses sont supérieures aux sciences profanes, parce qu’elles servent à réussir la vie éternelle et non la vie terrestre éphémère, et parce qu’elles sont plus véridiques. Il ne faut pas en déduire qu’il faille ignorer entièrement les sciences profanes, qui ont aussi leur utilité, dans la mesure où la société en a besoin. C’est le cas de la médecine et des sciences du langage par
exemple [30]. Les philosophes et les savants musulmans — al-Kindi, al-Farabi, Ibn al-Nadim, Ibn Sina (Avicenne) et d’autres — avaient la passion du classement des sciences, subissant en cela l’influence des philosophes grecs, Aristote en particulier, mais la classification d’al-Ghazali est plus élaborée. Il distingue les sciences selon leur « nature », les divisant en sciences théoriques (théologie et sciences de la religion) et sciences pratiques (morale, économie domestique, politique) [31]. Il distingue aussi les sciences selon leur « origine », les divisant en sciences doctrinales, empruntées aux prophètes (unicité de Dieu, exégèse, rites, traditions, morale), et sciences rationnelles, produites par l’esprit humain (mathématiques, sciences médicales, théologie, etc.) [32].
Au yeux d’al-Ghazali, il n’y a pas de contradiction entre les sciences doctrinales et les sciences rationnelles, en ce sens que les divergences que certains décèlent entre les prescriptions de la Loi divine et les exigences de la raison sont dues selon lui au fait que celui qui cherche n’est pas capable de parvenir à la vérité ou a une mauvaise compréhension de la réalité de la Loi divine ou du jugement de la raison. En fait, les deux types de sciences se complètent et l’on ne saurait se contenter de l’une ou de l’autre uniquement. Le problème tient essentiellement au fait qu’il est dans la plupart des cas difficile, voire impossible, de les étudier et de les comprendre ensemble. Il s’agit de deux voies différentes, et qui s’intéresse à l’une ne peut que négliger l’autre [33].
Al-Ghazali classe enfin les sciences selon leur « finalité » (le but de la science), les divisant en sciences des rapports sociaux (régissant le comportement des êtres humains et leurs actes — les sciences des rites et des traditions) et sciences du dévoilement (ayant pour but d’appréhender la réalité des choses et leur essence), qui sont abstraites et ne peuvent être qu’un dévoilement, une lumière qui jaillit dans le coeur quand celui-ci est purifié, sciences que ni la parole ni l’écrit ne peuvent transmettre. Tel est le savoir suprême, la forme la plus vraie de la connaissance [34]. Le XIe siècle de l’ère chrétienne (Ve siècle de l’Hégire) a vu le triomphe des sciences de la religion sur la philosophie et les sciences de la nature, et les violents assauts d’al-Ghazali contre la philosophie ont été un des facteurs de l’affaiblissement de celle-ci dans l’Orient islamique.
Al-Ghazali distingue six branches dans le savoir des philosophes : mathématiques, logique, sciences naturelles, métaphysique, politique et morale. Ni les mathématiques, ni la logique ni les sciences naturelles ne sont incompatibles avec la religion ; aussi leur étude est-elle licite, si tant est que celui qui les étudie s’abstient de passer ensuite à la métaphysique et autres disciplines nuisibles. La métaphysique, quant à elle, est le savoir le plus dangereux, le plus incompatible avec la religion. La politique et la morale, enfin, ne sont pas incompatibles avec les sciences et les préceptes de la religion, le problème étant, là encore, que celui qui les étudie s’engage sur la pente glissante qui mène à l’étude d’autres savoirs réprouvés [35]. Curieusement, les attaques d’al-Ghazali contre la philosophie et les sciences de la nature, et sa contribution au déclin de ces dernières, ne l’ont pas empêché d’être aussi à l’origine de leur retour en tant que disciplines d’enseignement à Al-Azhar à la fin du XIXe siècle, en ce sens que le cheikh de cette université, Mohamed Al-Anbabi (1305 H/1878) a excipé de l’analyse d’al-Ghazali selon laquelle les sciences naturelles ne sont pas en contradiction avec la religion, ce qui rend leur enseignement licite [36].
Dans le monde islamique, le système éducatif comportait deux niveaux bien distincts, le primaire et le supérieur, et l’on aurait grand-peine à distinguer un niveau intermédiaire. L’enseignement primaire était dispensé dans les écoles en ce qui concerne la masse ou par des précepteurs dans le cas de l’élite, alors que l’enseignement supérieur avait pour cadre les divers établissements d’études islamiques (mosquées, madaris, maisons de la science et de la sagesse, ermitages soufis, confréries, hospices, etc.). Dans le primaire, le programme avait un caractère religieux très prononcé, et portait essentiellement sur l’étude du Coran et des préceptes de la religion, l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, ainsi que, parfois, des éléments de poésie et de grammaire, des récits et du calcul, une certaine importance étant aussi accordée à l’éducation morale. Dans le supérieur, le programme d’enseignement était, au début de l’islam, exclusivement religieux et portait sur l’exégèse, les hadith, le fiqh, le kalam et tout ce qui peut aider à assimiler ces savoirs, comme la linguistique, la littérature et la poésie, ainsi que sur des branches de la connaissance qui sont développées en marge des sciences religieuses, comme les récits, les campagnes militaires du prophète et l’histoire. Le développement de la civilisation islamique et l’assimilation par celle-ci de la science grecque ont donné naissance, à côté du programme d’enseignement islamique, à un nouveau programme d’enseignement où l’on étudiait la philosophie et les sciences de la nature (mathématiques, logique, médecine, astronomie, sciences naturelles, etc.). La synthèse de ces deux ensembles de savoirs n’était guère aisée, et rares étaient les étudiants et les savants capables de la réaliser. Du fait du déclin de la philosophie et des sciences naturelles, et de la virulence des attaques menées contre elles, ces disciplines ont peu à peu disparu des programmes d’enseignement à partir du XIXe siècle de l’ère chrétienne (Ve siècle de l’Hégire) et n’ont retrouvé leur droit de cité qu’au début du XIXe siècle, mais essentiellement dans des établissements scientifiques indépendants . Il convient de préciser que dans la civilisation arabo-islamique, les méthodes d’enseignement, loin d’être immuables et rigides, étaient caractérisées par la souplesse et par la liberté qu’avait l’élève de choisir les matières qu’il voulait étudier et les maîtres avec lesquels il allait les étudier.
Al-Ghazali définit deux ensembles bien distincts dans les programmes d’enseignement : d’une part, les sciences obligatoires, que tout le monde est tenu d’étudier, à savoir les sciences de la religion et les sciences complémentaires ou connexes comme la langue et la littérature, et, d’autre part, les sciences facultatives, dont l’étude est fonction des goûts et des capacités de l’élève. Ces dernières se divisent à leur tour en deux groupes : d’une part, les sciences révélées, au nombre de quatre, à savoir : les sources (le Livre, la sunna, le consensus (ijma) et les enseignements des compagnons du Prophète) ; le droit appliqué (jurisprudence et morale) ; les moyens (linguistique et grammaire) ; et les accessoires (lecture, exégèse, principes de la jurisprudence, chronique et généalogie) ; et d’autre part les sciences non révélées (médecine, mathématiques, poésie et histoire) [37]. Dans le choix des matières d’enseignement, le critère déterminant doit être l’utilité pour l’élève et la société, d’où la préférence donnée aux matières religieuses, qui aident à réussir la vie éternelle du Ciel, celle de l’au-delà, et non celle, éphémère, d’ici-bas. Al-Ghazali précise sa conception du contenu et des méthodes de l’enseignement lorsqu’il répartit comme suit les matières entre lesquelles les étudiants ont à choisir :
- Les savoirs louables en petite comme en grande quantité (connaissance de Dieu, de Ses attributs, de Ses actes, de la Loi qu’Il a donnée à Sa création et de Sa sagesse qui lui a fait donner la primauté de l’autre monde sur le monde d’ici-bas).
- Les savoirs condamnables en petite comme en grande quantité (sorcellerie, magie, astrologie).
- Les savoirs louables dans une certaine mesure (tafsir, hadith , fiqh, kalam, linguistique, grammaire, etc.) [38].
Il conseille de commencer par les sciences fondamentales : Coran, puis sunna, puis tafsir (exégèse) et les études coraniques. Viennent ensuite les sciences appliquées : fiqh, (jurisprudence), puis les sources du fiqh, etc. [39]. Al-Ghazali distingue ensuite dans chaque science trois niveaux, élémentaire, moyen et avancé (primaire, intermédiaire et supérieur), et précise les ouvrages qui peuvent être étudiés à chacun de ces niveaux et pour chacune des matières enseignées. Telle que la conçoit al-Ghazali, l’éducation n’est pas un simple processus par lequel l’enseignant transmet à l’élève des connaissances que ce dernier assimile ou non, sans aller plus loin. Il s’agit au contraire d’une « interaction » qui a des effets sur le maître comme sur l’élève, et leur est profitable à l’un comme à l’autre, le premier en étant récompensé de la bonne action qu’il accomplit en éduquant autrui et le second en acquérant des connaissances. Al-Ghazali attache une extrême importance au climat dans lequel se déroule le processus éducatif et à la qualité des relations qui doivent s’y établir, ce en quoi il continue et approfondit la tradition éducative islamique. Il voit dans l’enseignant un exemple, un modèle, et non un simple porteur ou transmetteur de savoir. Le travail du maître, loin de se limiter à l’enseignement d’une matière déterminée, embrasse tous les aspects de la personnalité et de la vie de l’élève, et ce dernier a le devoir de considérer le maître comme un père auquel il doit obéissance et respect [40].
Entre autres principes qui régissent le processus éducatif, al-Ghazali insiste sur le lien entre l’enseignement et les situations concrètes, et le besoin d’informations et de compétences, un savoir ou savoir-faire ne devant être enseigné que si le besoin s’en fait sentir, afin qu’il réponde à une demande et soit fonctionnel41 ; l’idée que l’enseignement ne peut avoir de véritable impact que s’il passe par la pratique effective, puisqu’il a pour but de créer des habitudes comportementales et non pas simplement d’inculquer un savoir [42] ; une conception proche de celle de la « perfection dans l’apprentissage », al-Ghazali recommandant au maître de ne pas passer d’un sujet à un autre ou d’une matière à une autre avant que l’élève ne maîtrise parfaitement le premier sujet ou la première matière : l’idée de « complémentarité des sciences », le maître se voyant conseiller de prêter attention aux relations entre les sciences; enfin, l’idée de progressivité et de patience dans l’enseignement [43].
En matière d’éducation religieuse, al-Ghazali préconise l’initiation précoce aux préceptes de la religion par la dictée, la mémorisation et l’imitation (mémorisation et pratique), sans qu’il soit besoin, au début, de compréhension. Vient ensuite l’étape d’explication, de compréhension et de pratique consciente [44]. Là encore, al-Ghazali reste fidèle à la tradition éducative islamique, qui commence par la mémorisation du Coran sans que celui-ci soit expliqué, l’inculcation des préceptes de la religion avant que ceux-ci ne soient clarifiés et la mise en pratique avant que celle-ci ne soit le fruit de la conviction.
__________________________
1. Nabil Nofal (Égypte). Coordonnateur de l’Unité régionale d’innovation éducative dans les États arabes (EIPDAS/UNESCO). A enseigné les sciences de l’éducation dan s plusieurs universités arabes avant de devenir expert en administration, planification et économie de l’éducation pour l’UNESCO. Auteur de nombreuses publications et de traductions sur l’éducation et la culture.
2. Sur la vie d’al-Ghazali, voir Abdelkarim Al-Othman, Sirat al-Ghazali wa Aqwal al-Mutaqaddimin fihi [a vie d’al-Ghazali et ce qu’en ont dit les anciens] (Damas, Dar Al-Fikr, sans date).
3. Une madrasa (pl. madaris) était un établissement d’enseignement (proche des facultés et universités actuelles) créé pour la première fois aux alentours du Ve siècle de l’Hégire pour assurer l’enseignement supérieur religieux en général et diffuser les doctrines sunnites en particulier. Habituellement, les élèves étaient logés dans l’établissement, et les services du waqf les prenaient en charge pour leur permettre de se consacrer à leurs études. Une autre de leurs caractéristiques est que les enseignants y étaient nommés par l’État.
4. Voir Ibn Ruchd (Averroès), Tahafut al-Tahafut [Incohérence de l’incohérence] (Le Caire, Al-Matbaa Al- Ilamiya, 1302 H) et Fasl al-Maqal fima bayn al Shari’a wa-l-Hikma min Ittisal [Traité décisif et exposition de la convergence qui existe entre la Loi religieuse et la philosophie] (Le Caire, Al Maktaba Al- Mahmadiyya, sans date).
5. Le lecteur trouvera une description détaillée de cette crise spirituelle et intellectuelle dans l’ouvrage célèbre d’al-Ghazali Al-Munqidh min al-Dalal [Erreur et délivrance]. D’aucuns doutent que cette crise ait été exclusivement spirituelle et sans rapport avec les événements politiques du moment — luttes internes entre les sultans seljoukides, danger croissant des batinites, etc.
6. Parmi ces oeuvres, Bidayat al-Hidaya [Les prémices du droit chemin], Ayyuha l-Walad [Lettre au Disciple], Al-Kashf wal-Tabyin fi Ghurur al-Khalq ajma’in [Dévoilement et démonstration des errements de toutes les créatures], Al-Maqsid al-asna [L’idéal sublime], Jawahir al-Qur’an [Les perles du Coran], Al-Risalat al-Laduniyya [Le message divin], Al-Madnun bihi ‘ala ghayr Ahlihi [Ce qu’il faut celer à ceux qui ne peuvent le comprendre].
7. Parmi les écrits de cette période, citons Al-Mustasfa fi’Ilm al-Usul (Le nec plus ultra de la science des principes) et le célèbre Al-Munqidh min al-Dalal [Erreur et délivrance].
8. Parmi ses derniers écrits, il faut citer aussi Al-Durra al-Fakhira [La perle précieuse] et Iljam al ‘Awamm ‘an ‘ Ilm al-Kalam [La théologie n’est pas pour le commun].
9. Les écrits d’al-Ghazali ont en règle générale un caractère religieux, mais la composante théologique de sa pensée se trouve surtout dans : Al-Risalat al-Qudsiyya fi qawa’ id al- ‘aqa’id [Le message sacré sur les bases des croyances] (qui fait partie d’ Ihya’ ‘Ulum al-Din [Vivification des sciences de la foi], Al-Iqtisad fil-I’tiqad [Le juste milieu dans la croyance], Mushkilat al-anwar [Le problème des illuminations], Ma’arij al-Quds fi Madarij Ma’rifat an-Nafs [L’échelle de la sainteté et les degrés de la connaissance de soi], Al-Maqsid al-Asna fi Sharh Ma’ani Asma’Allah al-Husna [L’idéal sublime dans l’exégèse des plus beaux noms de Dieu], Tahafut al-Falasifa [L’incohérence des philosophes], Kitab Al-arba’in fi Usul al-Din [Les quarante déterminations rationnelles des principes de la religion].
10. Voir en particulier Tahafut al-Falasifa , p. 237 et suiv.
11. Voir Ma’arij al-Quds fi Madarij Ma’rifat an-Nafs et Ihya’ ‘Ulum al-Din, vol. 3.
12. Al-Ghazali met l’accent, dans ses ouvrages sur la préservation de l’ordre établi, et il tend à prendre le parti de la société (la umma ou communauté des croyants) face à l’individu, de l’élite face au commun et du souverain face au peuple, allant même jusqu’à dénier aux sujets d’un prince injuste le droit de se rebeller (question qui a beaucoup occupé les jurisconsultes musulmans) et à ne laisser aux victimes de l’arbitraired’autre issue que l’émigration. Voir à ce sujet Al-Mustasfa fi ‘ Ilm al-Usul (vol. 1, p. 111 et suiv.), Ihya’ ‘Ulum al-Din (vol. 1, p. 50 et suiv.) et Al-Iqtisad fil-I’tiqad (p. 118 et suiv.).
13. Al-Ghazali est un précurseur de Descartes et de Hume en ce sens qu’il fait du « doute » un moyen de parvenir à la connaissance. Sur le problème du doute, les moyens de parvenir à la connaissance et lesniveaux et la vérité de celle-ci, voir en particulier : Al-Munqidh min al-Dalal ; Mi’yar al-’Ilm [L’étalon dela science et des connaissances rationnelles] et Al-Ma’arif al-Aqliya.
14. Sur la morale dans la pensée d’al-Ghazali, voir Ihya’ ‘Ulum al-Din , en particulier les vol. 3 et 4.
15. Ihya’ ‘Ulum al-Din , vol. 1, p. 46 et vol. 4, p. 83 ; Al-Iqtisad fi-l-I’tiqad, p. 118 et 119 ; Mizan al-’Amal [Critère de l’action], p. 98. Dans le discours d’al-Ghazali sur l’éducation apparaît clairement l’influenced’Ibn Miskawayh. Comparer à ce sujet Tahdhib al-Akhlaq wa-Tathir al-A’Araq [La réforme des moeurs et la purification des races] (Le Caire, Al-Matbaa Al-Adabiya, 1317 H).
16. Ihya’ ‘Ulum al-Din , vol. 3, p. 61-62 ; Mizan al-’Amal, p. 124
17. Ihya’ ‘Ulum al-Din , vol. 3, p. 62-63 et 243.
18. Ibid., vol. 3, p. 52 ; tome IV, p. 256-257.
19. Ibid., vol. 3, p. 61-62 ; ici aussi apparaît l’influence considérable qu’Ibn Miskawayh a exercée — par son
Tahdhib al-Akhlaq wa-Tathir al-A’Araq [La réforme des moeurs et la purification des races] — sur al-
Ghazali.
20. Ibid., vol. 3, p. 49-50.
21. Ibid., vol. 3, p. 63.
22. Ibid., vol. 3, p. 62-63 ; là encore, al-Ghazali emprunte à Ibn Miskawayh.
23. Ibid., vol. 3, p. 62.
24. Ibid., vol. 3, p. 52, 61 ; Bidayat al-Hidaya, p. 277-278 ; Al-Qistas al-Mustaqim [La balance juste], p. 6-7.
25. Ihya’ ‘Ulum al-Din , vol. 2 , p. 213-214, 270-271 ; vol. 4, p. 243-247.
26. Ibid., vol. 3, p. 19-27.
27. Voir sur ce sujet Ibid., vol.1, chapitre premier.
28. Ibid., vol. 1 p. 28-29, 43.
29. Ibid., vol. 1 p. 8, 10, 51.
30. Ibid., vol. 1 p. 45-46 ; Al-Risalat al-Laduniyya, p. 99-100.
31. Mizan al-’Amal p. 32-33.
32. Ihya’ ‘Ulum al-Din , vol. 3, p. 13-16.
33. Ibid.,vol. 3, p. 15-16 ; Mizan al-’Amal, p. 86.
34. Ihya’ ‘Ulum al-Din , vol.1, p. 16-18 ; Fatihat al-’Ulum, p. 39-42.
35. Al-Munqidh min al-Dalal, p. 140-141 ; Ihya’ ‘Ulum al-Din , vol. 1, p. 9 ; Maqasid al-Falasifa (Les
intentions des philosophes), p. 138-140 ; Tahaf ut al-Falasifa, en général.
36. Voir Abbas Mahmud al-’Aqqad : Muhammad Abduh (Le Caire, Maktabat Misr, 1926).
37. Ihya’ ‘Ulum al-Din , vol. 1, p. 13-14, 46-48 ; Fatihat al-’Ulum, vol. 1, p. 13-14, 46-48 ; Fatihat al-’Ulum,
p. 35-39 ; Al-Risalat al-Laduniyya, p. 99-100, 108-109.
38. Ihya’ ‘Ulum al-Din , vol. 1, p. 33-34.
39. Ibid., vol. 1, p. 34.
40. Ibid., vol. 1, p. 42-51.
41. Ibid., vol. 1, p. 12.
42. Ibid., vol. 3, p. 49-51 ; ; Mizan al-’Amal, p. 42-43.
43. Ibid., vol. 1, p. 45.
44. Ibid., vol. 1, p. 80-81.
1. Nabil Nofal (Égypte). Coordonnateur de l’Unité régionale d’innovation éducative dans les États arabes (EIPDAS/UNESCO). A enseigné les sciences de l’éducation dan s plusieurs universités arabes avant de devenir expert en administration, planification et économie de l’éducation pour l’UNESCO. Auteur de nombreuses publications et de traductions sur l’éducation et la culture.
2. Sur la vie d’al-Ghazali, voir Abdelkarim Al-Othman, Sirat al-Ghazali wa Aqwal al-Mutaqaddimin fihi [a vie d’al-Ghazali et ce qu’en ont dit les anciens] (Damas, Dar Al-Fikr, sans date).
3. Une madrasa (pl. madaris) était un établissement d’enseignement (proche des facultés et universités actuelles) créé pour la première fois aux alentours du Ve siècle de l’Hégire pour assurer l’enseignement supérieur religieux en général et diffuser les doctrines sunnites en particulier. Habituellement, les élèves étaient logés dans l’établissement, et les services du waqf les prenaient en charge pour leur permettre de se consacrer à leurs études. Une autre de leurs caractéristiques est que les enseignants y étaient nommés par l’État.
4. Voir Ibn Ruchd (Averroès), Tahafut al-Tahafut [Incohérence de l’incohérence] (Le Caire, Al-Matbaa Al- Ilamiya, 1302 H) et Fasl al-Maqal fima bayn al Shari’a wa-l-Hikma min Ittisal [Traité décisif et exposition de la convergence qui existe entre la Loi religieuse et la philosophie] (Le Caire, Al Maktaba Al- Mahmadiyya, sans date).
5. Le lecteur trouvera une description détaillée de cette crise spirituelle et intellectuelle dans l’ouvrage célèbre d’al-Ghazali Al-Munqidh min al-Dalal [Erreur et délivrance]. D’aucuns doutent que cette crise ait été exclusivement spirituelle et sans rapport avec les événements politiques du moment — luttes internes entre les sultans seljoukides, danger croissant des batinites, etc.
6. Parmi ces oeuvres, Bidayat al-Hidaya [Les prémices du droit chemin], Ayyuha l-Walad [Lettre au Disciple], Al-Kashf wal-Tabyin fi Ghurur al-Khalq ajma’in [Dévoilement et démonstration des errements de toutes les créatures], Al-Maqsid al-asna [L’idéal sublime], Jawahir al-Qur’an [Les perles du Coran], Al-Risalat al-Laduniyya [Le message divin], Al-Madnun bihi ‘ala ghayr Ahlihi [Ce qu’il faut celer à ceux qui ne peuvent le comprendre].
7. Parmi les écrits de cette période, citons Al-Mustasfa fi’Ilm al-Usul (Le nec plus ultra de la science des principes) et le célèbre Al-Munqidh min al-Dalal [Erreur et délivrance].
8. Parmi ses derniers écrits, il faut citer aussi Al-Durra al-Fakhira [La perle précieuse] et Iljam al ‘Awamm ‘an ‘ Ilm al-Kalam [La théologie n’est pas pour le commun].
9. Les écrits d’al-Ghazali ont en règle générale un caractère religieux, mais la composante théologique de sa pensée se trouve surtout dans : Al-Risalat al-Qudsiyya fi qawa’ id al- ‘aqa’id [Le message sacré sur les bases des croyances] (qui fait partie d’ Ihya’ ‘Ulum al-Din [Vivification des sciences de la foi], Al-Iqtisad fil-I’tiqad [Le juste milieu dans la croyance], Mushkilat al-anwar [Le problème des illuminations], Ma’arij al-Quds fi Madarij Ma’rifat an-Nafs [L’échelle de la sainteté et les degrés de la connaissance de soi], Al-Maqsid al-Asna fi Sharh Ma’ani Asma’Allah al-Husna [L’idéal sublime dans l’exégèse des plus beaux noms de Dieu], Tahafut al-Falasifa [L’incohérence des philosophes], Kitab Al-arba’in fi Usul al-Din [Les quarante déterminations rationnelles des principes de la religion].
10. Voir en particulier Tahafut al-Falasifa , p. 237 et suiv.
11. Voir Ma’arij al-Quds fi Madarij Ma’rifat an-Nafs et Ihya’ ‘Ulum al-Din, vol. 3.
12. Al-Ghazali met l’accent, dans ses ouvrages sur la préservation de l’ordre établi, et il tend à prendre le parti de la société (la umma ou communauté des croyants) face à l’individu, de l’élite face au commun et du souverain face au peuple, allant même jusqu’à dénier aux sujets d’un prince injuste le droit de se rebeller (question qui a beaucoup occupé les jurisconsultes musulmans) et à ne laisser aux victimes de l’arbitraired’autre issue que l’émigration. Voir à ce sujet Al-Mustasfa fi ‘ Ilm al-Usul (vol. 1, p. 111 et suiv.), Ihya’ ‘Ulum al-Din (vol. 1, p. 50 et suiv.) et Al-Iqtisad fil-I’tiqad (p. 118 et suiv.).
13. Al-Ghazali est un précurseur de Descartes et de Hume en ce sens qu’il fait du « doute » un moyen de parvenir à la connaissance. Sur le problème du doute, les moyens de parvenir à la connaissance et lesniveaux et la vérité de celle-ci, voir en particulier : Al-Munqidh min al-Dalal ; Mi’yar al-’Ilm [L’étalon dela science et des connaissances rationnelles] et Al-Ma’arif al-Aqliya.
14. Sur la morale dans la pensée d’al-Ghazali, voir Ihya’ ‘Ulum al-Din , en particulier les vol. 3 et 4.
15. Ihya’ ‘Ulum al-Din , vol. 1, p. 46 et vol. 4, p. 83 ; Al-Iqtisad fi-l-I’tiqad, p. 118 et 119 ; Mizan al-’Amal [Critère de l’action], p. 98. Dans le discours d’al-Ghazali sur l’éducation apparaît clairement l’influenced’Ibn Miskawayh. Comparer à ce sujet Tahdhib al-Akhlaq wa-Tathir al-A’Araq [La réforme des moeurs et la purification des races] (Le Caire, Al-Matbaa Al-Adabiya, 1317 H).
16. Ihya’ ‘Ulum al-Din , vol. 3, p. 61-62 ; Mizan al-’Amal, p. 124
17. Ihya’ ‘Ulum al-Din , vol. 3, p. 62-63 et 243.
18. Ibid., vol. 3, p. 52 ; tome IV, p. 256-257.
19. Ibid., vol. 3, p. 61-62 ; ici aussi apparaît l’influence considérable qu’Ibn Miskawayh a exercée — par son
Tahdhib al-Akhlaq wa-Tathir al-A’Araq [La réforme des moeurs et la purification des races] — sur al-
Ghazali.
20. Ibid., vol. 3, p. 49-50.
21. Ibid., vol. 3, p. 63.
22. Ibid., vol. 3, p. 62-63 ; là encore, al-Ghazali emprunte à Ibn Miskawayh.
23. Ibid., vol. 3, p. 62.
24. Ibid., vol. 3, p. 52, 61 ; Bidayat al-Hidaya, p. 277-278 ; Al-Qistas al-Mustaqim [La balance juste], p. 6-7.
25. Ihya’ ‘Ulum al-Din , vol. 2 , p. 213-214, 270-271 ; vol. 4, p. 243-247.
26. Ibid., vol. 3, p. 19-27.
27. Voir sur ce sujet Ibid., vol.1, chapitre premier.
28. Ibid., vol. 1 p. 28-29, 43.
29. Ibid., vol. 1 p. 8, 10, 51.
30. Ibid., vol. 1 p. 45-46 ; Al-Risalat al-Laduniyya, p. 99-100.
31. Mizan al-’Amal p. 32-33.
32. Ihya’ ‘Ulum al-Din , vol. 3, p. 13-16.
33. Ibid.,vol. 3, p. 15-16 ; Mizan al-’Amal, p. 86.
34. Ihya’ ‘Ulum al-Din , vol.1, p. 16-18 ; Fatihat al-’Ulum, p. 39-42.
35. Al-Munqidh min al-Dalal, p. 140-141 ; Ihya’ ‘Ulum al-Din , vol. 1, p. 9 ; Maqasid al-Falasifa (Les
intentions des philosophes), p. 138-140 ; Tahaf ut al-Falasifa, en général.
36. Voir Abbas Mahmud al-’Aqqad : Muhammad Abduh (Le Caire, Maktabat Misr, 1926).
37. Ihya’ ‘Ulum al-Din , vol. 1, p. 13-14, 46-48 ; Fatihat al-’Ulum, vol. 1, p. 13-14, 46-48 ; Fatihat al-’Ulum,
p. 35-39 ; Al-Risalat al-Laduniyya, p. 99-100, 108-109.
38. Ihya’ ‘Ulum al-Din , vol. 1, p. 33-34.
39. Ibid., vol. 1, p. 34.
40. Ibid., vol. 1, p. 42-51.
41. Ibid., vol. 1, p. 12.
42. Ibid., vol. 3, p. 49-51 ; ; Mizan al-’Amal, p. 42-43.
43. Ibid., vol. 1, p. 45.
44. Ibid., vol. 1, p. 80-81.