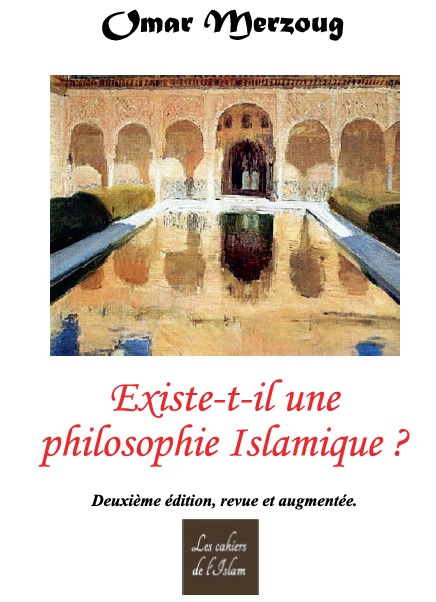Nous proposons ici la seconde partie de l'article de M.Tillier traitant des liens entre la judicature et l’État islamique. Dans la première partie l'auteur a commencé à nous montrer comment " la mise en oeuvre d’une procédure épistolaire entre cadis (kitāb al-qāḍī ilā l-qāḍī), fut peut-être une des expressions les plus significatives de la continuité étatique et de l’unité territoriale du dār al-islām." en finissant par créer un véritable réseau. Il continue ici à s'interroger "sur la constitution de tels réseaux, sur leur nature et sur leur mode de fonctionnement en Iraq entre le IIe/VIIIe et le IVe/Xe siècle".
Ce texte est publié avec les aimables autorisations de l'auteur et des éditions Bouchène.
Ce texte est publié avec les aimables autorisations de l'auteur et des éditions Bouchène.
L’institutionnalisation du réseau judiciaire
Les procédures de réception de la lettre, si sophistiquées qu’elles fussent, ne réduisaient pas à néant les risques de fraude et de contrefaçon. Le premier danger résidait dans l’absence de confrontation entre le défendeur et les témoins qui avaient déposé contre lui. Wakī‘ rapporte que le cadi de Wāsiṭ, Abū Šayba, reçut un jour une lettre de son homologue kūfiote par l’intermédiaire d’un demandeur. Il convoqua le défendeur, nommé al-Ḥağğāğ b. Dīnār, contre qui le cadi de Kūfa avait enregistré une preuve testimoniale. Surpris par la teneur de l’accusation, le défendeur protesta de son innocence et demanda un ajournement de l’audience. Il profita du délai qui lui était accordé pour se rendre à Kūfa et, sous un prétexte fallacieux, fit convoquer par le cadi le témoin qui avait déposé contre lui. La confrontation permit d’établir que le témoin n’avait en réalité jamais rencontré al-Ḥağğāğ b. Dīnār et qu’il avait été adroitement manipulé par le demandeur. Le cadi de Kūfa écrivit donc une nouvelle lettre à celui de Wāsiṭ pour annuler sa première missive et les poursuites contre al-Ḥağğāğ b. Dīnār furent abandonnées [36]. Grâce au voyage que le défendeur put entreprendre, le complot avorta. Mais tout accusé ne pouvait probablement abandonner ainsi ses affaires pour un long voyage et les risques d’erreur judiciaire due à la malveillance d’un habile plaideur demeuraient élevés.
Les erreurs ou les fraudes lors de l’acheminement de la lettre représentaient un second danger. Une lettre pouvait être contrefaite et portée par un plaideur qui, en réalité, n’avait jamais eu affaire à un quelconque cadi expéditeur, ou bien une lettre authentique pouvait être subtilisée et remplacée en cours de route [37]. Conscients des faiblesses de la procédure épistolaire, les juristes musulmans réfléchirent au moyen de sécuriser la transmission de la lettre. Au milieu du IIIe/IXe siècle, le ḥanafite al-Ḫaṣṣāf insista tout d’abord sur les règles de rédaction d’une telle missive. Le défendeur devait y être nominalement identifié avec une précision telle que tout risque d’homonymie soit écarté ; si toutefois un doute demeurait sur l’identité de l’accusé, la procédure devait être interrompue. La date mentionnée dans la lettre permettait éventuellement de dissiper les doutes à ce sujet, en écartant de l’accusation les homonymes décédés avant la rédaction. De même, l’identité et l’adresse des témoins de l’affaire devaient être soigneusement enregistrées dans la missive, afin que le cadi destinataire puisse diligenter une enquête à leur sujet [38]. Mais, surtout, les fuqahā’ tentèrent de sécuriser le transport de la lettre. Au IIe/VIIIe siècle, Ibn Abī Laylā et Sawwār b. ‘Abd Allāh avaient entrepris d’appliquer le principe de la bayyina à la procédure épistolaire, en faisant authentifier l’objet-lettre par deux témoins qui en reconnaissaient le sceau. Peut-être prévoyaient-ils déjà que ces témoins accompagnent le demandeur. Mais une telle authentification n’écartait pas tout risque de fraude : al-Šāfi‘ī évoque une affaire où une lettre apparemment authentique dans son aspect extérieur et portée en compagnie de deux témoins s’avéra finalement contrefaite [39]. C’est pourquoi les juristes ḥanafites prescrivirent finalement que la lettre soit accompagnée par deux témoins honorables qui ne témoigneraient pas simplement de l’authenticité matérielle de la missive, mais également de son contenu. Al-Ḫaṣṣāf demande au cadi expéditeur de lire sa lettre devant les témoins avant de la fermer et de leur en donner à chacun une copie leur servant d’aide-mémoire (taḏkira) [40]. Pour des cadis ḥanafites comme al-Ḥasan b. Ziyād al-Lu’lu’ī (m. 204/819-20), leur confirmation orale du contenu de la lettre était essentielle : ils devaient donc la connaître par coeur ou, à défaut, en posséder une copie [41]. Dans ces conditions, l’authentification matérielle de la lettre passait au second plan : le message pouvait être accepté même si le sceau du cadi expéditeur était brisé avant son arrivée à destination [42].
Tous les juristes ḥanafites ne considéraient pas le témoignage du contenu de la lettre comme indispensable [43]. Le courant se réclamant d’Abū Yūsuf demeurait attaché à la forme de la lettre : les témoins devaient surtout attester de sa provenance et de l’authenticité du sceau [44]. Il n’en demeure pas moins que, dans bien des cas, l’acheminement de la lettre en fut considérablement transformé : elle n’était plus confiée au seul demandeur ou à son représentant, mais convoyée par deux témoins qui, garants de son contenu, devenaient par là même les véritables porteurs de la missive. En confiant sa parole écrite à des témoins désignés pour cette mission, le cadi institutionnalisait le transport de la lettre. Cette procédure relevait juridiquement d’une extension de la bayyina, la preuve reine, à la correspondance entre cadis. Mais comment ne pas souligner la similitude entre cette procédure et d’antiques modes de communication ? Dans l’Arabie préislamique, les messages importants étaient souvent confiés à deux courriers, afin de doubler leurs chances de délivrance [45] – et, éventuellement, d’en garantir l’authenticité. Cet usage avait perduré à l’époque islamique et peut-être l’évolution de la procédure épistolaire fut elle aussi influencée par cette ancienne coutume arabe.
On pourrait croire en apparence que l’introduction du témoignage institutionnel dans la procédure épistolaire contredisait son objectif premier : éviter aux témoins d’une affaire d’accompagner le demandeur dans son voyage. Ce n’était pourtant pas le cas. En effet les témoins envoyés avec la missive n’étaient pas ceux du litige. Ces derniers se contentaient de leur déposition devant le cadi expéditeur, puis retournaient à leurs activités quotidiennes sédentaires. À l’inverse, les témoins de la lettre étaient désignés pour cette seule mission. Encore reste-t-il à déterminer qui étaient ces témoins susceptibles de s’absenter pendant de longues périodes afin de convoyer la correspondance judiciaire. Deux hypothèses peuvent être envisagées : il s’agissait soit de témoins instrumentaires, soit de témoins occasionnels. En Iraq, ces deux possibilités ne s’excluent pas mutuellement et correspondent peut-être à deux étapes successives.
L’apparition de témoins instrumentaires est traditionnellement associée à celle de listes officielles de šuhūd, au tournant du IIe/VIIIe et du IIIe/IXe siècle [46]. Dans une logique plus large de renforcement des structures judiciaires, les tribunaux intégrèrent de manière durable des témoins à l’honorabilité bien établie [47]. Les historiens de l’Islam considèrent souvent que l’institution des témoins instrumentaires professionnels se généralisa dès le début du IIIe/IXe siècle. Le cadi s’entourait d’un nombre limité de témoins triés sur le volet, que les particuliers sollicitaient pour valider leurs actes et, éventuellement, témoigner en justice. C’est à eux, de même, que le cadi pourrait avoir confié sa correspondance. Néanmoins, comme le soulignait Claude Cahen en 1970, rien ne prouve que la judicature suivit une évolution similaire dans toutes les provinces du dār al-islām. En Égypte, la formation d’un groupe de témoins instrumentaires autour du cadi est attestée à une époque ancienne, grâce aux biographies d’al-Kindī. Mais en Iraq, les Aḫbār al-quḍāt de Wakī‘ ne recèlent pas trace de quelconques listes de šuhūd et Cahen propose que l’émergence d’un corps restreint de témoins instrumentaires ne s’y produisit qu’au IVe/Xe siècle, par contamination du modèle égyptien [48].
Cette supposition n’est pas à prendre à la légère. L’Adab al-qāḍī d’al-Ḫaṣṣāf – représentatif de la doctrine iraqienne et inédit lorsque Cahen écrivit son article – en confirme peut-être la pertinence. Les passages attribuables à al-Ḫaṣṣāf lui-même – et non à son commentateur al-Ğaṣṣāṣ – ne font nulle référence à un groupe exclusif de témoins instrumentaires et présupposent, conformément à la doctrine d’Abū Ḥanīfa, que tout bon musulman est susceptible de témoigner [49]. Cela ne signifie pas, bien sûr, que les cadis iraqiens n’employaient pas des hommes honorables pour les assister à l’audience. Al-Ḫaṣṣāf signale ainsi que la lettre d’un cadi peut porter les sceaux de témoins à côté du sien [50], ce qui laisse penser qu’au milieu du IIIe/IXe siècle, des témoins étaient déjà sélectionnés par les cadis iraqiens pour travailler à leurs côtés. En revanche, un siècle plus tard, al-Ğaṣṣāṣ manifeste une tendance certaine à interpréter le texte de son prédécesseur dans le sens d’une institutionnalisation stricte du témoignage. Lors de l’arrivée en poste d’un cadi, al-Ḫaṣṣāf lui demande de se renseigner sur les hommes honorables (‘udūl) et fiables (ahl al-ṯiqa wa-l-amāna) de la ville et d’enregistrer leurs noms par quartiers. Avec le recul, cela pourrait passer pour l’établissement d’une liste de témoins instrumentaires. Pourtant, l’auteur ne parle pas explicitement de šuhūd dans ce passage, ni ne semble employer le terme ‘udūl dans le sens restrictif de « [témoins] honorables ». Al-Ḫaṣṣāf porte visiblement l’accent sur la « fiabilité » des individus ainsi répertoriés, ce qui sous-entend qu’il ne souhaite pas spécifiquement les utiliser comme témoins, mais plutôt comme « hommes de confiance » (umanā’) chargés d’administrer des biens pour le cadi. C’est seulement dans le commentaire d’al-Ğaṣṣāṣ que les deux catégories sont assimilées et que le terme šuhūd fait son apparition : pour le juriste du IVe/Xe siècle, cette enquête préliminaire entend classer les habitants en catégories sociales hiérarchisées (yurattibu li-kull wāḥid minhum martaba ‘alā mā yastaḥiqqu-hu wa-yunazzilu-hum manāzila-hum), procédure caractéristique de la définition d’une élite de témoins Instrumentaires [51].
C’est donc au cours du siècle qui sépare al-Ḫaṣṣāf d’al-Ğaṣṣāṣ que la restriction du témoignage à un groupe social restreint semble se produire en Iraq. Un récit d’al-Tanūḫī, déjà remarqué par Claude Cahen, vient étayer cette hypothèse. Ayant entendu qu’un ancien cadi de Baṣra, al-Taymī [52], avait agréé 36 000 témoins lors de sa judicature, al-Tanūḫī fut fort étonné et demanda des explications. Il lui fut répondu que tout individu honorable pouvait alors témoigner en faveur de son voisin et « qu’on ne connaissait pas de classement (tartīb) [des individu] en un groupe spécialisé dans le témoignage » : cette situation aurait perduré jusqu’à Ismā‘īl [b. Isḥāq], cadi mālikite de Bagdad à partir des années 250/864 [53]. Si cela est exact, c’est donc vers la fin de la vie d’al-Ḫaṣṣāf – peut-être à l’époque même où il rédigea son traité – que le témoignage commença, peu à peu, à se restreindre (de façon non exclusive [54]) à un groupe d’élite.
Les erreurs ou les fraudes lors de l’acheminement de la lettre représentaient un second danger. Une lettre pouvait être contrefaite et portée par un plaideur qui, en réalité, n’avait jamais eu affaire à un quelconque cadi expéditeur, ou bien une lettre authentique pouvait être subtilisée et remplacée en cours de route [37]. Conscients des faiblesses de la procédure épistolaire, les juristes musulmans réfléchirent au moyen de sécuriser la transmission de la lettre. Au milieu du IIIe/IXe siècle, le ḥanafite al-Ḫaṣṣāf insista tout d’abord sur les règles de rédaction d’une telle missive. Le défendeur devait y être nominalement identifié avec une précision telle que tout risque d’homonymie soit écarté ; si toutefois un doute demeurait sur l’identité de l’accusé, la procédure devait être interrompue. La date mentionnée dans la lettre permettait éventuellement de dissiper les doutes à ce sujet, en écartant de l’accusation les homonymes décédés avant la rédaction. De même, l’identité et l’adresse des témoins de l’affaire devaient être soigneusement enregistrées dans la missive, afin que le cadi destinataire puisse diligenter une enquête à leur sujet [38]. Mais, surtout, les fuqahā’ tentèrent de sécuriser le transport de la lettre. Au IIe/VIIIe siècle, Ibn Abī Laylā et Sawwār b. ‘Abd Allāh avaient entrepris d’appliquer le principe de la bayyina à la procédure épistolaire, en faisant authentifier l’objet-lettre par deux témoins qui en reconnaissaient le sceau. Peut-être prévoyaient-ils déjà que ces témoins accompagnent le demandeur. Mais une telle authentification n’écartait pas tout risque de fraude : al-Šāfi‘ī évoque une affaire où une lettre apparemment authentique dans son aspect extérieur et portée en compagnie de deux témoins s’avéra finalement contrefaite [39]. C’est pourquoi les juristes ḥanafites prescrivirent finalement que la lettre soit accompagnée par deux témoins honorables qui ne témoigneraient pas simplement de l’authenticité matérielle de la missive, mais également de son contenu. Al-Ḫaṣṣāf demande au cadi expéditeur de lire sa lettre devant les témoins avant de la fermer et de leur en donner à chacun une copie leur servant d’aide-mémoire (taḏkira) [40]. Pour des cadis ḥanafites comme al-Ḥasan b. Ziyād al-Lu’lu’ī (m. 204/819-20), leur confirmation orale du contenu de la lettre était essentielle : ils devaient donc la connaître par coeur ou, à défaut, en posséder une copie [41]. Dans ces conditions, l’authentification matérielle de la lettre passait au second plan : le message pouvait être accepté même si le sceau du cadi expéditeur était brisé avant son arrivée à destination [42].
Tous les juristes ḥanafites ne considéraient pas le témoignage du contenu de la lettre comme indispensable [43]. Le courant se réclamant d’Abū Yūsuf demeurait attaché à la forme de la lettre : les témoins devaient surtout attester de sa provenance et de l’authenticité du sceau [44]. Il n’en demeure pas moins que, dans bien des cas, l’acheminement de la lettre en fut considérablement transformé : elle n’était plus confiée au seul demandeur ou à son représentant, mais convoyée par deux témoins qui, garants de son contenu, devenaient par là même les véritables porteurs de la missive. En confiant sa parole écrite à des témoins désignés pour cette mission, le cadi institutionnalisait le transport de la lettre. Cette procédure relevait juridiquement d’une extension de la bayyina, la preuve reine, à la correspondance entre cadis. Mais comment ne pas souligner la similitude entre cette procédure et d’antiques modes de communication ? Dans l’Arabie préislamique, les messages importants étaient souvent confiés à deux courriers, afin de doubler leurs chances de délivrance [45] – et, éventuellement, d’en garantir l’authenticité. Cet usage avait perduré à l’époque islamique et peut-être l’évolution de la procédure épistolaire fut elle aussi influencée par cette ancienne coutume arabe.
On pourrait croire en apparence que l’introduction du témoignage institutionnel dans la procédure épistolaire contredisait son objectif premier : éviter aux témoins d’une affaire d’accompagner le demandeur dans son voyage. Ce n’était pourtant pas le cas. En effet les témoins envoyés avec la missive n’étaient pas ceux du litige. Ces derniers se contentaient de leur déposition devant le cadi expéditeur, puis retournaient à leurs activités quotidiennes sédentaires. À l’inverse, les témoins de la lettre étaient désignés pour cette seule mission. Encore reste-t-il à déterminer qui étaient ces témoins susceptibles de s’absenter pendant de longues périodes afin de convoyer la correspondance judiciaire. Deux hypothèses peuvent être envisagées : il s’agissait soit de témoins instrumentaires, soit de témoins occasionnels. En Iraq, ces deux possibilités ne s’excluent pas mutuellement et correspondent peut-être à deux étapes successives.
L’apparition de témoins instrumentaires est traditionnellement associée à celle de listes officielles de šuhūd, au tournant du IIe/VIIIe et du IIIe/IXe siècle [46]. Dans une logique plus large de renforcement des structures judiciaires, les tribunaux intégrèrent de manière durable des témoins à l’honorabilité bien établie [47]. Les historiens de l’Islam considèrent souvent que l’institution des témoins instrumentaires professionnels se généralisa dès le début du IIIe/IXe siècle. Le cadi s’entourait d’un nombre limité de témoins triés sur le volet, que les particuliers sollicitaient pour valider leurs actes et, éventuellement, témoigner en justice. C’est à eux, de même, que le cadi pourrait avoir confié sa correspondance. Néanmoins, comme le soulignait Claude Cahen en 1970, rien ne prouve que la judicature suivit une évolution similaire dans toutes les provinces du dār al-islām. En Égypte, la formation d’un groupe de témoins instrumentaires autour du cadi est attestée à une époque ancienne, grâce aux biographies d’al-Kindī. Mais en Iraq, les Aḫbār al-quḍāt de Wakī‘ ne recèlent pas trace de quelconques listes de šuhūd et Cahen propose que l’émergence d’un corps restreint de témoins instrumentaires ne s’y produisit qu’au IVe/Xe siècle, par contamination du modèle égyptien [48].
Cette supposition n’est pas à prendre à la légère. L’Adab al-qāḍī d’al-Ḫaṣṣāf – représentatif de la doctrine iraqienne et inédit lorsque Cahen écrivit son article – en confirme peut-être la pertinence. Les passages attribuables à al-Ḫaṣṣāf lui-même – et non à son commentateur al-Ğaṣṣāṣ – ne font nulle référence à un groupe exclusif de témoins instrumentaires et présupposent, conformément à la doctrine d’Abū Ḥanīfa, que tout bon musulman est susceptible de témoigner [49]. Cela ne signifie pas, bien sûr, que les cadis iraqiens n’employaient pas des hommes honorables pour les assister à l’audience. Al-Ḫaṣṣāf signale ainsi que la lettre d’un cadi peut porter les sceaux de témoins à côté du sien [50], ce qui laisse penser qu’au milieu du IIIe/IXe siècle, des témoins étaient déjà sélectionnés par les cadis iraqiens pour travailler à leurs côtés. En revanche, un siècle plus tard, al-Ğaṣṣāṣ manifeste une tendance certaine à interpréter le texte de son prédécesseur dans le sens d’une institutionnalisation stricte du témoignage. Lors de l’arrivée en poste d’un cadi, al-Ḫaṣṣāf lui demande de se renseigner sur les hommes honorables (‘udūl) et fiables (ahl al-ṯiqa wa-l-amāna) de la ville et d’enregistrer leurs noms par quartiers. Avec le recul, cela pourrait passer pour l’établissement d’une liste de témoins instrumentaires. Pourtant, l’auteur ne parle pas explicitement de šuhūd dans ce passage, ni ne semble employer le terme ‘udūl dans le sens restrictif de « [témoins] honorables ». Al-Ḫaṣṣāf porte visiblement l’accent sur la « fiabilité » des individus ainsi répertoriés, ce qui sous-entend qu’il ne souhaite pas spécifiquement les utiliser comme témoins, mais plutôt comme « hommes de confiance » (umanā’) chargés d’administrer des biens pour le cadi. C’est seulement dans le commentaire d’al-Ğaṣṣāṣ que les deux catégories sont assimilées et que le terme šuhūd fait son apparition : pour le juriste du IVe/Xe siècle, cette enquête préliminaire entend classer les habitants en catégories sociales hiérarchisées (yurattibu li-kull wāḥid minhum martaba ‘alā mā yastaḥiqqu-hu wa-yunazzilu-hum manāzila-hum), procédure caractéristique de la définition d’une élite de témoins Instrumentaires [51].
C’est donc au cours du siècle qui sépare al-Ḫaṣṣāf d’al-Ğaṣṣāṣ que la restriction du témoignage à un groupe social restreint semble se produire en Iraq. Un récit d’al-Tanūḫī, déjà remarqué par Claude Cahen, vient étayer cette hypothèse. Ayant entendu qu’un ancien cadi de Baṣra, al-Taymī [52], avait agréé 36 000 témoins lors de sa judicature, al-Tanūḫī fut fort étonné et demanda des explications. Il lui fut répondu que tout individu honorable pouvait alors témoigner en faveur de son voisin et « qu’on ne connaissait pas de classement (tartīb) [des individu] en un groupe spécialisé dans le témoignage » : cette situation aurait perduré jusqu’à Ismā‘īl [b. Isḥāq], cadi mālikite de Bagdad à partir des années 250/864 [53]. Si cela est exact, c’est donc vers la fin de la vie d’al-Ḫaṣṣāf – peut-être à l’époque même où il rédigea son traité – que le témoignage commença, peu à peu, à se restreindre (de façon non exclusive [54]) à un groupe d’élite.
On peut donc envisager deux phases successives dans le renforcement de la procédure épistolaire :
1. Au IIIe/IXe siècle, les cadis iraqiens commençaient peut-être à prendre, parmi leurs auxiliaires, quelques témoins instrumentaires, mais il n’existait pas encore de groupe social limité de šuhūd. Le témoignage demeurait majoritairement le fait de témoins occasionnels, agréés de manière circonstancielle. À qui un cadi demandait-il donc d’accompagner ses lettres ? Aux quelques témoins dont il s’entourait ? Cela est peu vraisemblable, car l’activité du tribunal aurait souffert de leur éloignement. À des témoins occasionnels, connus pour leur honorabilité et chargés de missions ponctuelles ? Cela semble plus probable, bien que demeure la question de leur rémunération. Étaient-ils payés par le cadi ? Le cadi baṣrien Sawwār b. ‘Abd Allāh rémunérait les hommes de confiance à qui il confiait l’administration de biens (umanā’) [55]. Peut-être étaient-ils payés par les demandeurs – auquel cas cela marquerait le début de la « professionnalisation » du notariat en Iraq –,mais les sources n’en gardent pas trace. Enfin, si le modèle du témoignage occasionnel et non-professionnel était encore dominant, pourquoi ne pas envisager que la correspondance entre cadis ait emprunté des réseaux extrajudiciaires préexistants ? Adam J. Silverstein a montré le rôle essentiel des marchands, dès le IIIe/IXe siècle, pour la circulation des nouvelles officielles. Leurs lettres étaient parfois lues devant des cadis, qui transmettaient les informations importantes au pouvoir politique [56]. Qui, mieux que de tels professionnels du voyage, pouvait aisément convoyer une lettre de cadi en compagnie du demandeur ? Il suffisait que deux marchands, agréés comme témoins, soient en partance pour la ville du destinataire, pour que le cadi expéditeur recourre à leur service – peut-être bénévole. Ce n’est là qu’une conjecture, mais qui ne semble pas invraisemblable. Le réseau judiciaire fonctionnerait alors en partenariat avec des réseaux privés. Il s’agirait donc d’un réseau mixte : étatique par son rattachement, aux deux extrémités, à l’institution judiciaire, mais privé dans ses modes d’acheminement.
2. Au IVe/Xe siècle, le modèle égyptien se serait généralisé en Iraq et une classe réduite de témoins instrumentaires sélectionnés par le cadi aurait accaparé la majorité des témoignages. Il est probable que l’accompagnement des lettres judiciaires leur soit alors également échu. L’utilisation de témoins professionnels attachés aux tribunaux témoignerait de la mise en place d’un réseau étatique fort : l’institution judiciaire assurerait désormais le transport de la lettre, le demandeur n’ayant plus à se déplacer qu’en raison de sa nécessaire comparution devant le cadi destinataire. En cas de longue distance entre deux circonscriptions, un système de relais fut envisagé : en autorisant le témoignage rapporté (al-šahāda ‘alā l-šahāda), les juristes permirent aux témoins initiaux de transmettre leur déposition à d’autres témoins [57]. Si le cadi de Kūfa écrivait à celui de Hamaḏān, ses témoins pouvaient accompagner la lettre jusqu’à Baṣra, y passer le relais à deux témoins locaux, puis retourner chez eux. En théorie, une chaîne de témoins instrumentaires reliait donc entre eux tous les districts de l’empire, permettant la circulation d’une lettre judiciaire d’un bout à l’autre du monde musulman. De même, si le demandeur découvrait, à son arrivée à Hamaḏān, que son adversaire avait entre temps déménagé à Marw, il pouvait réclamer une nouvelle lettre adressée au cadi de cette dernière localité et poursuivre son voyage [58]. Il faut néanmoins nuancer le caractère « étatique » d’un tel réseau. Les témoins « professionnels » étaient certes sélectionnés par le cadi, placés sous son autorité hiérarchique [59] et enregistrés en nombre limité auprès du tribunal, mais ne semblaient pas rémunérés par ce dernier ni par le Trésor public : plus probablement payés par les particuliers recourant à leurs services, ils constituaient certes des « notaires » liés à l’autorité souveraine, mais fonctionnaient au quotidien comme une institution privée. Il est possible que les témoins instrumentaires choisis par le cadi pour acheminer sa correspondance aient été payés par le tribunal, comme d’autres auxiliaires, mais nous n’en avons pas trouvé de preuve textuelle. Par ailleurs, l’organisation des réseaux épistolaires relevait des seuls cadis, qui se fondaient sur la réflexion des fuqahā’ et non sur des instructions officielles de l’administration centrale. Dans un des rares modèles d’actes d’investiture connus pour l’époque abbasside – reproduit par Qudāma b. Ğa‘far –, le calife ordonne certes à son cadi d’accepter les missives de ses homologues, mais ses consignes demeurent très générales et n’abordent nullement les moyens d’acheminement de telles lettres. Leur authenticité semble encore devoir être établie par vérification du sceau et l’utilisation de témoins pour accompagner la lettre n’apparaît pas [60]. Au IVe/Xe siècle, la procédure épistolaire est ainsi représentative du fonctionnement plus général de la judicature, sorte de coquille étatique réglementée de l’intérieur par la réflexion combinée de juristes privés et de cadis.
1. Au IIIe/IXe siècle, les cadis iraqiens commençaient peut-être à prendre, parmi leurs auxiliaires, quelques témoins instrumentaires, mais il n’existait pas encore de groupe social limité de šuhūd. Le témoignage demeurait majoritairement le fait de témoins occasionnels, agréés de manière circonstancielle. À qui un cadi demandait-il donc d’accompagner ses lettres ? Aux quelques témoins dont il s’entourait ? Cela est peu vraisemblable, car l’activité du tribunal aurait souffert de leur éloignement. À des témoins occasionnels, connus pour leur honorabilité et chargés de missions ponctuelles ? Cela semble plus probable, bien que demeure la question de leur rémunération. Étaient-ils payés par le cadi ? Le cadi baṣrien Sawwār b. ‘Abd Allāh rémunérait les hommes de confiance à qui il confiait l’administration de biens (umanā’) [55]. Peut-être étaient-ils payés par les demandeurs – auquel cas cela marquerait le début de la « professionnalisation » du notariat en Iraq –,mais les sources n’en gardent pas trace. Enfin, si le modèle du témoignage occasionnel et non-professionnel était encore dominant, pourquoi ne pas envisager que la correspondance entre cadis ait emprunté des réseaux extrajudiciaires préexistants ? Adam J. Silverstein a montré le rôle essentiel des marchands, dès le IIIe/IXe siècle, pour la circulation des nouvelles officielles. Leurs lettres étaient parfois lues devant des cadis, qui transmettaient les informations importantes au pouvoir politique [56]. Qui, mieux que de tels professionnels du voyage, pouvait aisément convoyer une lettre de cadi en compagnie du demandeur ? Il suffisait que deux marchands, agréés comme témoins, soient en partance pour la ville du destinataire, pour que le cadi expéditeur recourre à leur service – peut-être bénévole. Ce n’est là qu’une conjecture, mais qui ne semble pas invraisemblable. Le réseau judiciaire fonctionnerait alors en partenariat avec des réseaux privés. Il s’agirait donc d’un réseau mixte : étatique par son rattachement, aux deux extrémités, à l’institution judiciaire, mais privé dans ses modes d’acheminement.
2. Au IVe/Xe siècle, le modèle égyptien se serait généralisé en Iraq et une classe réduite de témoins instrumentaires sélectionnés par le cadi aurait accaparé la majorité des témoignages. Il est probable que l’accompagnement des lettres judiciaires leur soit alors également échu. L’utilisation de témoins professionnels attachés aux tribunaux témoignerait de la mise en place d’un réseau étatique fort : l’institution judiciaire assurerait désormais le transport de la lettre, le demandeur n’ayant plus à se déplacer qu’en raison de sa nécessaire comparution devant le cadi destinataire. En cas de longue distance entre deux circonscriptions, un système de relais fut envisagé : en autorisant le témoignage rapporté (al-šahāda ‘alā l-šahāda), les juristes permirent aux témoins initiaux de transmettre leur déposition à d’autres témoins [57]. Si le cadi de Kūfa écrivait à celui de Hamaḏān, ses témoins pouvaient accompagner la lettre jusqu’à Baṣra, y passer le relais à deux témoins locaux, puis retourner chez eux. En théorie, une chaîne de témoins instrumentaires reliait donc entre eux tous les districts de l’empire, permettant la circulation d’une lettre judiciaire d’un bout à l’autre du monde musulman. De même, si le demandeur découvrait, à son arrivée à Hamaḏān, que son adversaire avait entre temps déménagé à Marw, il pouvait réclamer une nouvelle lettre adressée au cadi de cette dernière localité et poursuivre son voyage [58]. Il faut néanmoins nuancer le caractère « étatique » d’un tel réseau. Les témoins « professionnels » étaient certes sélectionnés par le cadi, placés sous son autorité hiérarchique [59] et enregistrés en nombre limité auprès du tribunal, mais ne semblaient pas rémunérés par ce dernier ni par le Trésor public : plus probablement payés par les particuliers recourant à leurs services, ils constituaient certes des « notaires » liés à l’autorité souveraine, mais fonctionnaient au quotidien comme une institution privée. Il est possible que les témoins instrumentaires choisis par le cadi pour acheminer sa correspondance aient été payés par le tribunal, comme d’autres auxiliaires, mais nous n’en avons pas trouvé de preuve textuelle. Par ailleurs, l’organisation des réseaux épistolaires relevait des seuls cadis, qui se fondaient sur la réflexion des fuqahā’ et non sur des instructions officielles de l’administration centrale. Dans un des rares modèles d’actes d’investiture connus pour l’époque abbasside – reproduit par Qudāma b. Ğa‘far –, le calife ordonne certes à son cadi d’accepter les missives de ses homologues, mais ses consignes demeurent très générales et n’abordent nullement les moyens d’acheminement de telles lettres. Leur authenticité semble encore devoir être établie par vérification du sceau et l’utilisation de témoins pour accompagner la lettre n’apparaît pas [60]. Au IVe/Xe siècle, la procédure épistolaire est ainsi représentative du fonctionnement plus général de la judicature, sorte de coquille étatique réglementée de l’intérieur par la réflexion combinée de juristes privés et de cadis.
Conclusion
Sans la procédure épistolaire, il eût été presque impossible pour un demandeur de prouver ses allégations dans une circonscription étrangère au préjudice. Bien plus, l’empire islamique se serait présenté comme une juxtaposition de districts indépendants les uns des autres, seulement reliés au pouvoir par le jeu administratif des désignations et des révocations. Même si les précautions peu à peu élaborées pour sécuriser la procédure n’écartaient pas tout risque, le réseau scripturaire reliant les cadis entre eux apparaît, en fin de compte, comme le principal moyen de réaliser l’unité judiciaire voulue par les Abbassides.
Il convient pourtant de souligner les limites d’un tel réseau, dues en grande partie aux contraintes d’une procédure longue et aléatoire. Non seulement les témoins du litige devaient être agréés avant que la lettre ne soit expédiée [61], mais certains juristes préconisaient aussi que le cadi destinataire diligente une enquête d’honorabilité sur les témoins de la missive [62]. Cela supposait plusieurs allers-retours entre les districts du destinataire et de l’expéditeur. Après avoir reçu une lettre de son homologue de Kūfa, le cadi de Bagdad envoyait des auxiliaires à Kūfa, qui enquêtaient sur les témoins puis revenaient à Bagdad. Alors, seulement, le cadi destinataire ouvrait la lettre et menait le procès à son terme. Si les deux districts étaient plus éloignés encore, la procédure pouvait durer des semaines, voire des mois ; l’enquête devenait un véritable casse-tête lorsque la lettre était authentifiée grâce à un témoignage rapporté. On peut douter que les cadis aient disposé d’un personnel assez nombreux pour respecter rigoureusement des règles aussi contraignantes. Dans quelle mesure la procédure épistolaire était-elle d’ailleurs employée sur la longue distance ? Pour les juristes ḥanafites, le cadi destinataire ne pouvait accepter la lettre qu’à condition que le cadi expéditeur fût encore en poste au moment de la réception [63]. En recourant à cette procédure, un plaideur prenait donc le risque d’effectuer le voyage en vain : si le cadi expéditeur mourait ou se voyait révoqué avant son arrivée à destination, et si le cadi destinataire en apprenait la nouvelle, il n’ouvrirait même pas la lettre. Dans la partie majoritairement ḥanafite de l’empire [64], il est donc possible que les communications entre cadis aient été géographiquement réduites à une province ou une série de provinces limitrophes.
Dans un ouvrage récent, Benjamin Jokisch a proposé que, loin de surgir d’une réflexion indépendante, la constitution du fiqh préclassique procéda d’une codification étatique, à l’époque de Hārūn al-Rašīd, par l’adaptation du droit romain précédemment codifié dans l’Empire byzantin [65]. Cette hypothèse simplifie considérablement la compréhension de la judicature, dont le fonctionnement pourrait procéder d’une telle entreprise étatique. Néanmoins, la formation du réseau judiciaire épistolaire reflète une histoire bien différente. La correspondance entre cadis apparaît avant tout comme une pratique, enracinée dans l’époque umayyade, qui se perfectionna au gré de la réflexion personnelle des cadis eux-mêmes. Cette pratique fit ensuite l’objet d’une théorisation juridique mais en marge de l’État, par des fuqahā’ indépendants. De son côté, le pouvoir politique n’entreprit nullement de codifier la procédure. Les instructions qu’il envoyait à ses cadis lors de leur investiture étaient à peine allusives ; bien plus, si le modèle reproduit par Qudāma b. Ğa‘far date bien du IVe/Xe siècle, ces recommandations accusaient un retard sérieux sur la réflexion juridique et sur la pratique elle-même. Le fiqh ne se développa pas seulement, à ses débuts, comme une critique de la pratique umayyade [66] : il vint également combler un vide dans un secteur normatif largement laissé à l’abandon par le pouvoir califal.
Cet article a déjà été publié in D. Coulon, Ch. Picard, D. Valérian (éd.), Espaces et Réseaux en Méditerranée VIe-XVIe siècle : Volume 2, La formation des réseaux , Paris, Bouchène, 2010, p. 91-107.
, Paris, Bouchène, 2010, p. 91-107.
Il convient pourtant de souligner les limites d’un tel réseau, dues en grande partie aux contraintes d’une procédure longue et aléatoire. Non seulement les témoins du litige devaient être agréés avant que la lettre ne soit expédiée [61], mais certains juristes préconisaient aussi que le cadi destinataire diligente une enquête d’honorabilité sur les témoins de la missive [62]. Cela supposait plusieurs allers-retours entre les districts du destinataire et de l’expéditeur. Après avoir reçu une lettre de son homologue de Kūfa, le cadi de Bagdad envoyait des auxiliaires à Kūfa, qui enquêtaient sur les témoins puis revenaient à Bagdad. Alors, seulement, le cadi destinataire ouvrait la lettre et menait le procès à son terme. Si les deux districts étaient plus éloignés encore, la procédure pouvait durer des semaines, voire des mois ; l’enquête devenait un véritable casse-tête lorsque la lettre était authentifiée grâce à un témoignage rapporté. On peut douter que les cadis aient disposé d’un personnel assez nombreux pour respecter rigoureusement des règles aussi contraignantes. Dans quelle mesure la procédure épistolaire était-elle d’ailleurs employée sur la longue distance ? Pour les juristes ḥanafites, le cadi destinataire ne pouvait accepter la lettre qu’à condition que le cadi expéditeur fût encore en poste au moment de la réception [63]. En recourant à cette procédure, un plaideur prenait donc le risque d’effectuer le voyage en vain : si le cadi expéditeur mourait ou se voyait révoqué avant son arrivée à destination, et si le cadi destinataire en apprenait la nouvelle, il n’ouvrirait même pas la lettre. Dans la partie majoritairement ḥanafite de l’empire [64], il est donc possible que les communications entre cadis aient été géographiquement réduites à une province ou une série de provinces limitrophes.
Dans un ouvrage récent, Benjamin Jokisch a proposé que, loin de surgir d’une réflexion indépendante, la constitution du fiqh préclassique procéda d’une codification étatique, à l’époque de Hārūn al-Rašīd, par l’adaptation du droit romain précédemment codifié dans l’Empire byzantin [65]. Cette hypothèse simplifie considérablement la compréhension de la judicature, dont le fonctionnement pourrait procéder d’une telle entreprise étatique. Néanmoins, la formation du réseau judiciaire épistolaire reflète une histoire bien différente. La correspondance entre cadis apparaît avant tout comme une pratique, enracinée dans l’époque umayyade, qui se perfectionna au gré de la réflexion personnelle des cadis eux-mêmes. Cette pratique fit ensuite l’objet d’une théorisation juridique mais en marge de l’État, par des fuqahā’ indépendants. De son côté, le pouvoir politique n’entreprit nullement de codifier la procédure. Les instructions qu’il envoyait à ses cadis lors de leur investiture étaient à peine allusives ; bien plus, si le modèle reproduit par Qudāma b. Ğa‘far date bien du IVe/Xe siècle, ces recommandations accusaient un retard sérieux sur la réflexion juridique et sur la pratique elle-même. Le fiqh ne se développa pas seulement, à ses débuts, comme une critique de la pratique umayyade [66] : il vint également combler un vide dans un secteur normatif largement laissé à l’abandon par le pouvoir califal.
Cet article a déjà été publié in D. Coulon, Ch. Picard, D. Valérian (éd.), Espaces et Réseaux en Méditerranée VIe-XVIe siècle : Volume 2, La formation des réseaux
[36]. Wakī‘, Aḫbār al-quḍāt, op. cit., III, p. 311.
[37]. Al-Šāfi‘ī, Kitāb al-umm, op. cit., VI, p. 211.
[38]. Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, op. cit., p. 442-43 ; Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, op. cit., p. 115-16. Cf. Hallaq, « Qāḍīs communicating », art. cit., p. 447, 450.
[39]. Al-Šāfi‘ī, Kitāb al-umm, op. cit., VI, p. 211.
[40]. Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, op. cit., p. 410. Cf. al-Māwardī, Adab al-qāḍī, op. cit., II, p. 130.
[41]. Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, op. cit., p. 411, 429. Voir Ibn Ḥağar, Raf‘ al-iṣr ‘an quḍātMiṣr, éd. ‘A. M. ‘Umar, Le Caire, 1998, p. 290 (trad. M. Tillier, Vies des cadis de Miṣr, Le Caire, 2002, p. 162).
[42]. Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, op. cit., p. 448. Cf. Al-Šāfi‘ī, Kitāb al-umm, op. cit., VI, p. 211 ; al-Māwardī, Adab al-qāḍī, op. cit., II, p. 89, 126, 136. Voir Hallaq, « Qāḍīs communicating », art. cit., p. 451 ; Johansen, « Formes de langage », art. cit., p. 355.
[43]. Johansen, « Formes de langage », art. cit., p. 357.
[44]. Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, op. cit., p. 411.
[45]. Silverstein, op. cit., p. 45-46.
[46]. Cl. Cahen, « À propos des shuhūd », Studia Islamica 31, 1970, p. 75.
[47]. Pour les détails de ces transformations, voir E. Tyan, Histoire de l’organisation judiciaire en pays d’islam, Leyde, 1960, p. 238-242 ; B. Johansen, « Wahrheit und Geltungsanspruch : zur Begründung und Begrenzung der Autorität des Qadi-Urteils imislamischen Recht », La Giustizia nell’altomedioevo (secoli IX-XI), Spolète, 1997 (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 44), p. 1006-1012.
[48]. Cahen, « À propos des shuhūd », art. cit., p. 76.
[49]. Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, op. cit., p. 289 s.
[50]. Ibid., p. 448.
[51]. Al-Ḫaṣṣāf et al-Ğaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, op. cit., p. 83-84.
[52]. Plusieurs personnages portant la nisba « al-Taymī » exercèrent la judicature de Baṣra à l’époque abbasside : ‘Umar b. ‘Uṯmān al-Taymī, sous al-Mahdī ou al-Rašīd ; Ibrāhīm b. Muḥammad al-Taymī, de 239/853-54 à 247/861-62 ; Aḥmad b. ‘Abd al-Karīm, vers 247-248/861-63. Voir Tillier, Les cadis d’Iraq à l’époque ‘abbāside, op. cit., p. 625-626.
[53]. Al-Tanūḫī, Nišwār al-muḥāḍara, éd. ‘A. al-Šālğī, s.l., 1971, I, p. 140.
[54]. Dans un passage sur la définition des confins d’une propriété en litige, al-Ğaṣṣāṣ distingue nettement les témoins occasionnels d’une catégorie de témoins instrumentaires au service du cadi (al-Ğaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, op. cit., p. 386). Cela suggère qu’à la fin du IVe/Xe siècle, la parole de témoins occasionnels pouvait encore être prise en considération dans la procédure judiciaire.
[55]. Wakī‘, Aḫbār al-quḍāt, op. cit., II, p. 58. W. B. Hallaq (The Origins and Evolution, op. cit., p. 88) interprète ce passage comme la preuve de l’existence, dès la fin du IIe/VIIIe siècle, d’un corps de témoins instrumentaires salariés par le cadi. Pourtant le texte de Wakī‘ ne fait allusion qu’aux umanā’, et non aux témoins.
[56]. Silverstein, op. cit., p. 117-119.
[57]. Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, op. cit., p. 436. Al-Šaybānī autorise le témoignage rapporté si le témoin original est malade ou se trouve à plus de trois jours de l’audience. Al-Šaybānī, al-Ğāmi‘ al-ṣaġīr, Beyrouth, 1986, p. 392 ; Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, op. cit., p. 107 s. Sur le témoignage rapporté, voir Schacht, Introduction, op. cit., p. 161 ; R. Brunschvig, Études d’islamologie, Paris, 1976, II, p. 214.
[58]. Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, op. cit., p. 435.
[59]. Tyan, Organisation judiciaire, op. cit., p. 250.
[60]. Qudāma b. Ğa‘far, Kitāb al-ḫarāğ, op. cit., p. 43.
[61]. Hallaq, « Qāḍīs communicating », art. cit., p. 445-46.
[62]. Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, op. cit., p. 433. Cf. Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, op. cit., p. 119.
[63]. Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, op. cit., p. 434. Il en allait différemment chez les mālikites et les šāfi‘ītes, pour qui il importait seulement que le cadi ait été en poste au moment de l’expédition. Hallaq, « Qāḍīs communicating », art. cit., p. 452.
[64]. Sur cet espace, voir N. Tsafrir, The History of an Islamic School of Law. The Early Spread of Hanafism, Cambridge, 2004.
[65]. B. Jokisch, Islamic Imperial Law. Harun-Al-Rashid’s Codification Project, Berlin, 2007, p. 279 s.
[66]. J. Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford, 1950, p. 190 s.
[37]. Al-Šāfi‘ī, Kitāb al-umm, op. cit., VI, p. 211.
[38]. Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, op. cit., p. 442-43 ; Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, op. cit., p. 115-16. Cf. Hallaq, « Qāḍīs communicating », art. cit., p. 447, 450.
[39]. Al-Šāfi‘ī, Kitāb al-umm, op. cit., VI, p. 211.
[40]. Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, op. cit., p. 410. Cf. al-Māwardī, Adab al-qāḍī, op. cit., II, p. 130.
[41]. Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, op. cit., p. 411, 429. Voir Ibn Ḥağar, Raf‘ al-iṣr ‘an quḍātMiṣr, éd. ‘A. M. ‘Umar, Le Caire, 1998, p. 290 (trad. M. Tillier, Vies des cadis de Miṣr, Le Caire, 2002, p. 162).
[42]. Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, op. cit., p. 448. Cf. Al-Šāfi‘ī, Kitāb al-umm, op. cit., VI, p. 211 ; al-Māwardī, Adab al-qāḍī, op. cit., II, p. 89, 126, 136. Voir Hallaq, « Qāḍīs communicating », art. cit., p. 451 ; Johansen, « Formes de langage », art. cit., p. 355.
[43]. Johansen, « Formes de langage », art. cit., p. 357.
[44]. Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, op. cit., p. 411.
[45]. Silverstein, op. cit., p. 45-46.
[46]. Cl. Cahen, « À propos des shuhūd », Studia Islamica 31, 1970, p. 75.
[47]. Pour les détails de ces transformations, voir E. Tyan, Histoire de l’organisation judiciaire en pays d’islam, Leyde, 1960, p. 238-242 ; B. Johansen, « Wahrheit und Geltungsanspruch : zur Begründung und Begrenzung der Autorität des Qadi-Urteils imislamischen Recht », La Giustizia nell’altomedioevo (secoli IX-XI), Spolète, 1997 (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 44), p. 1006-1012.
[48]. Cahen, « À propos des shuhūd », art. cit., p. 76.
[49]. Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, op. cit., p. 289 s.
[50]. Ibid., p. 448.
[51]. Al-Ḫaṣṣāf et al-Ğaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, op. cit., p. 83-84.
[52]. Plusieurs personnages portant la nisba « al-Taymī » exercèrent la judicature de Baṣra à l’époque abbasside : ‘Umar b. ‘Uṯmān al-Taymī, sous al-Mahdī ou al-Rašīd ; Ibrāhīm b. Muḥammad al-Taymī, de 239/853-54 à 247/861-62 ; Aḥmad b. ‘Abd al-Karīm, vers 247-248/861-63. Voir Tillier, Les cadis d’Iraq à l’époque ‘abbāside, op. cit., p. 625-626.
[53]. Al-Tanūḫī, Nišwār al-muḥāḍara, éd. ‘A. al-Šālğī, s.l., 1971, I, p. 140.
[54]. Dans un passage sur la définition des confins d’une propriété en litige, al-Ğaṣṣāṣ distingue nettement les témoins occasionnels d’une catégorie de témoins instrumentaires au service du cadi (al-Ğaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, op. cit., p. 386). Cela suggère qu’à la fin du IVe/Xe siècle, la parole de témoins occasionnels pouvait encore être prise en considération dans la procédure judiciaire.
[55]. Wakī‘, Aḫbār al-quḍāt, op. cit., II, p. 58. W. B. Hallaq (The Origins and Evolution, op. cit., p. 88) interprète ce passage comme la preuve de l’existence, dès la fin du IIe/VIIIe siècle, d’un corps de témoins instrumentaires salariés par le cadi. Pourtant le texte de Wakī‘ ne fait allusion qu’aux umanā’, et non aux témoins.
[56]. Silverstein, op. cit., p. 117-119.
[57]. Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, op. cit., p. 436. Al-Šaybānī autorise le témoignage rapporté si le témoin original est malade ou se trouve à plus de trois jours de l’audience. Al-Šaybānī, al-Ğāmi‘ al-ṣaġīr, Beyrouth, 1986, p. 392 ; Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, op. cit., p. 107 s. Sur le témoignage rapporté, voir Schacht, Introduction, op. cit., p. 161 ; R. Brunschvig, Études d’islamologie, Paris, 1976, II, p. 214.
[58]. Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, op. cit., p. 435.
[59]. Tyan, Organisation judiciaire, op. cit., p. 250.
[60]. Qudāma b. Ğa‘far, Kitāb al-ḫarāğ, op. cit., p. 43.
[61]. Hallaq, « Qāḍīs communicating », art. cit., p. 445-46.
[62]. Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, op. cit., p. 433. Cf. Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, op. cit., p. 119.
[63]. Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, op. cit., p. 434. Il en allait différemment chez les mālikites et les šāfi‘ītes, pour qui il importait seulement que le cadi ait été en poste au moment de l’expédition. Hallaq, « Qāḍīs communicating », art. cit., p. 452.
[64]. Sur cet espace, voir N. Tsafrir, The History of an Islamic School of Law. The Early Spread of Hanafism, Cambridge, 2004.
[65]. B. Jokisch, Islamic Imperial Law. Harun-Al-Rashid’s Codification Project, Berlin, 2007, p. 279 s.
[66]. J. Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford, 1950, p. 190 s.